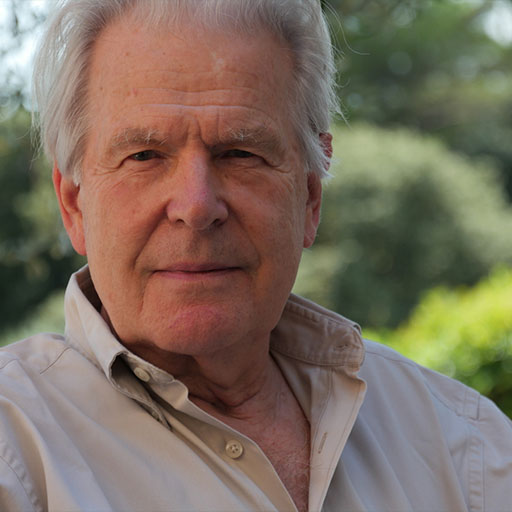Après avoir fait revivre Dada, au Centre Pompidou, à Paris, en 2005, Laurent Le Bon et Claire Garnier ont choisi la seule année 1917 pour explorer les rapports entre l’art et la guerre. Une exposition hors du commun, tout comme son cadre, le Centre Pompidou-Metz. Installé derrière l’immense gare construite par Guillaume II, dans un terrain vague où personne n’avait jamais voulu mettre les pieds, l’immense bâtiment conçu par Shigeru Ban et Jean de Gastines, inauguré en mai 2010 par l’exposition Chefs-d’œuvre ? a attiré en deux ans un million et demi de visiteurs, dont les deux tiers sont venus de la région lorraine. C’est dire l’état de déshérence culturelle de certaines provinces françaises et la soif de connaissances de leurs habitants. Mais le travail de Laurent Le Bon, à la tête de cet établissement depuis sa conception, est reconnu dans le monde entier. Aussi vient-il d’être reconduit dans ses fonctions jusqu’en 2016.
Consacrer une exposition à une seule année est une chose aussi rare que risquée. L’immense majorité des expositions sont monographiques, tant nous avons pris l’habitude de suivre un seul artiste durant une partie de sa carrière. Parfois un dialogue est instauré entre Picasso et Matisse ou entre Calder et Miró. C’est rare. Et plus rares encore sont les expositions thématiques: elles ne sont guère appréciées par les organisateurs de spectacles qui font aujourd’hui la loi. D’où leur étonnement irrité devant le succès de Mélancolie ou Crime et châtiment. Mais le public est parfois moins bête que ne le pensent les publicitaires.
Choisir 1893 ou 1913, comme l’avaient fait Françoise Cachin et Monique Nonne pour 1893: L’Europe des peintres (Musée d’Orsay, 1993) ou comme le fait actuellement le High Museum d’Atlanta avec Fast Forward: Modern Moments: 1913-2013, signifiait mettre en évidence des moments particulièrement féconds dans l’histoire de la création artistique. Mais 1917 ? Certes, tout le monde se souvient de quelques événements marquants : l’entrée en guerre des États-Unis, l’offensive désastreuse de Nivelle au Chemin des Dames, les mutineries dans l’armée française, les grèves en Allemagne, l’offensive italienne sur le plateau de Bainsizza, la deuxième bataille des Flandres, les émeutes en Andalousie, la Révolution russe, l’offensive de Pétain contre le fort de La Malmaison, l’armistice de Brest-Litovsk. Tout cela au prix de centaines et de centaines de milliers de morts et de blessés.
Mais l’art dans tout cela ? La guerre n’est-elle pas, sinon la négation de l’art, au moins la mise en cause du fondement même de l’art visuel traditionnel, ce monde d’œuvres signées représenté par le tableau ou le dessin ? Beaucoup d’auteurs l’ont dit – Ernst Jünger l’un des premiers, mais aussi Guy de Pourtalès, engagé volontaire – la Première Guerre signifie la fin de l’individu et le début du règne de la machine. Aussi les machines artistiques nouvelles que sont l’appareil de photo et le cinématographe sont-elles mieux à même de rendre l’univers de la guerre que la peinture ou la gravure. La technique prend le pas sur l’art, comme l’avait craint Baudelaire analysant notre modernité.
Ces nouveaux médias sont omniprésents dans cette exposition, non seulement à travers la photographie et le film, mais aussi à travers la presse qui ne cessait de publier les images du front et de l’arrière. Des concours furent même organisés pour encourager tout un chacun à transmettre l’image la plus spectaculaire d’une explosion, le déchirement le plus atroce du corps ennemi. Destruction des paysages, des monuments, des visages. Et reconstruction par la chirurgie des gueules cassées.
Certes, il ne manque pas de peintres qui, tels John Nash, William Orpen, Christopher Richard, Wynne Nevinson ou Hermann Paul, ont représenté, de façon plus ou moins réaliste, la désolation des paysages dévastés et l’enfer des tranchées. Leur langage conventionnel n’est pas toujours à la hauteur du drame et leur nom ne nous est plus très familier. Moins, en tout cas, que ceux de Max Ernst, d’Otto Dix ou de George Grosz, tous mobilisés du côté allemand. Ou de Fernand Léger, dont La Partie de cartes (prêtée par le Musée Kröller-Müller d’Otterlo) avec ses hommes-machines et ses corps robotisés annonce les compositions mécanomorphes qu’il développe à partir de 1918.
Beaucoup de peintres peinent à trouver un langage devant l’horreur, ainsi Maurice Denis, Bonnard, Vallotton. Aucun d’eux ne délivre une image héroïque de la guerre. Denis, face à L’Église de Lassigny en ruines ou devant le Cimetière de Benay, semble chercher quelque secours dans la thématique religieuse. Vallotton, qui avait déjà 52 ans en 1917, a plus d’une fois demandé à être envoyé en mission au front: il parcourt, du 7 au 23 juin, les sites martyrs de Champagne. À son retour, il exécute en toute hâte une série de paysages de guerre en vue de l’exposition des peintres aux armées, au musée du Luxembourg, au mois d’octobre. Il en est profondément insatisfait, car, écrit-il, «la ‘guerre’ est un phénomène strictement intérieur, sensible au-dedans, et dont toutes les manifestations apparentes, quel qu’en puisse être le grandiose ou l’horreur, sont et restent épisodes, pittoresque ou document […] Que représenter dans tout cela ? Pas l’objet, bien sûr, ce serait primaire, encore qu’on n’y manquera pas, et cependant un Art sans représentation déterminée d’objets est-il possible ? Qui sait !» Aussi, sa grande toile intitulée Verdun (où pourtant il n’est jamais allé) tend-elle vers une abstraction où s’entrecroisent les projecteurs, sans que le spectateur puisse distinguer les parties en présence. Le danger est partout, dénué de causes humaines. L’ennemi est sans visage.
Quant à Bonnard, il s’est rendu avec Vuillard sur le front de la Somme, ce dont témoignent L’Armistice et Un village en ruines près de Ham. Il illustre également un petit ouvrage d’Ambroise Vollard, Le Père Ubu à l’hôpital, où il transpose dans la Grèce antique, soldats, médecins et gradés pour donner plus libre cours à sa critique. Mais Bonnard a décidé de se détourner de l’insoutenable: le grand projet de cette année 1917 est L’Été, un paysage arcadien destiné d’abord à la collection Hahnloser de Winterthour, mais refusé pour un problème de dimension.
Pour beaucoup d’artistes, les seules attitudes possibles sont soit la protestation et la dérision, soit l’évasion et la fuite. Dada et ceux qui lui étaient proches, à Zurich, à Berlin, à Cologne ont choisi la révolte; ils ont répondu à la destruction d’une civilisation par la destruction de son langage et de ses formes artistiques. Dada, c’est un énorme éclat de rire dans un cimetière. D’autres ont tourné le dos à l’événement. C’est le cas de Picasso, comme le montrent ses tableaux cubistes, mais aussi l’aventure de Parade.
En février, Picasso part avec Cocteau pour Rome, rejoindre les Ballets russes de Diaghilev. Il y reste dix semaines, travaillant sans relâche aux décors, aux costumes et au rideau de scène de ce ballet pour lequel Cocteau a écrit l’argument et Satie la musique. Il sera créé le 18 mai au Théâtre du Châtelet à Paris. De quoi s’agit-il ? D’une parade de music-hall donnée dans la rue devant un public plus ou moins indifférent qui hésite à entrer dans le théâtre. Si la chorégraphie de Léonide Massine est moderne, si les décors et les costumes sont résolument cubistes, l’énorme rideau de scène est une œuvre volontairement conventionnelle, mais pleine d’humour. Seule concession à la situation de guerre: les couleurs de la France et de l’Italie célébrant l’alliance des deux pays. Quant aux personnages, ils sont empruntés à la commedia dell’arte et au monde du cirque. On voit les artistes au repos et l’on peut jeter un regard dans les coulisses. Les couleurs rappellent la période rose du peintre, les arlequins annoncent un divertissement burlesque, une futilité loufoque, la jument transformée en Pégase, une parodie. «Si j’avais su que c’était si bête – s’écrie un spectateur – j’aurais amené les enfants !» Apollinaire, en revanche, dans le programme distribué lors de la représentation, salue l’avènement d’un esprit nouveau qu’il nomme surréalisme.