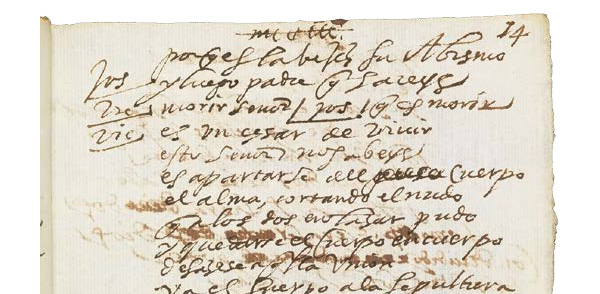De Schubert longtemps on n’a voulu savoir que ce qui peut être chanté, pianoté chez soi. Moments Musicaux, lieder que s’accompagnerait à elle même une grande sœur, avec si possible la voix d’Elisabeth Schumann. C’est elle qui aux années 30 a ouvert au disque le monde vocal enchanté de Schubert. Pour sa dorure surtout : le Pâtre sur son rocher, le Knabe avec sa rose. Elle a pu enregistrer la Berceuse du Ruisseau, hors contexte, sans suggérer, sans penser peut être, que la fin de la Belle Meunière est ce qu’il y a de plus désespérant au monde. Quant au piano de Schubert… C’est aux fêtes du centenaire de sa mort, (1828), que Rachmaninov, formidable pianiste et qui jouait Schumann comme personne, découvrit qu’il y existait de lui des Sonates. Schnabel était bien seul à en donner alors ; puis, largement plus jeunes, Arrau et Serkin fascinés par leur envers. Il n’est pas crépuscule seulement (comme pour le Pâtre sur le rocher), mais détresse, et la plus noire et amère qu’on ait fait chanter sur un piano, à quelque époque que ce fût. Le Voyage d’hiver les épouvanterait, Schubert en détournait ses amis, il les mettait en garde. Ses sonates n’ont pas de texte pour prévenir, mais cela affleure, tout le temps. Le noir de Schubert.
Déjà aux années 50, Hotter, puis Fischer-Dieskau et Schwarzkopf nous ont dévoilé systématiquement les paysages du lied pas encore familiers; le Voyage d’hiver a rempli des salles. Mais c’est tout un mur d’incompréhension qui s’est abattu lorsqu’en milieu d’années 70, Brendel a gravé tout le piano solo de Schubert depuis 1824, quatre pauvres années qui lui restaient à vivre, mais fécondissimes. Toute une génération d’initiateurs s’est levée, affichant les trois Sonates ultimes, aussi escarpées à leur façon qu’un cycle comme le Voyage, Pollini et Kovacevich (encore Bishop à l’époque), Ashkenazy, Guilels, j’en passe. D’où ce paradoxe au bout de dix ans : une sorte d’édulcoration, de banalisation en tout cas, même du plus dissuasif ! On peut laisser de côté le tout neuf coffret DG où Barenboim, s’affrontant aux plus augustes sonates, semble n’en vouloir voir que le versant de fleurs. Mais Philippe Cassard vient de donner une D 959 exemplaire de vigueur et rigueur, -sans desceller pourtant, dans l’andantino qui semble n’être qu’une marche à l’infini dans l’hiver (l’exode plutôt) les zébrures d’apocalypse, quelque chose comme un voile du Temple soudain qui se déchire en deux, que seul Serkin a su y mettre. David Fray nous apporte plus essentiel encore : la sol majeur D 894, dont le molto moderato inaugural est aussi long que celui de la D 960, mais d’une tout autre matière, de l’eau plutôt, une eau qui court, une eau qui sommeille, et aura des sursauts. Il évite l’excès de lourdeur ou lenteur à quoi même Arrau et Richter ont succombé. Il n’a pas non plus ce poids surpuissant créateur d’imminences qu’on n’a connu qu’à Ashkenazy. Mais quelle fluidité, avec des épaississements et des dilutions, un moiré, des réponses et rappels de diaprures, tout un travail d’orfèvre sur la sonorité, et la poésie de la sonorité ! C’est mieux qu’un paysage de plus : une consistance neuve. Le magique Trio s’envolera avec la grâce la plus simple. Simplicité, c’est tout Schubert. David Fray a réussi cette quadrature du cercle, de nous le faire beau comme il le mérite, esthétiquement beau, sans le déparer par des afféteries.
Dorothea Röschmann, mozartienne suprême mais si rare sur scène, nous donne un disque, enfin! Portraits, affirme l’affiche. Disons plutôt Présences, poignantes, d’une proximité presque dérangeante dans leur palpitation, leur détresse. Wolf (les Mignon), Schumann (les Marie Stuart) y rejoignent Schubert. Mais c’est la Mignon, que lui le premier a prise à Goethe, c’est sa Marguerite, qui crient devant nous, -des écorchées vives. Éclate du coup le cadre supposé intimiste du lied, gicle une pleine charge de douleur ; on oublie le studio, ce qu’il a de feutré et neutre ; quelqu’un prend parti, impose la passion, à vif, avec dans la mi-voix des aspérités et des intensifications qui dérangent une écoute trop confortable. Ah, ça brûle plus que du théâtre ! Un voile ici aussi se déchire, et la vérité derrière, est douleur, avec un visage qui ne nous quittera plus.