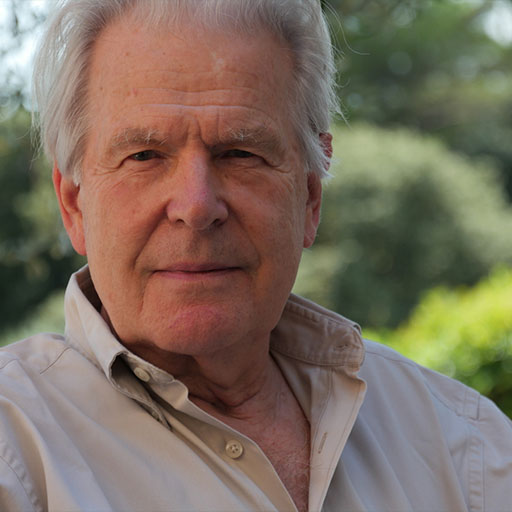[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Robert Kopp
[/vc_column_text][vc_column_text]
 Il existe au moins deux raisons impératives de faire le voyage de Potsdam, l’ancienne capitale de la Prusse, aux portes de Berlin, presque entièrement détruite par les bombardements alliés en avril 1945, puis rasée par les Soviets et transformée en cité interdite abritant le centre de contre-espionnage russe : le tout nouveau Musée Barberini et l’exposition Max Beckmann : Welttheater, qui s’y tient depuis le 24 février et jusqu’au 10 juin 2018 encore.
Il existe au moins deux raisons impératives de faire le voyage de Potsdam, l’ancienne capitale de la Prusse, aux portes de Berlin, presque entièrement détruite par les bombardements alliés en avril 1945, puis rasée par les Soviets et transformée en cité interdite abritant le centre de contre-espionnage russe : le tout nouveau Musée Barberini et l’exposition Max Beckmann : Welttheater, qui s’y tient depuis le 24 février et jusqu’au 10 juin 2018 encore.
Le Palais Barberini de Potsdam tient son nom du Palazzo Barberini de Rom, édifié cent cinquante ans plus tôt. C’est le modèle qu’a suivi l’architecte Carl von Gontard, mandaté, en 1771, par Frédéric II, l’ami de Voltaire, de parachever les abords de la place du Vieux Marché. Gontard réunit donc une série d’habitations bourgeoises derrière une somptueuse façade, mélangeant classicisme et baroque, dans le style du Grand Siècle. Totalement démolis en 1945, remplacé par un parking, tout comme le Stadtschloss voisin, construit vingt ans plus tôt par le célèbre Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, à qui Frédéric II avait également confié la réalisation du palais de Sansouci, ces deux monuments viennent d’être reconstruits à l’identique, du moins pour ce qui est des façades. Une entreprise qui n’a pas manqué de susciter des controverses sur le principe même de ce genre de reconstructions historiques qui, en fin de compte, n’ont que l’apparence de bâtiments vrais, témoins authentiques d’un passé qui auraient traversé les générations. Les mêmes questions avaient été débattues – âprement et pendant dix ans – lorsqu’il s’est agi de reconstruire le Berliner Stadtschloss, dont l’inauguration n’est prévue que pour 2019.
 Ce n’est que grâce à des mécènes privés que ces chantiers gigantesques ont pu être entrepris. Dans le cas du Stadtschloss de Potsdam et du Palais Barberini, c’est la Fondation Hasso Plattner qui s’est engagée à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros. Hasso Plattner a acquis une des premières fortunes en Allemagne par son entreprise de création de logiciels, son produit le plus connu étant le progiciel de gestion intégré SAP ERP. Engagé dans quantité de projets philanthropiques, Plattner est aussi un grand collectionneur. Deux domaines retiennent plus particulièrement son attention : l’impressionnisme et à l’art de l’ancienne RDA. En faisant reconstruire le Palais Barberini, il voulait créer un musée capable d’accueillir ses collection. C’est depuis peu chose faite : le Musée Barberini a été inauguré le 20 janvier 2017 par Angela Merkel, en présence du ministre-président du Land de Brandbourg, du maire de Potsdam et de Bill Gates. La toute première exposition, de janvier à mai 2017, fut consacrée à l’impressionnisme, la suivante aux artistes de l’ancienne RDA. A chaque fois, les tableaux de la collection Plattner ont été confrontés à des prêts venus de musées et de collections privées du monde entier. Selon l’avis des connaisseurs, ils ont vaillamment soutenu la comparaison.
Ce n’est que grâce à des mécènes privés que ces chantiers gigantesques ont pu être entrepris. Dans le cas du Stadtschloss de Potsdam et du Palais Barberini, c’est la Fondation Hasso Plattner qui s’est engagée à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros. Hasso Plattner a acquis une des premières fortunes en Allemagne par son entreprise de création de logiciels, son produit le plus connu étant le progiciel de gestion intégré SAP ERP. Engagé dans quantité de projets philanthropiques, Plattner est aussi un grand collectionneur. Deux domaines retiennent plus particulièrement son attention : l’impressionnisme et à l’art de l’ancienne RDA. En faisant reconstruire le Palais Barberini, il voulait créer un musée capable d’accueillir ses collection. C’est depuis peu chose faite : le Musée Barberini a été inauguré le 20 janvier 2017 par Angela Merkel, en présence du ministre-président du Land de Brandbourg, du maire de Potsdam et de Bill Gates. La toute première exposition, de janvier à mai 2017, fut consacrée à l’impressionnisme, la suivante aux artistes de l’ancienne RDA. A chaque fois, les tableaux de la collection Plattner ont été confrontés à des prêts venus de musées et de collections privées du monde entier. Selon l’avis des connaisseurs, ils ont vaillamment soutenu la comparaison.
L’exposition actuelle, Max Beckmann : Welttheater, a été conçue en collaboration avec la Kunsthalle de Bremen, qui abrite une de plus importantes collections de ce peintre, ainsi que le Max Beckmann Archiv, où sont conservées des milliers de lettres, de photographies, de coupures de presse et autres documents. Ce qui fait de Bremen le premier centre des recherches consacrées à ce peintre. L’exposition actuellement visible Potsdam y a eu lieu du 30 septembre 2017 au 4 février 2018 et un important catalogue a été publié par les éditions Prestel. Ce n’est de loin pas la première exposition Beckmann ces dernières années. Il y a deux ans, la Berlinische Galerie, un musée privé, né en 2004 et dédié à l’art, à la photographie et à l’architecture de Berlin depuis 1870, a consacré un accrochage très important à Beckmann und Berlin. Et en 2011, le Städelmuseum de Francfort a montré les tableaux de l’exil américain du peintre et la même année, le musée de Leipzig a exposé les paysages de Beckmann, qui furent ensuite montrés à Bâle. Sans parler de l’exposition, Max Beckmann, un peintre dans l’histoire, du Centre Pompidou en 2002-2003. C’est dire la place – une des toutes premières – qu’occupe Max Beckmann (1884-1950) aujourd’hui sur la scène artistique allemande, voir internationale.
Cette place, Beckmann la partage avec quelques autres artistes qui, en 1933, ont été déclarés « dégénérés » par le nazis. Parmi eux les membres de la Brücke et du Blaue Reiter, deux mouvements d’avant-garde qui ont été redécouverts, eux-aussi, à partir des années 1950 seulement (voir Artpassions, n° 29, avril 2012 et n° 47, septembre 2017). Remettre à l’honneur ces peintres n’est pas seulement rendre justice à des artistes qui avaient été persécutés pour des raison politiques, c’est aussi montrer que les avant-gardes du XXe siècle ne sont pas nécessairement à chercher du côté de l’abstraction et que la peinture figurative est pour le moins aussi novatrice.
Max Beckmann se situe toutefois à l’opposé de Franz Marc et de Kandinsky. En réponse à Marc, il écrit dans un article intitulé « Pensées sur l’art temporel et intemporel » : « Une chose est récurrente en tout art. C’est la sensibilité artistique, liée au caractère figuratif et objectif des objets à représenter. » Il estime que les « papiers peints Gauguin » ou les « étoffes Matisse » pèchent par excès d’esthétisme décoratif et ne permettent plus de faire la distinction entre un tableau et un papier peint. Pour Beckmann, l’artiste doit créer selon « l’esprit de son temps », ce qui signifie qu’il doive d’abord en prendre conscience. Beckmann part donc de l’histoire telle qu’il l’a vécue. Comme les grands peintres du XIXe siècle, Goya, Géricault, Delacroix, qui ont représenté des scènes remarquables de la mythologie, de la religion, de l’histoire, Beckmann veut rendre compte de son temps, non pas en pratiquant une peinture narrative, mais en créant des personnages emblématiques qu’il met en scène dans des décors à haute teneur symbolique.
 Dire que le monde est un vaste théâtre, comme le suggère le sous-titre de cette exposition, ne rend qu’imparfaitement compte du propos de Beckmann. Ce dernier commence par prendre le mot de théâtre dans son sens premier. C’est ainsi qu’il se représente en clown ou en saltimbanque, en danseur de cabaret, en apache, en magicien, en homme de cirque, en acrobate même. Autant de rôles qui lui permettent de dénoncer le jeu de masque qui caractérise la société des années 20 et 30, gangrenée par une crise sociale et morale qui conduira finalement au nazisme. Beckmann ne cesse de dénoncer la sinistre mascarade de son temps, ainsi dans les célèbres triptiques, La Tentation de Saint-Antoine (1936-1937), Les Acteurs (1941-1942) ou Les Argonautes (1949-1950), dans lequel il renoue, à travers son expressionisme, avec la plus ancienne tradition de la peinture religieuse.
Dire que le monde est un vaste théâtre, comme le suggère le sous-titre de cette exposition, ne rend qu’imparfaitement compte du propos de Beckmann. Ce dernier commence par prendre le mot de théâtre dans son sens premier. C’est ainsi qu’il se représente en clown ou en saltimbanque, en danseur de cabaret, en apache, en magicien, en homme de cirque, en acrobate même. Autant de rôles qui lui permettent de dénoncer le jeu de masque qui caractérise la société des années 20 et 30, gangrenée par une crise sociale et morale qui conduira finalement au nazisme. Beckmann ne cesse de dénoncer la sinistre mascarade de son temps, ainsi dans les célèbres triptiques, La Tentation de Saint-Antoine (1936-1937), Les Acteurs (1941-1942) ou Les Argonautes (1949-1950), dans lequel il renoue, à travers son expressionisme, avec la plus ancienne tradition de la peinture religieuse.
Né à Leipzig en 1884, Beckmann a été formé à l’école de beaux-arts de Weimar, avant de s’installer à Berlin. Mobilisé sur le front belge, il est renvoyé dès 1915 en raison d’une dépression nerveuse. Après plusieurs séjours à Baden-Baden dans les année 20, Beckmann enseigne à la Städelschule à Francfort jusqu’à ce qu’en 1933 les nazis le chassent de son poste. Il fait désormais partie des artistes « dégénérés » dont les œuvres sont retirées des musées allemands. En 1937, il quitte l’Allemagne pour Amsterdam, où il vit dans une extrême détresse. Puis, il émigre en 1947 aux Etats-Unis. Il meurt le 27 décembre 1950 à New York, peu après avoir reçu le premier prix de peinture à la Biennale de Venise. Ses tableaux comptent aujourd’hui parmi les plus côtés sur le marché : en septembre 2017, L’Enfer des oiseaux a été vendu chez Christie’s à Londres pour plus de 40 millions d’euros.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]