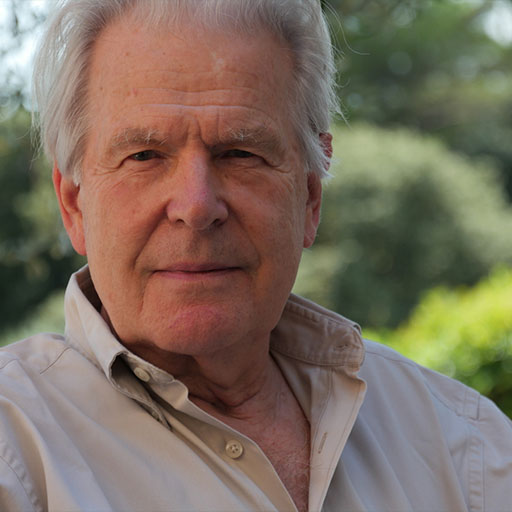Paris, pour quelques mois, est redevenu la capitale européenne des arts. Rarement autant d’expositions éblouissantes ne se sont côtoyées. Le Caravage au musée Jacquemart-André, Venise au Grand Palais, Picasso bleu et rose au musée d’Orsay, qui sera présenté dans une version réduite à la Fondation Beyeler à partir de février 2019, Le Cubisme au Centre Georges-Pompidou, Schiele et Basquiat à la Fondation Louis Vuitton et la première grande rétrospective de Miró depuis quinze ans au Grand Palais. La dernière a eu lieu au Centre Georges-Pompidou en 2004 ; elle s’était concentrée sur les premières années, de 1917 à 1934.
Fu d’artifice complété par Mucha au musée du Luxembourg, par Giacometti au musée Maillol, par les papiers découpés de Rodin au musée Rodin, une technique que le maître a expérimenté bien avant Matisse, Braque et Picasso, par Renoir père et fils, confrontant tableaux et films de façon inédite au musée d’Orsay. En allant d’une exposition à l’autre, on pend conscience à quel point était fécondant le dialogue qui s’est installé entre des artistes de styles très différents, qui, pour la plupart, se sont croisés à un moment ou à un autre à Paris.
Miró est venu à Paris au lendemain de la Première Guerre. Il avait vingt-six ans et s’était déjà fait un nom dans le sillage du fauvisme par plusieurs expositions à Barcelone, sa ville natale, où ses autoportraits avaient été particulièrement remarqués. C’est à Barcelone que ce fils d’un orfèvre a reçu une formation solide, d’abord à l’École des BeauxArts, puis au Cercle artistique de Saint-Luc. Dès 1918, les très avant-gardistes Galeries Dalmau, qui avaient organisé les premières expositions cubistes en Espagne, lui consacrent une première exposition individuelle, qui le fit connaître au-delà des Pyrénées. Il croise Picabia, consulte sa revue 391, mêlant textes et images, tout comme SIC de Pierre Albert-Birot et Nord-Sud de Pierre Reverdy, dont le nom apparaît dans une de ses toiles. Sans parler des Calligrammes d’Apollinaire, autre date marquante.
Après un premier séjour à Paris en 1919, il s’installe définitivement dans la capitale en 1920, tout en passant ses étés à Mont-roig, près de Barcelone. C’est que Miró est un terrien, comme André Masson, avec lequel il partagera son atelier au 45 de la rue Blomet. « Nous autres Catalans, dit-il souvent, nous pensons qu’il faut avoir les pieds solidement plantés dans le sol si l’on veut rebondir dans les airs ». En effet, Le Potager et l’âne, Vigne et oliviers, Tarragone et La Ferme sont rapidement suivis par Terre labourée, souvent considérée comme sa première toile surréaliste.
La rue Blomet devient rapidement le point de ralliement du mouvement. On y rencontre André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, Robert Desnos, Paul Éluard, Yves Tanguy, Man Ray, parmi beaucoup d’autres. Tous éprouvent l’impérieux besoin de s’affranchir de toutes les conventions, y compris celles des avant-gardes, qui toutes risquent de se transformer en nouveaux académismes, à commencer par le cubisme. C’est la mise en cause définitive de toute référence au réel.
Pour les surréalistes, Miró était une recrue de choix, « le plus surréaliste d’entre nous », dira Breton, qui précisera dans Genèse et perspective artistique du surréalisme : « L’entrée tumultueuse, en 1924, de Miró, marque une étape importante dans le développement de l’art surréaliste. Miró, qui laisse alors derrière lui une œuvre d’un esprit moins évolué mais qui témoigne de qualités plastiques de premier ordre, franchit d’un bond les derniers barrages qui pouvaient encore faire obstacle à la totale spontanéité de l’expression. À partir de là sa production atteste une innocence et une liberté qui n’ont pas été dépassées. »

Or, c’est la liberté qui compte pour Miró, non pas le surréalisme. « Je vais casser leurs bouteilles et leurs guitares », avait-il dit à propos des cubistes. De la même manière, Miró s’affranchira du surréalisme. Certes, l’exposition d’une quinzaine de toiles et d’autant de dessins à la Galerie Pierre en 1925 et sa participation à plusieurs expositions de peinture surréaliste au côté de Max Ernst, de Paul Klee ou de Man Ray donnent l’impression qu’il s’est intégré au groupe, mais Miró n’est jamais là où on l’attend.
Son trait s’amenuise, ses constructions deviennent plus simples. La Danseuse espagnole de 1928 est réduite à une épingle à chapeau et une plume d’aile collées sur une toile vierge. « Tableau qu’on ne peut rêver plus nu », dira Éluard.
Plusieurs des ces collages-objets sont exposés à la Galerie Pierre, avec d’autres collages surréalistes. Aragon fournira la préface du catalogue, La Peinture au défi. Et à ces peintures-objets correspondront bientôt des sculptures-objets, comme L’Homme au parapluie (1931) ou l’étonnant Objet du couchant (1937), qualifié de « magique » par Breton, qui le gardera longtemps dans son atelier rue Fontaine.
Mais lorsque certains surréalistes croient devoir choisir entre le mot d’ordre de Rimbaud, « transformer la vie », et celui de Marx, « transformer le monde », que Breton a voulu réunir en un seul, non sans peine, Miró choisit délibérément celui de Rimbaud. « Je ne fais aucune différence entre peinture et poésie », dira-t-il à Georges Duthuit en 1936, « Peinture et poésie se font comme on fait l’amour ; un échange de sang, une étreinte totale, sans aucune prudence, sans nulle protection ».
Cela ne l’a pas empêché de dire son indignation au moment de la guerre d’Espagne, de l’exprimer, comme Picasso, qui a protesté à travers Guernica, dans une grande toile, Le Faucheur, qui faisait face à celle de Picasso dans le pavillon de la République espagnole en 1937, ainsi que par l’affiche, Aidez l’Espagne!
Le parti que prend Miró est toujours celui de la liberté. Giacometti l’avait senti très tôt : « Pour moi, Miró, c’est la grande liberté. Quelque chose de plus aérien, de plus dégagé, de plus léger que tout ce que j’avais jamais vu. En un sens, c’était absolument parfait. »
Robert Kopp