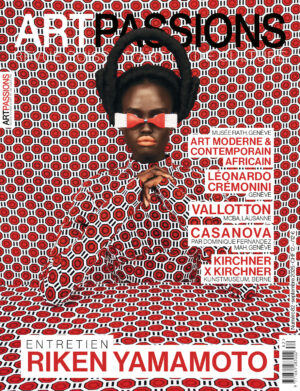Dans le silence de l’atelier, le tilleul gémit lorsque, d’un geste sec, on y enfonce les clefs – et la toile, aussitôt, se tend comme la peau d’un tambour. Il faut hisser le lin sur le châssis jusqu’à ce qu’il devienne aussi doux, aussi souple que le torse d’un homme. Mademoiselle s’y connaît. Elle ferme les yeux et passe la main sur les baguettes de bois, la toile de lin blanc, le ventre du tableau. Un frisson dans le bas du dos lui confirme que tout est bien, qu’il est temps à présent. Table ouverte, rideaux tirés, chignon impeccable et manches retroussées : sa mise est faite ; on peut commencer. Un peu de musique, du Bach ou du Schumann sur le tournedisque électrique, du Chostakovitch – la huitième symphonie – et le plus fort possible. Les voisins râleront. Elle ne leur accorde qu’une pensée distraite ; les couleurs attendent : c’est la beauté, le moment. Elle entre en communion.
Des paysages d’enfance dansent devant ses yeux, les guirlandes de poulpes dans le port de Carthage, l’île aux pins quand la nuit tombe sur Nouméa, les tapis persans et les caves polynésiennes. On verse les poudres d’or et d’argent dans un creuset, une grande plaque translucide, dépolie. On ajoute quelques gouttes d’huile d’œillette aux parfums entêtants, capiteux comme l’olive : la Grèce en plein Paris. L’émulsion s’épaissit : cyan, magenta, jaune citron ou jaune cadmium, terre de Sienne. Ensuite on enduit la toile, on l’encolle à la peau de lapin. Ça brille dans le jour qui se lève. La musique fait gonfler les rideaux de soie. Sept heures du matin. Elle s’applique à n’épargner aucun détail : colmater les fibres, combler les trous dans le tissage, imperméabiliser l’ensemble. Une poignée de pinceaux somnole à portée de main (de toutes sortes : des courts, des longs, plus ou moins ébouriffés) qu’elle éveille un par un, les effleurant du bout des doigts. Le chignon se relâche. Une dernière fois, elle considère la toile nue. L’encollage a fini de sécher ; les couleurs tournent dans leurs pots. Affronter l’abîme, être face au vide et ne pas hésiter à sauter le pas : c’est ça, la peinture ; c’est un élan. Elle n’hésite pas, elle est face au vide, elle affronte l’abîme – en musique. Après tout, elle en est, elle aussi. Elle l’a toujours su. Depuis le premier jour.
En fredonnant, elle esquisse un pas de côté. Tout doit être parfait ; sa main n’hésite pas. Le souffle s’approfondit – on le voit – et le pouls bat la mesure. Elle attaque la toile de front, lui plonge ses pinceaux dans la gorge jusqu’à lui arracher ce qu’elle porte en elle de plus secret, de plus intime : son rythme. Entre les digues tracées d’une main légère, elle fait vomir les ors et pleuvoir ces verts qu’on prendrait pour des bleus, tant le ciel s’y confond avec l’eau. Technicolor. Les dieux entrent dans la danse ; elle s’abandonne à l’instant et poursuit son travail. De grands feux de Bengale naissent sous sa caresse qui, bientôt, la consument. Chaque touche ajoutée au tableau semble lui être ôtée, arrachée. Que l’une se vide au profit de l’autre, lui offre sa moelle, son suc selon une secrète règle d’équivalence. Le rouge sur la bouche passe sur la toile, les yeux bleus irriguent le lapis-lazuli, le bruissement des cheveux ne se retrouve plus que dans celui des lignes peintes, comme agitées par le vent. Elle a fait le pari des fleurs contre les fruits, quitte à s’évanouir dans la splendeur de l’été. Sa célébration l’embrase : elle n’y est plus pour personne. Seul demeure le mouvement, la main saisie en plein mouvement. Les traits de son visage s’effacent à mesure que s’affirment ceux du tableau.On n’entend bientôt plus que le frottement d’un pinceau que plus personne ne tient. Toute musique s’est tue. L’atelier reste désert. En son milieu, la toile achevée. Mademoiselle s’est envolée.
Arthur Pauly
Jeune écrivain et critique d’art