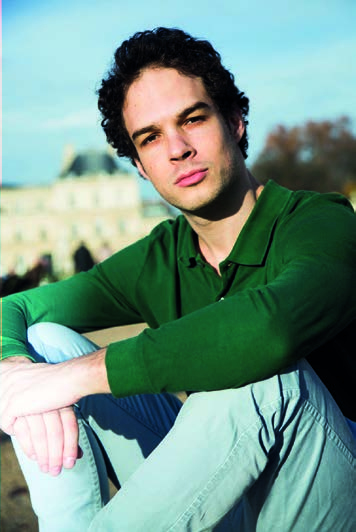Le 5 octobre dernier, à Londres, se produisait un événement qui ferait date dans l’histoire de l’art : la destruction d’une œuvre qui venait d’être vendue aux enchères pour un montant record. Signée Banksy, plus fameux « street artist » d’aujourd’hui, et intitulée Girl with baloon, la toile représentait une petite fille imprimée au pochoir, s’envolant et tenant un ballon rouge en forme de cœur. Je dis bien représentait, car sitôt que le marteau du commissaire-priseur eût frappé son pupitre, un moteur caché dans le cadre se mit en branle, hachant la majeure partie de la toile adjugée. Sidérés, les spectateurs de la vente se ruèrent tous sur leurs téléphones pour photographier ce « happening ».
Suspendue dans un premier temps, la cession du fétiche fut finalement maintenue par Sotheby’s, pour le bonheur de son acquéreuse – qui expliqua avoir « d’abord été choquée », avant de prendre conscience qu’elle allait « posséder [son] bout d’histoire de l’art ». Devenue l’une des séquences les plus médiatisées de la planète, les spécialistes estiment en effet que la valeur de cette Girl with baloon a plus que doublé, passant en un éclair d’un à deux millions de livres. Entre-temps, elle fut d’ailleurs rebaptisée Love is in the bin : l’amour est à la poubelle. Le lendemain, Banksy publiait sur Instagram une photo du désastre, assortie d’une citation de Picasso : « L’urgence de détruire est aussi une urgence créative. »
« Le fait que l’œuvre n’ait été que partiellement lacérée, qu’elle se retrouve dans un état tout à fait reconnaissable et donc revendable, alimente les soupçons », remarque un spécialiste. Quels soupçons ? En l’occurrence, l’affaire parut si juteuse qu’elle ne tarda guère à générer mille fantasmes : la maison Sotheby’s était-elle au courant de l’autodestruction programmée ? À moins que son vendeur, tout aussi anonyme que son acheteuse – et que certains estiment être le plasticien Damien Hirst –, ait décrété que le moment était venu de mettre à profit l’idée de son ami Banksy, lequel lui aurait offert cette reproduction en 2006 ? Une chose est sûre : les spéculations vont bon train, et le mystère s’épaissit, augmentant chaque jour la cote du mythique graffeur de Bristol. Tout en nous rappelant que la provocation, lorsqu’elle s’accompagne d’une mise en scène adéquate, s’avère plus que jamais payante.
Selon Mehdi Ben Cheikh, galeriste parisien spécialiste du « street art », le projet de Banksy était, une fois encore, « d’interroger et critiquer les limites du marché de l’art », comme lorsqu’il avait installé un stand près de Central Park en 2013, afin d’y brader une vingtaine de ses toiles signées, pour la modique somme de soixante dollars… Dans cette optique, bien des commentateurs se référèrent à Marcel Duchamp qui, dès 1914, avec ses ready-mades, transforma un portebouteilles et un urinoir en œuvres d’art. Mais comparaison n’est pas raison. Certes, nos deux artistes engendrent et vendent d’abord un concept, seulement il me semble que toute « critique des limites de l’art » dépend de son époque. Au début du XXe siècle, Duchamp a l’intuition géniale que la consommation est en passe de se muer en religion – et que par conséquent, les objets les plus banals accèdent au statut de sacré.
À l’heure où l’homme occidental s’alarme de la fin de l’humanité, Banksy affirme au contraire que la consommation a fait son temps. Et tournant en dérision la part d’ivresse d’un déclinisme masochiste, il propose de la convertir en destruction – ou plutôt : en virtuel. Car ce qui fait le prix de son œuvre laminée n’est pas sa matérialité : ce sont les millions de « retweets » et de liens menant vers la vidéo de son laminage. À tel point que ses authentiques propriétaires se révèlent davantage être les connectés du monde entier que la collectionneuse qui l’accrochera dans son salon… Warhol promettait à chaque individu son « quart d’heure de célébrité ». Banksy paraît répliquer qu’aucune œuvre, désormais, ne pourra atteindre la postérité sans avoir connu son nombre minimum de « vues » sur Internet.
Arthur Dreyfus
Écrivain