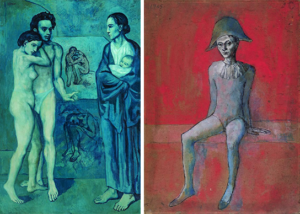La Fondation Henri Cartier-Bresson et le musée de l’Élysée présentent la première grande rétrospective dédiée à l’œuvre de Martine Franck, figure majeure de la photographie du XXe siècle. L’exposition et la publication ambitieuse qui l’accompagne nous invitent à réévaluer une œuvre discrète mais essentielle.

L’œuvre de Martine Franck s’inscrit – apparemment – dans une norme esthétique et sociale: l’approche humaniste cultivée par les photographes de l’agence Magnum est à mi-chemin entre la démarche documentaire et la création artistique. Elle rejoint en effet la célèbre coopérative en 1983 et partage sa vie avec son fondateur, Henri Cartier-Bresson. Elle consacre des travaux importants à l’actualité du temps : le renouvellement de la scène théâtrale dans les années soixante, l’émancipation de la femme et le destin du peuple tibétain dans les années quatre-vingts, la vieillesse et la pauvreté, dans une époque à laquelle la précarité et l’abandon étaient encore un sujet brûlant. Les quelques trois cents images publiées par Agnès Sire et choisies par la photographe peu avant sa mort, traduisent un réel engagement, et l’œuvre s’apparente à une brève encyclopédie sociale de la seconde moitié du siècle passé. Mais on est frappé par la force et la singularité de certaines images – nombreuses – qui semblent échapper à nos catégories habituelles, comme à l’influence d’Henri Cartier-Bresson.
La tentation est grande, en effet, de comparer le style de Franck à celui de son mari. Dans « Piscine, 1976 », son image la plus connue, la magie de l’instant opère avec une force et une évidence qui égalent celles des icônes créées par le Maître. Dans un décor conçu par Capeillères, Franck semble avoir disposé à dessein les corps désarticulés des nageurs, dont les membres tracent des angles aigus brisant l’harmonie tout en courbe voulue par le célèbre architecte. Le langage des corps impose un étrange discours sur la trame irréelle des matières et des formes. Image symbolique – voire ironique – qui traduit le lien que nous créons – ou rêvons – entre nos corps et l’espace. Image onirique, certainement : ce double langage des corps et du décor semble appartenir à l’espace du rêve. Dans « peinture de Paul Delvaux, 1972 », la silhouette voûtée d’une vielle dame et les corps nus des personnages de la toile, s’entrechoquent en une cinglante métaphore des âges de la vie. À moins que ces figures peintes n’incarnent la mort elle-même, dans laquelle la visiteuse s’apprête à basculer. Autre icône : cet homme figé dans un saut improbable au-dessus d’une barque à l’étrave effilée comme un rasoir. Ascension ou chute ? Ode à la vie ou critique sociale ? Une image fondamentalement plurivoque : ses pieds font corps – très exactement – avec l’horizon de la mer. Pour nous c’est une image de l’éternité, ou du chemin qui y mène, par-delà la mort. « Là tu dégages et voles selon », comme dirait Arthur Rimbaud.

Beaucoup de photographies de Franck obéissent au principe du « Kairos », le fameux « moment décisif » cher à Cartier-Bresson. Prise une seconde plus tard ou plus tôt, l’image n’aurait pas fait sens. Mais là où Cartier-Bresson extrait la vérité du moment et du lieu en une équation implacable, parce qu’évidente, et univoque, Franck s’affranchit de l’événement, et semble libérer l’image de toute signification imposée. Le cadre devient le théâtre d’une fascinante conjonction entre le réel et tout autre chose : l’intériorité ? L’imaginaire ? La magie opère totalement dans ses meilleurs portraits : Leiris, Foucault, Guibert, Albert Cohen sont captés dans des « poses » qui ne sont pas des postures, les yeux fixés sur l’objectif. Le décor, plus ou moins incarné, se déploie autour du regard, centre générateur de la composition. Martine Franck ne fait pas semblant de disparaître, puisqu’on la regarde fixement ; elle n’impose pas non plus sa présence, puisque ses « sujets » ont les yeux comme fixés en eux-mêmes, pareils aux personnages de Piero della Francesca qui la fascinaient tant. Ce n’est plus vraiment de la photographie. L’espace ouvert par l’objectif, si concret, si réel, a bien l’étoffe du rêve. Mais un rêve affranchi du rêveur, car la main de l’artiste semble avoir disparu. Elle a montré un mystère sans imposer un sens.
Le médium s’impose avec Cartier-Bresson, formidable révélateur d’une signification donnée; il s’efface dans les meilleures images de Franck, et le sens s’élargit, comme libéré du regard qui l’a fait naître. Pour elle, la prise de vue implique de « s’oublier soi-même, momentanément ». C’est une déprise ou un lâcher-prise. De là, peut-être, cet art discret et silencieux du funambule. N’a-t-elle pas failli mourir deux fois en tombant alors qu’elle prenait une photo ? Son grand-père mourut ainsi, et sa grand-mère mit fin à ses jours lorsqu’elle n’était qu’une enfant. Ses images ont souvent la force et la légèreté apparente d’une conjuration réussie. Par la vertu de l’art, cette conjuration devient aussi la nôtre.
L’humanisme de Franck, si l’on tient à ce mot, n’est pas une manière attendrie de montrer notre être social – comme chez Doisneau –, ou affectif – comme chez Boubat –, mais une façon de mettre en scène notre être au monde, mystérieux, précaire et si dense en même temps. On ne manquera pas le magnifique portrait de Martine par Henri sur les cimaises du musée de l’Élysée : l’élégance – extrême – de la silhouette, le Leica en bandoulière, les mains crispées par la concentration, prête à saisir l’instant, mais le regard comme absent, et pourtant si dense, comme tourné vers l’intérieur, décidément très Piero Della Francesca. Une présence-absence qui s’impose d’elle-même, sans art ni artifice.