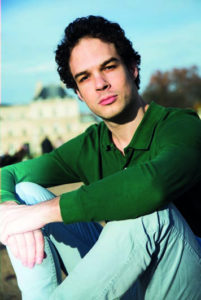En janvier s’est éteint le prodigieux Jean-Pierre Bacri. Ce Droopy franchouillard, à mi-chemin entre Jules Berry et Robert De Niro, était aussi un scénariste génial avec sa complice Agnès Jaoui. L’occasion de voir ou de revoir un de leurs chefs-d’œuvre, mis en scène par Alain Resnais : On connaît la chanson.
Quand Sabine Azéma lui demande, de sa voix de coccinelle : « Tu fais une dépression toi aussi ? », Bacri rétorque avec flegme : « Ouais, enfin j’espère. » Ce dialogue seul pourrait résumer l’emploi d’un acteur semblant incarner à chaque instant la maxime du philosophe Clément Rosset : Rassurons-nous, tout va mal. Mais ce tout va mal nous rassurait pourtant parce qu’il était vrai, et que la vérité, au cinéma comme dans la vie, fait davantage de bien que l’illusion… même quand elle est triste. À l’image de ces oncles râleurs qu’on trouve dans chaque famille, qui émeuvent aux larmes lorsqu’ils ne râlent plus. Parce qu’on croit à leur sourire. « Je suis absolument contre le côté “Je m’investis à mort dans le métier”, expliquait Bacri. Ceux qui disent : “Son père est mort et il a quand même joué le soir”, je n’admire pas du tout. Moi, mon père meurt, je ne joue pas le soir. Je suis dans la douleur. » Les grands acteurs détestent les faux-semblants.
Que raconte On connaît la chanson? Pas grandchose, c’est-à-dire la vie. On y croise une thésarde neurasthénique (le sujet de sa thèse, Les chevalierspaysans de l’an mil au lac de Paladru, est devenu culte), un agent immobilier dépressif lui aussi, mais qu’éveille la beauté de la jeune thésarde, le vilain patron de ladite agence immobilière, un vieux ménage qui s’ennuie, un autre qui se sépare… Or deux points communs réunissent le petit monde de ce film choral : d’abord des liens de parenté ou de désir, mais surtout une drôle de marotte consistant à entonner, l’air de rien, les joyaux rares ou notoires de la chanson française : de Piaf à Baker, d’Aznavour à Dutronc, de Johnny à Dalida – sans oublier les antiques Arletty, et Ouvrard. Mais si, Ouvrard, vous savez (à réciter à toute vitesse) : J’ai la rate qui s’dilate, et le foie qu’est pas droit, J’ai le ventre qui se rentre, J’ai l’pylore qui se colore…
Sur le papier, il fallait oser mêler la mélancolie urbaine à Sheila ou Cloclo, les visites immobilières à Gainsbourg et Birkin. Sans parler du défi de glisser au milieu de dialogues naturalistes des playback inopinés du genre : Quoi, d’notre amour feu n’resterait que des cendres… ou : Résiste ! Prouve que tu existes! Va, refuse ce monde égoïste! Et pourtant ça fonctionne : c’en est même grisant, on finit par attendre chaque éclosion de ces chansons que l’on connaît dans le quotidien gris de protagonistes de-venus marionnettes de l’ironie du sort, allégories de cette « âme du peuple » que constitue la chanson populaire. Dans Oh les beaux jours, Beckett prophétisait: Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste plus qu’à chanter. C’est en effet la morale du film de noter qu’à chaque chagrin correspond un air pour le sécher, un refrain pour en rire, une rengaine pour le convertir en poésie…
 Mais la poésie, chantée ou non, coule de toute façon dans les veines d’Alain Resnais, qui scrute le monde adulte en arlequin, composant ses cadres tels des tableaux burlesques. Il y a cette ouverture hilarante où le général von Choltitz refuse d’appliquer l’ordre d’Hitler de détruire Paris, motivant sa rébellion par un couplet que nous savons tous par coeur : J’ai deux amours, mon pays et Paris, par eux toujours, mon coeur est ravi… Il y a cette manière tantôt malicieuse de filmer une capitale fantasmée, digne des décors des Enfants du Paradis, tantôt raillée pour ses ubuesques projets de construction, emblèmes bourgeois de cette Vie mode d’emploi qui épouvanta Perec. Il y a enfin cette hallucination de Camille (la thésarde), soudain projetée au coeur de sa thèse – soit au bord du lac de Paladru, en l’an mil. Comme si en un claquement de doigts, les époques pouvaient s’inverser.
Mais la poésie, chantée ou non, coule de toute façon dans les veines d’Alain Resnais, qui scrute le monde adulte en arlequin, composant ses cadres tels des tableaux burlesques. Il y a cette ouverture hilarante où le général von Choltitz refuse d’appliquer l’ordre d’Hitler de détruire Paris, motivant sa rébellion par un couplet que nous savons tous par coeur : J’ai deux amours, mon pays et Paris, par eux toujours, mon coeur est ravi… Il y a cette manière tantôt malicieuse de filmer une capitale fantasmée, digne des décors des Enfants du Paradis, tantôt raillée pour ses ubuesques projets de construction, emblèmes bourgeois de cette Vie mode d’emploi qui épouvanta Perec. Il y a enfin cette hallucination de Camille (la thésarde), soudain projetée au coeur de sa thèse – soit au bord du lac de Paladru, en l’an mil. Comme si en un claquement de doigts, les époques pouvaient s’inverser.
Et pourquoi pas ? Car si les microsillons d’Henri Garat ont vieilli, l’esprit de son tube reste intemporel : Avoir un bon copain, Voilà c’qu’il y a d’meilleur au monde, Oui car un bon copain, C’est plus fidèle qu’une blonde ! Quant aux yeux des garçons – rétines et pupilles –, ils n’ont pas attendu Souchon pour aller voir sous les jupes des filles tant il est vrai, merci Léo, qu’avec le temps va, tout s’en va, tout s’évanouit. De fait, au-delà de la chanson populaire, la comédie humaine peinte par Resnais ne dépend ni d’une ville ni d’une époque : sa direction d’acteur cisèle des personnages d’une drôlerie, d’une fragilité universelles. Nulle scène sans saveur. Grâce à sa muse Azéma bien sûr, à sa formidable palette ensuite – Dussolier, Wilson, Arditi – mais également grâce à ses rôles secondaires, de Darroussin à Birkin, jusqu’à ce père extatique campé par Jean- Paul Roussillon ; inoubliable de fierté émue. Et au centre de la toile : le duo Bacri/Jaoui, à qui l’on s’entend murmurer la gorge serrée: C’était la dernière séquence, c’était la dernière séance, et le rideau sur l’écran est tombé.
Arthur Dreyfus