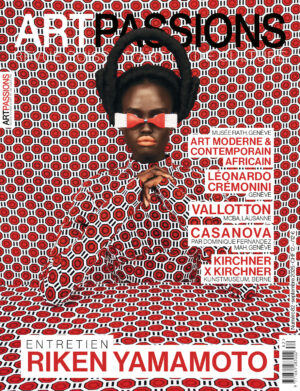Marlene Dumas, la papesse de la peinture figurative, s’expose en une rétrospective fleuve à Venise, sous les voûtes du Palazzo Grassi, retraçant sa carrière des années quatre-vingts à aujourd’hui. Une exposition bienvenue au moment où la figuration revient sur le devant de la scène et qui nous montre tout ce que doivent bien des jeunes peintres d’aujourd’hui à la science de la touche de l’artiste sud-africaine.
Cela peut paraître étrange car Marlene Dumas n’a jamais habité à Venise, mais montrer son œuvre dans la Cité des Doges revêt sans doute plus de sens que n’importe où ailleurs dans le monde: peintre de la touche, peintre de la couleur et non de la ligne ou du dessin, l’artiste sud-africaine ins-tallée aux Pays-Bas a mis depuis quarante ans son coup de pinceau au service de la chair, de l’explo-ration de sa sensualité et de ses turpitudes, d’Éros à Thanatos. Ce qui fait d’elle la digne descendante d’une grande lignée d’artistes qui a justement vu le jour à Venise, tels deux grands maîtres prénom-més Giorgione et Titien : la lignée des peintres de la pulsion, des peintres de l’amour physique, des peintres des corps désirés et désirants, à l’oppo-sé des peintres de l’amour idéal et platonicien, des artistes à la recherche du beau parfait et éthéré que sont Michel-Ange, Léonard de Vinci et les des-cendants de ces nobles Florentins (de Poussin à Rothko).
Car chez Marlene Dumas, tout commence par le sexe, ou plutôt par le regard porté sur le sexe, c’est-à-dire le désir. Les premières salles de la rétros-pective que lui consacre la Fondation Pinault au Palazzo Grassi à Venise sont entièrement dédiées à des œuvres sulfureuses, peintes dans les années mille neuf cent quatre-vingt-dix pour la plupart, et qui comptent parmi les meilleures de l’artiste. Sur les cimaises immaculées, des corps ou des por-tions de corps s’alignent, éclatantes de couleurs acidulées, des femmes principalement, un homme aussi, le sexe dressé tenu entre ses doigts : il n’y a pas d’acte sexuel mais ce n’est pas de la simple sen-sualité, ce n’est pas de la peinture de nu. Il émane de ces toiles, qui choquent les visiteurs les plus traditionalistes, quelque chose de sale, de porno-graphique, de profondément sexuel. Ces formats resserrés où s’exhibent vulves grandes ouvertes et membres en érection rappellent les lucarnes des vieux postes de télévision allumés à des heures tar-dives voire les vitrines des peep show.
Prenons Miss Pompadour (1999) : une femme à quatre pattes, qui nous tourne le dos, exhibe triom-phalement la partie la plus intime de son anatomie, ses fesses, sa vulve et son anus, en les offrant tout en rondeur au spectateur. L’ensemble est peint avec un camaïeu de couleurs suaves, sur un fond neutre et dans un format resserré qui concentre toute l’atten-tion sur ces organes sexuels aguicheurs. Les autres tableaux – comme Fingers (1999) une femme écar-tant les lèvres de son vagin avec ses doigts – sont à l’avenant. Les corps sont hypersexualisés et pour cause, l’artiste a travaillé à partir de clichés trouvés dans des magazines pornographiques. Tous ces ta-bleaux ne dépeignent jamais l’acte, on l’a dit : mais c’est bien là que réside leur puissance dérangeante. C’est le moment avant que Marlene Dumas choi-sit dans les revues X, ce moment gonflé de désir pour le corps de l’autre, qu’il soit masculin ou féminin. Le vrai sujet de l’artiste avec ces tableaux, c’est bien le désir sexuel, ce désir qui fait l’acte, qui le provoque, et qui est, finalement, le moteur le plus puissant – plus encore que l’acte sexuel lui-même – de l’amour physique. Le spectateur est le désirant, le tableau est, quant à lui, le corps désiré.
Ces images s’esthétisent grâce à son coup de pin-ceau si caractéristique et habile – qui constitue le principal intérêt de la peinture de Dumas, encore plus que ses sujets ou l’agencement de ses compo-sitions. Prenons un autre tableau érotique, Turkish Girl (1999) : dans la transparence, son pinceau parvient à rendre l’épaisseur, dans l’ébullition il trouve la tendresse et dans l’acidité des couleurs employées, qui semblent changer d’un endroit à l’autre de la même touche, il trouve une douceur profonde. Et le désir se dédouble : désir pour ces corps féminins ou masculins offerts mais aussi dé-sir pour la peinture elle-même, qui fait presque oublier le sujet. Malgré ces poses bestiales, grâce à sa science de la touche, l’artiste parvient à trans-crire ces visions crues sans vulgarité, ce qui n’est pas une mince affaire. Et c’est là l’intérêt de la peinture de Dumas, peintre de l’humanité nature et de ses passions – le sexe mais aussi la douleur, le désespoir, la peur, les excès.
Les tableaux présentés brossent pratiquement qua-rante ans de carrière, de 1984 à aujourd’hui. Née au Cap en Afrique du Sud, dans la société raciste des dernières années de l’Apartheid, elle s’installe aux Pays-Bas à vingt-trois ans, en 1976. Ses débuts coïncident donc avec ce retour en grâce de la figu-ration dans les années mille neuf cent quatre-vingts par le biais des Nouveaux Fauves en Allemagne (Baselitz, Immendorff, Penck) ou de la Figuration libre en France (Combas, Boisrond, Di Rosa). La reconnaissance vient rapidement, au cours des an-nées mille neuf cent quatre-vingt-dix. Au risque de devenir parfois répétitive, Dumas ne peint que des corps, des têtes, des membres, des figures entières, mais rarement ces personnages ont une véritable densité psychologique. Ils ne racontent pas d’his-toire – il n’y a d’ailleurs pratiquement jamais de décor ou d’arrière-plan derrière eux, ils dominent complètement l’espace. D’eux émanent plutôt des sensations, des émotions, qu’ils incarnent. Ce sont des états : leurs corps anatomisés par le coup de pinceau, par ce travail de la touche propre à Dumas, signifient le désir, la marginalité, le déses-poir, la perte de contrôle, la douleur, l’assurance de soi, l’excès – comme dans Mamma Roma (2012). Ces états, Dumas les transpose toujours depuis des images déjà existantes (photogrammes de film, images prises dans des revues, photos qu’elle prend parfois elle-même) : c’est sa manière, alors qu’elle ne représente pas grand-chose dans ses tableaux, de dépeindre la société contemporaine. Avec une attirance particulière pour ses marges. Salle après salle, on découvre des gens dont les visages et les parties de corps sont formés ou déformés par les alcools, le sexe, la souffrance et la décadence. Il y a des gros plans sur des bouches qui nous crient leur mal-être Teeth (2018), des corps qui deviennent kitsch voire grotesques (Drunk, 1997), rappelant Grosz et Dix dans le Berlin des années mille neuf cent vingt. Dumas n’est pas tendre avec les vi-sages. Ils sont laids. Elle est plus généreuse avec les seins, les sexes, les bouches, les gros plans sur ces organes qui sont les sources du plaisir (Magnetic Fields, 2008). Le corps comme matériel, car l’âme est sale, viciée – elle souffre.
Dumas est une peintre de la touche, on l’a vu. Chez elle, la construction des corps est simple, quelques lignes jetées ça et là, des couleurs rose bonbon mais qu’elle parvient à rendre nébuleuses, peu de détails et un trait de contour noir assez lâ-chement défini, comme un trait de charbon qui ne délimite pas toujours parfaitement ce qu’il retient. Certaines parties de l’anatomie sont à peine esquis-sées, la manière dont la peinture s’étale parvenant, si elle le souhaite, à brouiller le modelé et la préci-sion anatomique. À d’autres endroits, au contraire, une partie du corps ressort grâce à la concentration du trait et de la couleur – ici la vulve, là un œil, ailleurs un bras. Une économie de moyens, une mise à distance de la dimension psychologique du portrait, des couleurs irréelles, réduites à une pa-lette de tons très proches, une construction anato-mique sommaire : bien que figurative, l’abstraction n’est pas loin chez Dumas. Elle n’est jamais loin chez tous ces figuratifs des années mille neuf cent quatre-vingts et mille neuf cent quatre-vingt-dix, à l’instar de Baselitz, qui avec des moyens bien diffé-rents – une touche violente et éructante – parvient lui aussi à dire la violence des rapports émotifs ins-crits au fond de l’être humain.
Parmi toutes ces œuvres de format moyen, avec rarement plus de deux personnages, il faut par-ler de quelques grandes réalisations qui se dis-tinguent. Elles ont, elles aussi, été peintes dans les années mille neuf cent quatre-vingt-dix. Il s’agit de Groupshow (1993) et, surtout, de The Visitor ta-bleau de un mètre quatre-vingt par trois mètres exécuté en 1995, qui a été conçu pour faire chef-d’œuvre et se démarquer nettement du reste – signe d’une peintre alors pleine d’ambition. C’est une des rares œuvres de Dumas à prendre place dans un décor – une salle fermée – et donc à dé-peindre une vraie scène, instaurant une narration. Dans une pièce vue en oblique, basse de plafond, cinq prostituées représentées de dos et se tenant les mains dans le dos regardent vers une porte jaune qui semble s’ouvrir, à l’autre bout de la salle. Le visiteur est à la fois le client qui s’apprête à fran-chir le seuil et le spectateur, voyeur comme tou-jours, qui observe sans être vu ce lugubre lupa-nar aux murs sombres et au plafond si bas. Ce tableau très construit nous permet d’appréhender les sources de Dumas : il fleure bon le début du XXe siècle, par sa facture, par ses couleurs et même par son sujet. On y retrouve du Kirchner, du Van Dongen et autres fréquentateurs de cabarets de la Belle Époque. Par son thème et par sa composi-tion, il rappelle un peu à la fois le Manet d’Un bar aux Folies-Bergère et le Picasso des Demoiselles d’Avignon. Cette peinture est bien moins minima-liste que la production habituelle de Dumas, elle sort ici de sa zone de confort, chose qu’elle fait ra-rement une fois passé le cap des années deux mille, c’est-à-dire une fois la célébrité arrivée.
Dumas est en effet l’une des rares peintres figura-tives à avoir connu le succès dans les années mille neuf cent quatre-vingt-dix et à l’avoir fortifié en-suite – rappelons que ces décennies qui sont celles du triomphe du marché de l’art contemporain ont plutôt eu pour mascottes Koons, Hirst, Murakami et Cattelan, des artistes qui ne savent pas peindre. À la fin des années mille neuf cent quatre-vingt dix et dans les années deux mille, elle accumule pour-tant les expositions muséales ainsi que les acqui-sitions par les institutions les plus prestigieuses : conséquence, les grands collectionneurs jettent leur dévolu sur elle, d’autant plus qu’elle finit par entrer dans le giron de la surpuissante galerie David Zwirner, en 2008. Si elle plaît à un âge où la figuration paraît rétrograde, c’est que son esthé-tique n’est pas trop loin de la peinture gestuelle et de l’univers de l’abstrait et que sa peinture est tout sauf une peinture intellectuelle.
Mais à cette époque, à force de vouloir répli-quer la même facture, elle finit par se répéter, et se caricaturer. Elle cède à l’écueil qui est celui du peintre célèbre à l’époque du boom du marché de l’art contemporain : la facilité, la surproduction, la rapidité d’exécution, pour répondre à une de-mande pressante de la part des galeries, des clients, des institutions. On sent alors dans la manière de peindre un automatisme qui traduit peut-être une lassitude, une fatigue. Si son style reste le même, la touche est plus lâche, les superpositions de cou-leurs moins maîtrisées et ces personnages qui ne racontent pas d’histoire en perdent, de fait, leur seul force, leur seul intérêt : ils ne veulent plus rien dire, ils ne traduisent plus d’état ou d’émo-tion. C’est le problème intrinsèque d’une figura-tion qui, en réalité, ne traite pas vraiment le réel (pas de paysage, pas de mise en espace des per-sonnages, pas de narration) mais uniquement les passions humaines : dans ces œuvres des années deux mille, comme No Belt (2010-2016) ou Alien (2017), on a parfois l’impression d’une artiste qui crée des figures humaines uniquement pour éta-ler de la peinture en d’amples touches un peu po-taches afin de ne pas céder à l’abstrait. De la pein-ture pour la peinture, mais sans âme.
Reste que, au sein de cette production inégale, Dumas a eu son moment et sait parfois le re-trouver – comme avec ce portrait d’Oscar Wilde peint en 2016 où la qualité de sa touche refait sur-face. Surtout, seule figurative à la mode à un âge qui n’aimait plus la figuration, sa peinture forte-ment médiatisée a fait école et a montré la voie à bien des jeunes peintres : d’une Claire Tabouret – elle aussi exposée à Venise en ce moment – au tout jeune Simon Martin, c’est toute une généra-tion qui a repris à son compte l’exploration sen-suelle du corps humain par la touche estampillée Marlene Dumas.