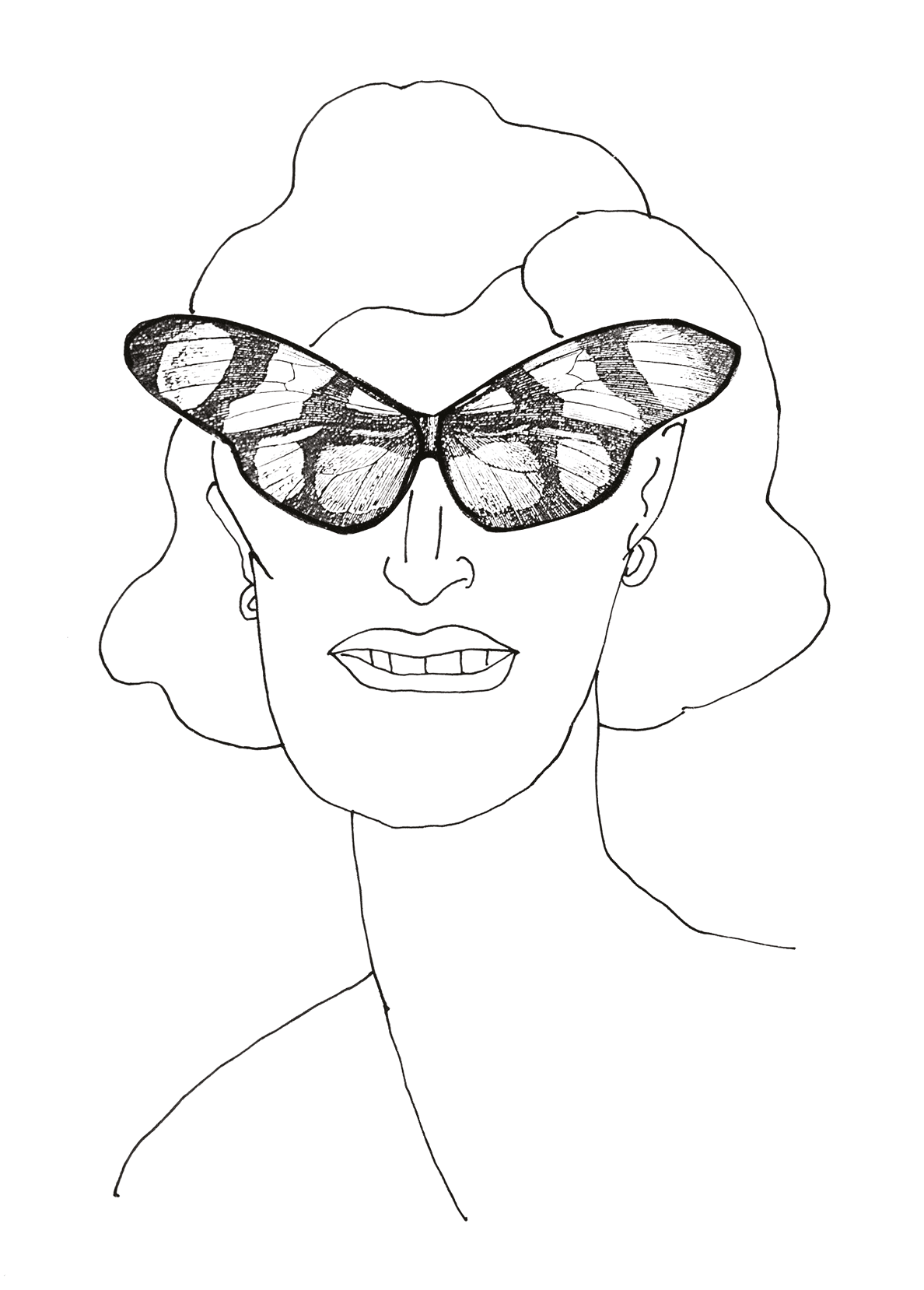Dans une ville célébrée pour ses rencontres photographiques, un festival consacré à l’image dessinée a réussi à s’imposer. Sa deuxième édition, en avril prochain, exposera aux quatre coins du fief provençal toute la richesse du tracé humain.
Pendant longtemps, les historiens crurent que la plus ancienne oeuvre d’art figurative était une statuette sculptée en ivoire de mammouth. Vieux de quarante mille ans, l’objet déterré en Allemagne personnifiait l’ancêtre de toutes les créations d’Homo Sapiens. Or coup de théâtre, en 2017 : une équipe de chercheurs australiens découvre sur la paroi calcaire d’une grotte indonésienne une « planche de bande dessinée longue de cinq mètres et ancienne de quarante-quatre siècles » – soit quatre millénaires de plus. Lascaux, avec ses juvéniles vingt mille ans, fait soudain pâle figure. Mais moins que l’âge canonique de cette B.D., c’est d’abord ce qu’elle représente qui saisit les scientifiques : une horde de chasseurs aux corps pourvus de têtes d’aigles et de lézards. Autrement dit, la preuve formelle que les hommes préhistoriques savaient concevoir des créatures imaginaires. Que le dessin, dès le départ, servit à inventer des mondes.
Frédéric Pajak, dessinateur lui-même et directeur de la merveilleuse maison d’édition Les Cahiers Dessinés, s’est fondé sur cette épiphanie pour proposer, avec Vera Michalski, un festival unique par sa diversité : « Le dessin est le premier art de l’enfance, note-t-il. Il est aussi le premier art connu de nos ancêtres. Longtemps déconsidéré au profit de la peinture et mis à l’écart, il revient en force. » Michel-Ange aurait été d’accord : « Le dessin, que d’un autre nom nous appelons trait, affirmait le génie, constitue la source et le corps de tous les genres d’art, la racine de toutes les sciences. » De fait, nul besoin de palette, de tubes ou de chevalet pour laisser sa trace : il suffit d’avoir cinq doigts, une idée, et un morceau de charbon. Est-ce à cause de cette facilité d’accès, dont fit grand cas l’art brut, que le crayon fut relégué au rébarbatif statut de petit frère du pinceau ? Le dessin est pourtant partout, des calligrammes du poète à l’encéphalogramme du médecin – dont la ligne prête vie tant qu’elle produit des formes –, de l’esquisse de mode à la caricature de presse, du modèle vivant au gribouillis.

Gribouillis qu’un certain Tomi Ungerer, l’illustrateur mis à l’honneur par le festival cette année, porta au rang de chef-d’oeuvre. Le cultissime auteur des Trois Brigands ne forgea en effet pas que des contes : sa jeunesse dans une région annexée par les nazis le convainquit tôt de se méfier des diktats, des conventions, des grades et médailles. Dans la lignée de Picasso, qui attendit le grand âge pour recouvrer son trait d’enfant, l’Alsacien laissa tremper sa plume vacillante et désabusée dans quantité d’encriers – du plus mortifère au plus pornographique. Mû toujours par cette inspiration du fond des âges, allergique à l’artifice, donc à la bienséance, et semblant sourdre du sibyllin mariage de la mine et du papier. Car un dessinateur à l’oeuvre ne pense ni avec son cerveau, ni avec ses yeux – mais avec sa main.
Ce qui explique pourquoi le tracé pur, fruit de cette main autonome, passe pour le plus personnel des langages. De toutes époques, les quarantequatre artistes dévoilés à Arles incarneront autant de styles qu’un buvard compte de taches. Soit autant de postulats sur la recette la plus adéquate pour capter le réel : Vallotton pour sa part rappelle que la lumière ne jaillit pas sans ombre. Et qu’une forme, vivante ou mécanique, ne saurait se détacher de sa contre-forme : le yin et le yang appliqués, chez lui, aux parapluies ! La gravure qu’il pratiqua assidûment ne repose-t-elle pas, au demeurant, sur un maillage de vides et de pleins ? Quant à Kokoshka, c’est comme s’il avait matérialisé en couleurs les énergies invisibles qui traversent nos existences – crainte, amour, pressentiments. Le dessin d’humour est un cas particulier, et un plaisir difficile : il ne souffre aucune approximation. Minimal, donc précis à l’extrême, il doit condenser d’un geste, tel l’acteur en scène, la substantifique moelle d’un personnage. C’est au prix de ce talent rare que le quolibet fera mouche. Wolinski, à cet égard, fut condamné à mort… pour nous avoir fait mourir de rire. Ne manquons pas de souligner que le corps humain survit mieux à un croquis, aussi féroce soit-il, qu’aux balles d’une Kalashnikov.

De l’épais trait de Dubuffet, colonisant tout l’espace de la page, à la virevoltante griffe de Giacometti, grêle comme ses statues, on aurait envie de regarder le dessin avec les lunettes du graphologue. D’y lire l’âme de celui ou celle qui l’a fait naître, tant les accidents d’une ligne convoquent, sans les artéfacts du relief, ou de la matière, le fantôme de son exécutant. D’où l’importance de se déplacer jusqu’à l’oeuvre – au lieu de se contenter de ses tristes pixels. Les Français Anne Gorouben ou Al Martin attestent chacun pour notre temps cette transcendance du tracé. La première, dans sa série intitulée Seigneur, protège les petits enfants, mue le pastel de l’innocence en mausolées monochromes et ouatés, entrelaçant au fusain l’intemporel du dessin et du destin. Plus formaliste, le second délaisse les visages pour révéler, à renfort de motifs que Yayoi Kusama ne renierait pas, l’ineffable jeu de la vie.
Qu’on ne s’étonne pas, pour finir, des accrochages de Georg Baselitz. Le fameux artiste allemand – aujourd’hui âgé de quatre-vingt-six ans – a délibérément travaillé à l’envers. Et le cadre, tout à coup, de supplanter l’objet même de la représentation, tant il est vrai que le monde d’après l’Holocauste ne tiendrait plus debout de la même façon. C’est la prémonition d’Adorno sur l’impossibilité d’écrire de la poésie après Auschwitz, étendue aux quatre bords du support le plus rudimentaire : une feuille blanche. « Je suis né dans un endroit détruit, un paysage détruit, un peuple détruit, une société détruite, répétera Baselitz. Je n’ai pas voulu réinstaurer un ordre. J’avais vu assez de soi-disant ordre. J’ai été contraint de tout remettre en question ».

Comme lors de l’édition précédente, cette balade picturale conduira les spectateurs à circuler parmi les lieux emblématiques d’Arles, du palais de l’Archevêché au musée Réattu, de la chapelle du Museon Arlaten (le musée de Provence) au musée départemental Arles antique. Manière de rappeler que l’architecture est aussi, à l’origine, un dessin. En d’autres termes : un geste d’aspect banal permettant, à la faveur de deux ou trois coups de crayon, de divulguer à autrui son monde intérieur… Lorsqu’une magie perdure depuis quarante-quatre mille ans, c’est qu’elle a une raison d’être. Qu’elle est sans doute véritablement magique.