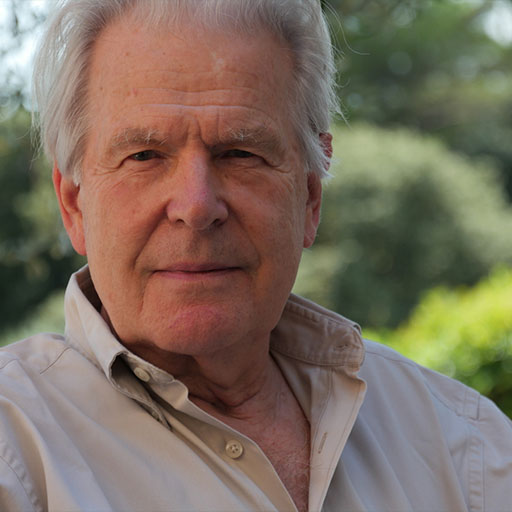Chaque semaine s’ouvre quelque part dans le monde une exposition Picasso, et ceci de façon ininterrompue depuis la mort du peintre, en 1973. Ce n’est pas le cas pour Braque, disparu dix ans plus tôt. La France gaullienne lui avait pourtant offert des funérailles nationales, l’oraison funèbre fut prononcée par Malraux. Mais la génération des contestataires a eu raison de la réputation de celui qui était devenu un grand classique de son vivant, « le patron », comme l’appelait Jean Paulhan. Si, aux États-Unis, il quitte son purgatoire dès les années 1980, notamment grâce à une grande rétrospective du Guggenheim Museum de New York, organisée par Jean Leymarie, l’exposition mise en place au Grand Palais est la première en France depuis quarante ans.
Se lançant dans la carrière au milieu des Fauves, initiateur du cubisme, inventeur des papiers collés, grand explorateur des paysages géométrisés et des natures mortes en aplats, se réclamant de Cézanne, mais également de Corot et de Chardin, ami de Picasso et de Satie, de Reverdy et de René Char, de Carl Einstein et de Jean Paulhan, Georges Braque (1882-1963) a été à la fois un précurseur participant à tous les combats d’avant-garde, ou presque, et un classique qui n’a cessé de se réclamer de la tradition : « Jeune peintre, j’ai nourri ma curiosité et mes rêves avec les œuvres des grands coloristes du passé. Depuis les Primitifs jusqu’à Van Gogh et à Boudin. Il y avait des étapes… Raphaël, Corot, Chardin entre autres… C’était tout d’abord une délectation plutôt qu’une réflexion. Le moment de la réflexion, qui fut aussi celui du choix, est venu avec la rencontre des peintures fauves de Matisse, de Derain à leur période fauve.[1]»
Formé par Léon Bonnat à l’École des Beaux-Arts de Paris, Braque découvre le Fauvisme au Salon d’automne de 1905 et participe jusqu’en 1909, avec Othon Friesz et Raoul Dufy, un autre élève de Bonnat, aux expositions du groupe. Séjournant plusieurs étés de suite à L’Estaque et à La Ciotat, il adopte très vite des couleurs d’une vivacité toujours plus éclatante. « C’est dans le Midi que j’ai senti monter en moi mon exaltation », dira-t-il plus tard. Une demi-douzaine de ses paysages fauves de L’Estaque seront présentés au Salon des Indépendants de 1907. La même année, Braque, par l’intermédiaire d’Apollinaire, fait la connaissance de Picasso et découvre dans l’atelier de ce dernier, au Bateau-Lavoir, Les Demoiselles d’Avignon. Aussitôt, il compose en guise de réponse le Grand Nu. Un dialogue unique dans l’histoire de la peinture s’installe, une révolution picturale s’est mise en marche.
À l’époque, Picasso, après des débuts éclatants soutenus par Ambroise Vollard et Berthe Weill, expose peu, ce qui n’est pas le cas de Braque. En novembre 1908, Kahnweiler lui consacre une première exposition personnelle et montre une série de paysages géométrisés. Le catalogue est préfacé par Apollinaire, qui salue avec enthousiasme – mais sans encore employer le mot – la naissance d’une peinture nouvelle, celle du cubisme : « Braque ne doit plus rien à ce qui l’entoure. Son esprit a provoqué volontairement le crépuscule de la réalité et voici que s’élabore plastiquement en lui-même et hors de lui une renaissance universelle. »
Jusqu’à la Première Guerre, les échanges entre Picasso et Braque seront quotidiens. « Nous habitions Montmartre, nous nous voyions tous les jours, nous parlions… On s’est dit avec Picasso ces années-là des choses que personne ne se dira plus, des choses que personne ne saurait plus se dire, que personne ne saurait plus comprendre.[2] » Au cours de ces cinq années, des expériences d’une audace sans précédent allaient bouleverser les fondements mêmes de la peinture telle qu’elle était pratiquée depuis la Renaissance. La perspective est abandonnée, la couleur, trop anecdotique, est remplacée par des camaïeux de gris et de beige, les formes éclatent pour retomber en facettes émiettées dans l’espace.
En 1911, Braque a l’idée d’introduire dans ses tableaux des chiffres et des lettres ; l’année suivante, il confectionne les premiers papiers collés. Il ne cesse d’explorer de nouvelles pistes dans toutes les directions, sans se soucier d’exploiter ses trouvailles. Et il réfléchit, car des deux, le théoricien, c’est lui : « Les papiers collés ont achevé de détruire magnifiquement la vision de la perspective classique, les conventions mortelles qu’elle imposait. Ces papiers, puissants, stimulants, ont aménagé une nouvelle étendue, ils ont apporté une nouvelle sensibilité à la peinture.[3] » Surtout, la couleur s’est désormais affranchie de la forme. La peinture a trouvé une totale liberté. On comprend le dépit d’Apollinaire regrettant que le poète fût réduit à se servir des mots existants.
Il est difficile, aujourd’hui, d’imaginer l’effervescence sans précédent de ces années d’avant-guerre qui virent se renouveler de fond en comble non seulement la peinture, mais aussi la musique et la littérature. Rien que le rappel de quelques-unes des grandes œuvres parues au cours de l’année 1913 donne le vertige : Alcools, La Prose du Transsibérien, Le Sacre du Printemps, Du côté de chez Swann, Le Grand Meaulnes, Jean Barois, Fantômas. Plus d’un contemporain avait l’impression de vivre une nouvelle Renaissance.
Tout s’arrête le 3 août 1914. Braque est mobilisé, envoyé sur le front de la Somme, grièvement blessé. Il ne reviendra à la peinture qu’en 1917. Pourtant, le dialogue avec Picasso, brutalement interrompu, se poursuivra, mais de façon intermittente et à distance. Si les natures mortes des années 1920 intègrent les acquis du cubisme synthétique, elles marquent aussi ce « retour à l’ordre » diagnostiqué par Cocteau dans tous les arts et qui est saisissable également dans les surprenantes Canéphores exposées au Salon d’automne de 1922. Se référant aux Nymphes de la fontaine des Innocents de Jean Goujon, symbole du classicisme à la française, elles ne poursuivent pas moins la tradition anti-académique du cubisme et de ses coloris monochromes ; en même temps elles font écho aux grandes Baigneuses de Picasso qui, lui, a repris le dialogue avec Ingres.
Picasso, qui n’avait pas été mobilisé, avait travaillé dès 1917 avec Cocteau, Satie et les Ballets russes pour Parade. Braque créera, en 1924 et 1925 les costumes et les décors pour Les Fâcheux de Bronislava Nijinska (musique de Georges Auric) et pour Zéphire et Flore de Léonide Massine (musique de Vladimir Dukelsky). Installé dans son nouvel atelier qu’avait construit pour lui Auguste Perret près du parc Montsouris, Braque partage désormais son temps entre Paris et Varengeville.
Parmi ses sources d’inspiration, la poésie et la musique prennent une place de plus en plus importante. De sa collaboration avec Satie, Reverdy, Char sont nés de nombreux livres où les notes, le texte, les formes et les couleurs s’unissent dans une sorte d’exaltation poétique. Celle-ci est également sensible dans les nombreuses natures mortes des années trente, puis dans les ateliers des années quarante et les oiseaux des années cinquante. Devenant de plus en plus abstraits, les motifs s’épurent et se réduisent en signes, en pictogrammes. Formes harmonieuses dialoguant avec l’univers, elles sont aussi annonciatrices de la nuit et de la mort. « Mélange d’extrême violence et de sérénité », c’est ainsi que Paulhan a caractérisé la peinture de celui qui retrouve enfin la place qui est la sienne.
Robert Kopp