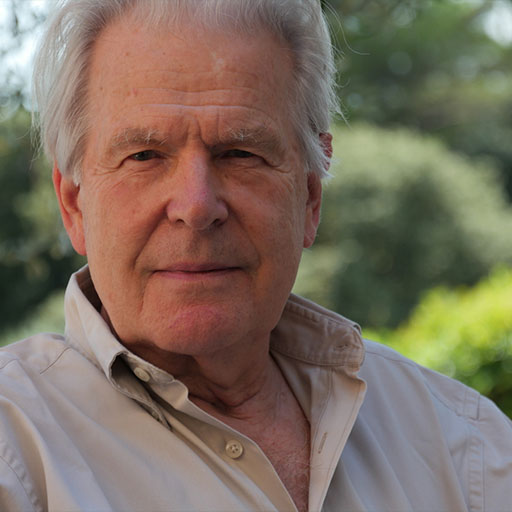En Suisse, les expositions sur Vallotton ont été nombreuses au cours des dix dernières années. Rappelons, entre autres, celles de Lausanne, en 2002, de Zurich et de Winterthour, en 2007 ou de Genève, en 2010. En France, seuls les musées de Lyon et de Marseille ont attiré l’attention sur le peintre, en 2001, avec l’exposition « Le très singulier Vallotton » dont le titre en dit long sur la place marginale qui lui a été réservée pendant longtemps dans la conscience française. Le Grand Palais et le Musée d’Orsay réparent cet oubli, le mettant enfin à sa vraie place, grâce à la première grande rétrospective organisée depuis plus d’un demi-siècle. Deux autres étapes sont prévues en 2014 : Amsterdam et Tokyo.

L’œuvre de Vallotton est aussi ample que variée : quelque 1 700 tableaux, plus de 200 gravures, des centaines d’illustrations, des pièces de théâtre, des romans, des écrits sur l’art. C’est dire, déjà, l’ambition de cet artiste à cheval entre deux pays, entre deux siècles, refusant de suivre les modes et cultivant tous les genres de la tradition picturale : peinture d’histoire, portraits, paysages, tableaux de genre, natures mortes, nus féminins, scènes d’intérieur. Une production dont Marina Ducrey et Katia Poletti ont patiemment dressé le catalogue raisonné ; elles sont, avec Guy Cogeval et Isabelle Cahn, les commissaires de la présente exposition.
Né à Lausanne en 1865, Félix Vallotton arrive à Paris, capitale encore incontestée des arts, au début de 1882, avec l’espoir de devenir un grand peintre. Il s’inscrit donc à l’académie Julian, où il est l’élève de Jules Lefebvre, ancien grand prix de Rome et célèbre pour ses nus, et de Gustave Boulanger, autre grand prix de Rome, connu pour ses scènes antiquisantes. La formation que reçoit Vallotton est des plus solides et des plus classiques. L’heure est au naturalisme, en peinture comme en littérature, au détail et à l’exécution méticuleuse. Et Vallotton excelle dans ce genre, qui lui permet aussi de renouer avec Holbein, comme le prouvent son Autoportrait à l’âge de vingt ans, de 1885, Les Parents de l’artiste, de 1886, ou La Malade, de 1892. Un métier dont bénéficiera encore l’hyperréalisme de ses dernières natures mortes.
Mais déjà, il arrive à Vallotton de faire un pas de côté, de décentrer son sujet : il donne autant d’importance au haut-de-forme qu’à son propriétaire, dans le portrait de Félix Jasinski tenant son chapeau, de 1887. Souvent, par la suite, les personnages tiendront moins de place que les meubles qui semblent envahir tout l’espace du tableau, comme cette table rouge dans Le Poker, de 1902.
Toutefois, ses œuvres, qu’il expose au Salon des artistes français, puis au Salon des Indépendants, ne lui permettent pas de vivre, et lorsque son père, suite à un revers de fortune, ne peut plus lui assurer une modeste rente, Vallotton est obligé de se tourner vers un genre plus lucratif : les illustrations pour la presse qui, grâce à la redécouverte de la xylographie, connaissent un essor considérable. La gravure sur bois lui permet de s’intéresser à Dürer, mais selon une esthétique toute moderne, à laquelle n’est pas étrangère la découverte des gravures japonaises exposées à l’École des beaux-arts en 1890.
Le succès est immédiat. Les critiques, parmi lesquels Octave Uzanne et Julius Meier-Graefe, le portent aux nues. En peu d’années, Vallotton devient l’un des illustrateurs les plus sollicités de son temps. Grâce à son ami Vuillard, il entre dans le cercle de la Revue blanche, dont il restera un contributeur important, avec Bonnard et Toulouse-Lautrec. Le Rire, hebdomadaire humoristique de Félix Juven et Arsène Alexandre, lui demande plusieurs couvertures et des pleines pages en couleur, pour lesquelles Jules Renard fournit les légendes. Le Cri de Paris le compte parmi ses collaborateurs réguliers.
Souvent, ses xylographies font l’objet d’expositions remarquées, ainsi les portraits imaginaires de Poe, de Verlaine, de Victor Hugo, ou encore les séries des Petites baigneuses ou des Intimités. Certaines pièces forment une sombre chronique de la vie moderne : La Manifestation, L’Assassinat, L’Exécution, Le Suicide, La Charge. Elles illustrent aussi le tempérament libertaire, voire anarchiste de l’artiste.
Si, au début des années 1890, la peinture semble passer au second plan, elle n’en prend pas moins une direction nouvelle, précisément sous l’influence de la gravure sur bois. Le Bain au soir d’été et La Valse, exposés en 1893 au Salon des Indépendants, au milieu des peintres nabis, marquent la rupture avec l’esthétique réaliste des débuts. Vallotton s’est libéré des contraintes de la perspective, il compose désormais ses tableaux en aplats. Que ce soient des Scènes de la rue, des Intérieurs ou des Baigneuses, toutes ces compositions ont en commun le graphisme simplifié et la stylisation des gravures sur bois. En même temps, Vallotton, qui passait pour un dessinateur dans la tradition d’Ingres, retrouve les couleurs vives de l’affiche.
En 1899, le peintre épouse la fille du grand marchand de tableaux Alexandre Bernheim. Veuve, mère de trois enfants, riche, elle fait entrer Vallotton dans une société qu’il ne connaissait que de loin. Il s’y fait, non sans exprimer parfois son impatience devant l’hypocrisie bourgeoise. L’humour et l’ironie, qui jusqu’alors avaient été réservés à la xylographie et à laquelle il renonce plus ou moins en 1902, passent maintenant dans ses tableaux, notamment ceux qui s’inspirent des grands sujets mythologiques.
Exposant avec Eugène Carrière, Renoir, Vuillard, Maillol et d’autres au Salon d’automne, dont en 1903 il est un des membres fondateurs, Vallotton fait également partie de la Sécession de Munich, de celles de Vienne et de Berlin. Sa carrière a pris une dimension internationale. En 1913, quelques-uns de ses tableaux figurent à l’Armory Show de New York.
Insensible aux modes et aux avant-gardes qui se bousculent, Vallotton trace sa route. « Mes buts ne sont guère du côté où l’on va – note-t-il dans son Journal en 1919 – et je prévois encore des déceptions publiques, néanmoins je ferai ce que je sens, […] advienne que pourra. » En effet, à l’époque des Fauves, Vallotton expose Le Repos des modèles (1905), au moment où Picasso achève Les Demoiselles d’Avignon, il présente Trois femmes et une petite fille jouant dans l’eau (1907). Quant au cubisme, il l’ignorera, tout comme le futurisme ou le retour à l’ordre.
Ce qui ne signifie pas que Vallotton n’ait pas été en prise avec l’actualité de son temps. Il fait même partie des rares peintres à dénoncer les horreurs de la Première Guerre, ainsi, dans Paysage de ruines (1915) ou dans Verdun (1917). Ou encore dans la poignante série de gravures C’est la guerre ! où sont dénoncées avec beaucoup de détails la brutalité du combat, la souffrance des militaires et des civils, la dévastation des paysages.
Et une nouvelle fois, Vallotton change de manière, avec ses paysages recomposés dans l’atelier des années 1920, Vue cavalière de la Cagne (1921), Les Andelys, le soir (1924). « Je rêve d’une peinture dégagée de tout respect littéral de la nature, je voudrais reconstituer des paysages sur le seul recours de l’émotion qu’ils m’ont causée, quelques grandes lignes évocatrices, un ou deux détails, choisis sans superstition d’exactitude d’heure ou d’éclairage », note-t-il dans son Journal. Nous sommes aux antipodes des cathédrales de Monet.
Sans doute Vallotton a-t-il payé son indépendance à l’égard des modes et des avant-gardes. Il n’a guère été défendu par les critiques qui, comme Apollinaire, ont écrit l’histoire de la peinture au XXe siècle. Lorsque Vallotton meurt, le 29 décembre 1925, la galerie Pierre venait de décrocher la première exposition de peintres surréalistes. Le vent de l’histoire avait tourné dans un autre sens.
À quoi on peut ajouter que les premiers collectionneurs de Vallotton, pour la plupart, n’étaient pas des aventuriers de l’esprit, mais des bourgeois solidement installés dans la vie helvétique. Nombre de ses tableaux sont entrés, parfois depuis longtemps, dans les musées de Lausanne, de Genève, de Berne, de Zurich, de Winterthour, de Bâle, de Glaris, de La Chaux-de-Fonds, de Soleure. Sans parler de ceux qui se trouvent dans des collections privées suisses. Quelques-uns sont aux États-Unis, quelques-uns en France. D’où la – fausse – réputation de peintre suisse qui a été faite à Vallotton, alors qu’il a passé les trois quarts de sa vie en France, qu’il s’est fait naturaliser Français et qu’il n’a cessé de clamer « mes racines sont à Paris ». Puisse-t-il définitivement trouver sa place à côté de Vuillard, de Bonnard, de Van Gogh, du Douanier Rousseau, de Derain, de Vlaminck et des autres.
Robert Kopp