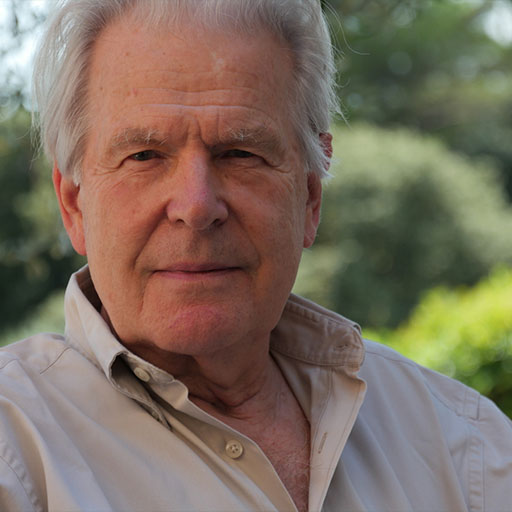Après la première grande rétrospective du MoMa, à New York, en 2002, montrée également à Chicago et à San Frncisco, après celles de la Tate Modern de Londres, en 2011, de la Nationalgalerie de Berlin et du Centre Pompidou de Paris, en 2012, sans parler des très nombreuses expositions Richter qui ont eu lieu ces dix dernières années à Dresde, Genève, Madrid, Winterthour, à Baden-Baden, à Edimbourg, à Vienne, à Duisbourg ou au Musée d’art national de Chine, à Pékin, c’est au tour de la Fondation Beyeler de présenter les multiples facettes d’une œuvre qui suscite un engouement irrépressible.
À la question de savoir en quoi réside la nouveauté de cette présentation, le commissaire de l’exposition, également l’un des meilleurs connaisseurs du peintre, Hans Ulrich Obrist, répond en soulignant d’abord l’extraordinaire richesse et la très grande variété d’une œuvre dont les débuts remontent aux années cinquante du siècle dernier. En effet, Richter a cultivé les genres les plus divers, des portraits aux paysages, des natures mortes aux toiles abstraites, des tableaux photographiques aux albums. Ainsi, les choix d’une exposition à l’autre ont-ils beaucoup divergé ; le commissaire puise désormais dans l’œuvre de toute une vie. Mais ce qui est nouveau à Bâle, c’est l’accent mis sur les séries, sur les cycles. Ce sont autant de chapelles érigées à l’intérieur de l’exposition elle-même et qui forment un contraste saisissant avec les œuvres singulières faisant office de contrepoint.

lors de la conférence de presse
organisée à la Fondation Beyeler
© Matthias Willi
C’est bien l’œuvre de toute une vie de peintre qui nous est présentée à Bâle. Né en 1932, Gerhard Richter a fait ses études à Zittau, petite bourgade située à l’est de sa ville natale, à l’extrême sud-est de la Saxe, non loin des actuelles frontières polonaise et tchèque. Si Zittau connut une première époque de prospérité grâce aux franchises accordées par les rois de Bohême, la ville fut souvent le théâtre de violents conflits territoriaux et religieux qui ravagèrent la région : Guerres hussites, Réforme, Guerre de Trente ans, Guerre de Sept Ans. Vers le milieu du XIXe siècle, des juifs s’installèrent dans la ville et se virent octroyer un cimetière et le droit de construire une morgue et une synagogue. Elles furent dynamités lors de la nuit de cristal, en novembre 1938. Et vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, des « dépendances » des camps d’Auschwitz et de Gross-Rosen furent établies à Zittau, des camps de travail forcé pour la construction d’avions Junker, les fameux bombardiers en piqué Stuka.
Rien de ce terrible passé ne transparaît, à première vue du moins, dans les tableaux souvent lisses et tout en surface de Richter. Mais l’histoire ne cesse de le hanter, elle rôde dans sa tête, elle transparaît dans certaines tentatives, le plus souvent avortées, de la saisir en dépit de son poids oppressant. Elle est d’ailleurs présente depuis toujours dans son atelier, ne fût-ce que sous la forme de ces photographies, prises en été 1944 par un déporté, à la dérobée, et qui témoignent du calvaire des victimes quelques instants avant leur exécution, à Auschwitz-Birkenau, alors que le photographe lui-même était sans doute promis à une mort prochaine. Un détail de l’une de ces photos est reproduit dans le premier Album de Richter, qui date de 1967.
Le peintre avait alors quitté la République Démocratique allemande depuis six ans, la dictature communiste lui paraissant aussi insoutenable que la dictature nazie. Il gardera de cette double expérience une aversion profonde et durable pour toutes les idéologies. Le régime lui ayant refusé l’entrée à l’École des Beaux-Arts de Dresde, Richter se forme d’abord dans l’atelier de peinture de décors du théâtre municipal de Zittau, puis comme peintre d’entreprise dans une usine de textiles. Ce ne fut qu’en 1951 qu’il fut admis à la Hochschule, où il s’est spécialisé dans la peinture murale. Rien, ou presque, ne subsiste de ses premiers travaux qui, d’ailleurs, ne figurent pas dans le catalogue de son œuvre. Beaucoup ont été détruits par l’artiste lui-même. Quant aux fresques du restaurant universitaire de l’Académie et du Hygienemuseum de Dresde, elles avaient été recouvertes, après la désertion du peintre fuyant la RDA. Le musée de Winterthour est l’un des rares établissements à avoir conservé une œuvre d’une période reniée par le peintre.

l’exposition « Gerhard Richter» à
la Fondation Beyeler, 2014
avec les œuvres: 4900 couleurs, 2007
Collection Fondation Louis
Vuitton pour la Création, Paris
© 2014 Gerhard Richter
Photo: Mark Niedermann
Ce n’est que des années plus tard, après la chute du Mur, que Gerhard Richter est retourné dans le pays de son enfance et de sa jeunesse, auquel il est pourtant resté profondément attaché. En témoignent les nombreux dons et prêts concédés aux musées de Dresde, au lendemain des catastrophiques inondations de 2002. Or, l’empreinte la plus forte que Richter a conservée de ses années de formation, c’est le rapport de la peinture à l’architecture : « J’ai toujours aimé dessiner des plans, déclare-t-il, par exemple pour de possibles appartements, mais aussi pour des maisons, même si je ne pouvais imaginer les réaliser jamais. » En 1971, Richter est allé jusqu’à dessiner des projets de tours. « Mon intention était tout à fait sérieuse. Il s’agissait de logements sociaux conçus pour les Rheinwiesen à Düsseldorf. Les bâtiments étaient composés d’unités superposées, le toit d’un appartement formant le jardin de l’appartement situé au-dessus et ainsi de suite. Je voulais savoir s’il était possible de mettre en scène des tableaux et s’il était possible d’augmenter leur impact.»
Plusieurs tableaux de ces projets de mise en scène représentent des paysages, des nuages, sujets traditionnels s’il en est. On pourrait s’en étonner. « Cela s’explique peut-être par le fait que ces sujets traditionnels, par surcroît peints à l’huile et sur toile, étaient alors totalement discrédités. Mes projets exprimaient une espèce de refus. Je me sentais un peu conforté dans ma réaction par Gilbert & George dont les travaux avaient également quelque chose de nostalgique et de néo-classique. »
Dans certaines mises en scène, les réprésentations de paysages et les nuages s’étendent du sol au plafond, pour former une sorte d’environnement englobant. Dans d’autres, les volumes sont tellement disproportionnés que le visiteur ressemble à une petite fourmi. « C’était l’époque où je travaillais avec Sigmar Polke. Nous aimions la provocation, notre opposition à l’art et à son côté sublime était totale. C’est ainsi que j’avais projeté un musée ressemblant à un bâtiment administratif ou à une caserne, avec un millier de pièces pour un millier de tableaux en gris. L’intention était de répéter dans toutes les pièces de ce musée gigantesque le même geste, un millier de fois jusqu’à l’absurde, jusqu’à la fin de la peinture. » On se fera une idée de ce projet en contemplant les huit tableaux gris conservés aujourd’hui au musée de Mönchengladbach.
La peinture de Gerhard Richter est toujours aussi interrogation de la peinture, réflexion sur la peinture et ses finalités. La série nous oblige à aiguiser notre regard, à chercher la différence dans le même, la nuance dans la répétition. En même temps, Richter pose la question de la qualité d’un tableau. Parlant de ses échanges avec Blinky Palermo, il ne cesse de répéter : « Il s’agissait de savoir ce qui était bon et ce qui ne l’était pas. Il s’agissait de juger. C’est une de nos principales aptitudes. Une autre raison de mon entente avec Palermo fut notre intérêt pour les aspects nostalgiques ou classiques de l’art. Notre exposition commune à la galerie Heinrich Friedrich, à Cologne, en 1970, en fournit un bon exemple. J’y ai présenté Deux sculptures pour un espace de Palermo. Cet espace avait quelque chose de sacré. Ce fut en quelque sorte réactionnaire, en contradiction avec l’air du temps, qui exigeait de la pertinence sociale. »
En effet, s’inscrire en faux contre l’air du temps, ce fut souvent un mobile puissant pour Richter. Après son départ de la RDA, il s’installe à Düsseldorf pour reprendre ses études, cette fois sous la direction de Ferdinand Macketanz et de K.O.Goetz. C’est ainsi qu’il expose ses œuvres dans des lieux qui, a priori, n’étaient pas destinés à les recevoir : magasins de meubles, maisons désaffectées. Si les sujets de ses tableaux ne font pas directement allusion à l’actualité, Richter ne réagit pas moins à celle-ci. Il a toujours lu la presse avec une certaine avidité, découpe et collectionne des articles, des photos surtout, se rapportant soit à des faits divers qu’il juge significatifs, soit à des événements historiques. En général, il reprend ces matériaux des années plus tard, pour les traduire en tableaux. Ainsi, en 1988 il crée la série de quinze toiles intitulées 18 octobre 1977, dans lesquelles il retravaille en les recouvrant pour mieux les faire réapparaître, les portraits des terroristes allemands Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin et Holger Meins, morts ou tués en prison. Richter se saisit ainsi d’un des épisodes les plus sombres de l’histoire allemande avant la chute du Mur.
Si l’histoire s’invite ainsi à distance dans la peinture de Richter, elle le fait après une longue maturation, on a envie de dire macération, et en quelque sorte contre la résistance de la toile blanche. Dans un texte reproduit dans le catalogue, Georges Didi-Huberman raconte sa visite à l’atelier du peintre : quatre toiles blanches sont là, des tableaux en attente, devant lesquels le peintre se trouve comme Mallarmé face à la page blanche. Si le poète, malgré ses hésitations et ses doutes, finit par arracher quelques lignes au silence, c’est souvent pour dire l’impossibilité du poème, son absence, sa néantisation. De même, le tableau est obtenu de haute lutte contre la blancheur de la toile, contre le vide de son abîme, contre la béance de son néant.
La fausse assurance des tableaux de Richter réside dans leur perfection formelle. Pour lui, malgré tout, l’idée de chef-d’œuvre existe, comme une sorte de protestation contre l’absence de chef-d’œuvre dans notre temps, comme la négation de la négation du chef-d’œuvre. Nous vivons une époque sans beauté et, pourtant, l’idée de beauté subsiste. Ainsi dans les chefs-d’œuvre du passé, dans les images de la mère à l’enfant. Des clichés ? Des tabous ? Gerhard Richter les affronte directement dans ses propres nativités, peintes sur des photographies de sa femme et de sa fille. Ainsi, la série S. mit Kind, créée dans les années quatre-vingt-dix et qui plonge au cœur même de sa vie intime, reprend l’un des motifs les plus anciens de la peinture religieuse et de la peinture tout court. Le peintre n’a pas pu ne pas désirer rivaliser avec les chefs-d’œuvre de l’histoire de la peinture. Comme Frenhofer, dans la nouvelle de Balzac, il vit dans l’obsession d’un chef-d’œuvre qui serait pour toujours inconnu.
Comment peindre sans croire à la peinture ? Comment croire à la peinture dans un temps qui a perdu toute foi ? Richter est un peintre qui doute, pour qui le doute se cristallise en peinture. Un peintre qui cherche, inlassablement, et qui expérimente toutes les formes et toutes les techniques, y compris celles qui lui semblent les plus éloignées, comme l’art du vitrail. Celui qu’il a créé pour la cathédrale de Cologne en 2006 repose sur une idée expérimentée vingt ans plus tôt dans 4096 couleurs. Onze mille cinq cents pièces de verre de soixante-douze couleurs, dont les combinaisons ont été générées par les hasards d’un ordinateur, réfractent la lumière changeante au cours de la journée. On ne saurait mieux illustrer à la fois l’aspiration à l’inconnu et la soumission au coup de dé de Mallarmé.
Peintures arrachées à la blancheur de la toile, poèmes conquis sur le silence, les œuvres de Richter symbolisent parfaitement notre époque, comme celles de Giacometti ou de Beckett. Elles respirent le courage du désespoir. « Je n’ai pas de motif, seule existe la motivation », dit Richter. Si pour Mallarmé, le sujet du poème était la poésie elle-même, pour Richter le sujet du tableau est la peinture. C’est ce qui lui permet de poursuivre sa quête.