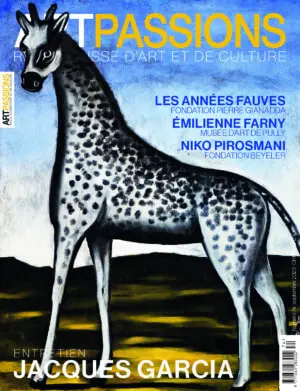[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Les photographies de Jacques Lowe sont des miraculées. Intime de Bob et de John Kennedy et photographe officieux de la Maison -Blanche, il créa les images les plus significatives du destin hors norme de JFK. Tous ses négatifs disparurent dans les ruines de Ground Zero. Mais il reste les tirages originaux qu’il fit réaliser avant sa mort en 2000, témoins saisissants du destin tragique d’un homme habité par la « Grandeur », comme l’annonçait déjà le slogan devenu fameux de sa campagne présidentielle.
[/vc_column_text][vc_column_text]
 Jacques Lowe est un miraculé. Ses photographies également. Né en 1930 d’une mère juive, il a trois ans à l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir, douze lors de la mise en place de la « solution finale » et de l’extermination de la presque totalité des Juifs d’Allemagne ; le pays dans lequel il a grandi et dont il ne connaîtra ni les écoles, ni les parcs publics. Il survit grâce à sa mère, avec qui il se cache pendant dix ans, chez des amis, puis dans des caves, échappant aux dénonciations, aux rafles, puis au chaos du Reich qui s’effondre. Il n’a jamais raconté cette enfance autrement qu’en trois lignes. Mais de ces faits et de ce silence, on comprend que cet homme est marqué par un destin d’exception. Traverser le drame et survivre. Ses images, mondialement connues, porteront la marque de celui que personne, ou presque, ne connaît. Elles offriront une vision nette, affranchie de la volonté d’imposer un style, du destin hors norme de John Fitzgerald et de Robert Kennedy, ses amis intimes.
Jacques Lowe est un miraculé. Ses photographies également. Né en 1930 d’une mère juive, il a trois ans à l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir, douze lors de la mise en place de la « solution finale » et de l’extermination de la presque totalité des Juifs d’Allemagne ; le pays dans lequel il a grandi et dont il ne connaîtra ni les écoles, ni les parcs publics. Il survit grâce à sa mère, avec qui il se cache pendant dix ans, chez des amis, puis dans des caves, échappant aux dénonciations, aux rafles, puis au chaos du Reich qui s’effondre. Il n’a jamais raconté cette enfance autrement qu’en trois lignes. Mais de ces faits et de ce silence, on comprend que cet homme est marqué par un destin d’exception. Traverser le drame et survivre. Ses images, mondialement connues, porteront la marque de celui que personne, ou presque, ne connaît. Elles offriront une vision nette, affranchie de la volonté d’imposer un style, du destin hors norme de John Fitzgerald et de Robert Kennedy, ses amis intimes.
Émigré aux Etats-Unis, Jacques s’impose vite dans le monde du photojournalisme. En 1956, il reçoit commande d’un reportage sur Robert Kennedy par trois magazines en même temps. « Bob » préside la puissante commission d’investigation contre la corruption et le racket. Il auditionne un témoin. Il a trente ans à peine. Une immense table vernie occupe la moitié de l’image et sa silhouette se découpe devant le dossier de la chaire monumentale qu’il occupe : le pouvoir. Les sénateurs qui l’assistent et qui semblent effacés derrière lui ont le double de son âge. Ils s’agitent, lui reste impassible. Ses mains sont crispées, son regard indéchiffrable se plonge dans celui de son interlocuteur, qui est à contrechamp, et qui doit à ce moment précis choisir très soigneusement ses mots, parce que le jeune homme qui l’écoute et le regarde fixement semble parfaitement maître de lui-même comme des procédures qu’il dirige – les dossiers ouverts sur la table. Une lumière crue, aveuglante, est projetée sur le « témoin ». Cette photo – la première « icône » des Kennedy produite par Lowe – fera plus tard le tour de l’Amérique puis du monde, et modèlera l’image publique du futur Attorney general (ministre de la justice) de JFK. Cet homme est la justice. L’année suivante, il s’attaquera directement à James Riddle Hoffa, président du tout puissant syndicat des camionneurs, et membre influent de Cosa Nostra. Le Destin est en marche.
 Robert se rapproche de Jacques et ils deviennent amis intimes. Le photographe passe ses week-ends en famille dans la villa de Bob. Il fait des images pour les offrir à son hôte. Parmi elles, un portrait improvisé de Jackie et de John, qu’il rencontre pour la première fois. John lui fait mauvaise impression : il a tout du jeune héritier arrogant. En grand professionnel, Lowe produit pourtant une image exceptionnelle : John tient sa fille Caroline sur ses genoux et l’enfant brise les codes du portrait officiel en prenant dans sa bouche le collier de perles de sa mère. Jackie est d’une beauté renversante et John se révèle tel qu’il est : son visage s’illumine d’un large sourire ; la chaleur, la franchise, la bienveillance. La lumière est improbable, l’image est légèrement floue, mais c’est celle-ci que Jacques offre à Bob. L’Amérique se reconnaîtra plus tard dans ce portrait au naturel qui prend le parfait contrepied de la génération qui domine encore, celle d’Eisenhower, de Truman, et même de Johnson ; celle des costumes trois pièces, des chapeaux et des épouses sexagénaires.
Robert se rapproche de Jacques et ils deviennent amis intimes. Le photographe passe ses week-ends en famille dans la villa de Bob. Il fait des images pour les offrir à son hôte. Parmi elles, un portrait improvisé de Jackie et de John, qu’il rencontre pour la première fois. John lui fait mauvaise impression : il a tout du jeune héritier arrogant. En grand professionnel, Lowe produit pourtant une image exceptionnelle : John tient sa fille Caroline sur ses genoux et l’enfant brise les codes du portrait officiel en prenant dans sa bouche le collier de perles de sa mère. Jackie est d’une beauté renversante et John se révèle tel qu’il est : son visage s’illumine d’un large sourire ; la chaleur, la franchise, la bienveillance. La lumière est improbable, l’image est légèrement floue, mais c’est celle-ci que Jacques offre à Bob. L’Amérique se reconnaîtra plus tard dans ce portrait au naturel qui prend le parfait contrepied de la génération qui domine encore, celle d’Eisenhower, de Truman, et même de Johnson ; celle des costumes trois pièces, des chapeaux et des épouses sexagénaires.
Les Kennedy ont compris la valeur de ce regard : Jacques forgera les images du règne à venir. Il accompagnera partout, et en permanence, le candidat aux élections présidentielles de 1960. Dans cette image prise à Coos Bay pendant les primaires, on voit John vêtu d’un long manteau noir, la tête inclinée et le regard perdu dans les eaux du fleuve. Son visage incliné se détache des flots noirs : que voit-il ? Il est déjà l’homme d’un destin, tragique : grand malade, il a déjà reçu quatre fois l’extrême-onction et traversé plusieurs semaines de coma ; il supporte avec peine le corset qui lui soulage le dos, ses épaules sont crispées, il est sous corticoïde, le visage légèrement boursoufflé. On lui diagnostique la maladie d’Addison, inguérissable. Mais aujourd’hui encore le doute demeure : les pathologies multiples dont il a souffert toute sa vie sont un sujet de choix pour les diagnosticiens, comme son assassinat l’est pour les historiens. Il a perdu son frère aîné à la guerre et sa sœur cadette dans un accident d’avion. On parle déjà de malédiction. Mais dans la vision catholique du monde le Mal est le plus saillant là où le Bien doit faire son œuvre. Il le sait. Malgré la douleur et les drames, il a forgé sa vision de l’Amérique et de la politique : intégrité morale, égalité raciale, justice sociale, rayonnement politique. Il n’invente rien : il veut incarner les valeurs fondamentales d’une nation enfin digne de son destin. Cette vision le porte au-delà de la souffrance. Mais toute l’Amérique n’est pas prête : on surnommera bientôt par dérision la Maison-Blanche « Camelot », en référence à la cité du roi Arthur. John et Bob en chevaliers blancs combattant le Mal au nom du Bien. Les deux frères sont des idéalistes ; ils deviennent vite irrésistibles. Mais ils sont aussi de redoutables politiques ; c’est ce qui les rend dangereux aux yeux de ceux pour qui la politique est d’abord un métier – lucratif – au service d’intérêts parfois douteux. Eisenhower le préviendra bientôt dans son discours d’adieu : « complexe militaro-industriel », « pouvoir illégitime », « danger » pour « nos libertés », etc. Une vraie tragédie est toujours annoncée.
En 1959, Jacques le photograhie lors du premier meeting de campagne des primaires démocrates : il accorde toute son attention à ses auditeurs – la bienveillance et la puissance du regard. Il est décontracté, les jambes croisées, le sourire libre. À l’arrière-plan de l’image on distingue une masse de photographes en action et un groupe d’hommes et de femmes, qui sourient et semblent captivés par le débat. Cet arrière-plan illustre la simplicité et l’efficacité du style de Lowe. John Kennedy sut trouver les mots justes partout où il passait, et surtout là où on ne l’attendait pas : sincérité, ouverture, fermeté, capacité à écouter et à convaincre. Sa hauteur de vue s’alliait à une simplicité et à une chaleur qui lui ouvraient tous les cœurs. Cette image illustre le changement de regard de Jacques : il fut peu à peu conquis par cet homme chétif, réservé, impénétrable, doué d’un charisme soudain irrésistible dès qu’il était question d’élever l’Amérique – et les Américains – à la hauteur de sa vision. John est en train de devenir JFK. Cette image sera retenue pour l’affiche de la campagne nationale, avec pour slogan: A time for Greatness. La vraie grandeur avance toujours à visage découvert.
 John bat Lyndon Baines Johnson aux primaires. Il faut maintenant négocier et aller de l’avant. Cet homme du sud aux manières grossières, narcissique et roublard, tient la majorité démocrate du Sénat et le sud du pays. Robert le hait et le méprise : Johnson a été un adversaire impitoyable et déloyal lors des primaires, n’hésitant pas à traiter John d’infirme dans ses meetings, et à s’adresser à Bob en l’appelant Sonny boy, « gamin ». Mais Bob ignore sa vraie valeur. Ancien maître d’école, Lyndon Johnson a enseigné à des classes d’enfants mexicains pauvres et rejetés – comme les Noirs – par un système social impitoyable et foncièrement raciste. Johnson hait la pauvreté plus que tout, et le racisme qui gangrène son sud natal. C’est aussi pour cela qu’il est entré en politique et John le sait. Au moment où le choix d’un vice-président doit être fait, le 14 juillet 1960, Lyndon Johnson rencontre les deux frères. Il se croit fini et joue son va-tout : il aura ce « job », quoi qu’il en coûte. Il se sert à boire sans y être invité – les manières…. Jacques est là, seul avec ces trois fauves mais on l’oublie vite. Johnson tient son verre de whisky comme une star hollywoodienne, avec deux doigts, faussement détendu, la main dans la poche. Au centre, Bobby lui jette un regard plein de haine et de défiance. Comment oser exiger quoi que ce soit ? À droite de l’image, John l’affronte, les mains sur les hanches. Mais son regard semble dire autre chose : pénétrant, lumineux – pas sympathique pour autant. Il ne dit rien mais que voit-il ? Bob ne veut pas le voir : il est aveuglé par la haine. John, lui, le sait : c’est Johnson qui lui ouvrira les portes du pouvoir et c’est lui qui fera de sa vision humaniste une réalité : la fin de la ségrégation raciale, que John veut inscrire à son agenda, et que seul un homme du sud habité par un réel souci de justice pouvait imposer ; mais aussi l’assurance maladie universelle et le combat contre la pauvreté, auquel le Sénat s’oppose depuis longtemps et que seul un vieux routier comme Johnson peut faire passer, par la ruse et l’entregent. Lyndon sera donc vice-président, malgré la haine de Robert et la défiance des libéraux du parti. JFK semble prendre cette décision historique, en silence, en avance sur les deux autres qui sont encore dans le calcul et l’affrontement, au moment précis où Jacques déclenche.
John bat Lyndon Baines Johnson aux primaires. Il faut maintenant négocier et aller de l’avant. Cet homme du sud aux manières grossières, narcissique et roublard, tient la majorité démocrate du Sénat et le sud du pays. Robert le hait et le méprise : Johnson a été un adversaire impitoyable et déloyal lors des primaires, n’hésitant pas à traiter John d’infirme dans ses meetings, et à s’adresser à Bob en l’appelant Sonny boy, « gamin ». Mais Bob ignore sa vraie valeur. Ancien maître d’école, Lyndon Johnson a enseigné à des classes d’enfants mexicains pauvres et rejetés – comme les Noirs – par un système social impitoyable et foncièrement raciste. Johnson hait la pauvreté plus que tout, et le racisme qui gangrène son sud natal. C’est aussi pour cela qu’il est entré en politique et John le sait. Au moment où le choix d’un vice-président doit être fait, le 14 juillet 1960, Lyndon Johnson rencontre les deux frères. Il se croit fini et joue son va-tout : il aura ce « job », quoi qu’il en coûte. Il se sert à boire sans y être invité – les manières…. Jacques est là, seul avec ces trois fauves mais on l’oublie vite. Johnson tient son verre de whisky comme une star hollywoodienne, avec deux doigts, faussement détendu, la main dans la poche. Au centre, Bobby lui jette un regard plein de haine et de défiance. Comment oser exiger quoi que ce soit ? À droite de l’image, John l’affronte, les mains sur les hanches. Mais son regard semble dire autre chose : pénétrant, lumineux – pas sympathique pour autant. Il ne dit rien mais que voit-il ? Bob ne veut pas le voir : il est aveuglé par la haine. John, lui, le sait : c’est Johnson qui lui ouvrira les portes du pouvoir et c’est lui qui fera de sa vision humaniste une réalité : la fin de la ségrégation raciale, que John veut inscrire à son agenda, et que seul un homme du sud habité par un réel souci de justice pouvait imposer ; mais aussi l’assurance maladie universelle et le combat contre la pauvreté, auquel le Sénat s’oppose depuis longtemps et que seul un vieux routier comme Johnson peut faire passer, par la ruse et l’entregent. Lyndon sera donc vice-président, malgré la haine de Robert et la défiance des libéraux du parti. JFK semble prendre cette décision historique, en silence, en avance sur les deux autres qui sont encore dans le calcul et l’affrontement, au moment précis où Jacques déclenche.
Jacques Lowe va continuer à jouer ce rôle singulier jusqu’à la fin tragique. Il est dans le Bureau ovale au moment où John prend, seul, une décision importante ; il est dans les salles de réunions – secrètes – au grand dam des généraux ou des hommes de l’ombre, forcés d’affronter John devant l’œil de cet allemand mutique que personne ne connaît. Car il n’est pas le photographe de la Maison-Blanche. C’est Cecil Stoughton qui produira les images officielles qui abreuveront la presse people. Celles de Jacques sont d’un autre ordre. Il est l’œil de l’histoire. Avril 1961, une semaine avant le désastre de la baie des Cochons, John discute de l’opération imminente avec le secrétaire d’État Dean Rusk et le responsable opérationnel de la CIA. Jacques prend le soin de bien se placer : parfaitement maître de lui-même, John fait corps avec le drapeau des États-Unis, juste derrière lui. Il est le pouvoir. Deux semaines plus tard, après le désastre cubain, John assumera pleinement la responsabilité de cet échec lamentable dans l’un de ses discours les plus célèbres. Sa sincérité retournera l’opinion en sa faveur. Il assume tout ce qu’il fait. Il n’a rien à cacher à l’objectif de Jacques, pas même une black operation hasardeuse, car la cause est juste : il vaincra bientôt à découvert Castro et Khrouchtchev lors de la crise des missiles, tout en évitant l’Apocalypse nucléaire dans lequel ses généraux et ses conseillers allaient le précipiter.
Jacques sera là jusqu’au bout : le jour des funérailles, il prend cette image de Jackie de profil entourée de Bob et de Ted – le cadet. Le vent d’automne plaque le voile noir de la veuve sur son visage : figure tragique, atemporelle, de la femme affrontant la mort et la trahison. Ils regardent le cercueil de John. La scène est célèbre, mais le point de vue est neuf : la dignité, l’intimité, la douleur ; et les courbes de ce visage inouï soulignées par le voile et le vent…Jackie : deux ans plus tôt Lowe l’avait saisie sur la plage de Hyannis Port, la villa familiale, sortant de l’eau, rayonnante, naturelle, presque irréelle. La beauté même, la vraie, qui ne se construit pas. Un célèbre journal de mode fera tout pour acheter cette image : Jackie est la femme. Jacques refusera toujours : elle n’est pas pour les médias, elle est pour l’histoire.
 Malgré l’incorrigible penchant de John pour les femmes, quelque chose de profond unira ces deux-là jusqu’au bout. L’amour ? le destin ? Quoi d’autre a poussé Jackie à prendre John dans ses bras puis à ramasser, au péril de sa vie, le morceau du crâne de John projeté à l’arrière de cette affreuse Lincoln noire par le troisième coup feu? Geste insensé, dérisoire, dangereux, et qu’on ne calcule pas. Elle remettra le morceau au médecin de l’hôpital Parkland, médusé, incrédule devant cette héroïne d’un autre âge, prostrée mais sublime dans son tailleur rose maculé de sang. Quoi d’autre que l’admiration et l’amour lui auraient donné la force et le génie de concevoir dans les moindres détails ces funérailles improbables dès le lendemain du drame ? Le corps de John sur un affût de canon, suivi d’un cheval noir sans cavalier paré d’une selle frappée aux armes de la Nation. Jackie a fait fixer de longues bottes noires aux étriers : apparition anachronique, inquiétante, sublime. Le fantôme de la « grandeur » passe. Jacques est là, sa main ne tremble pas. Il photographie le cercueil de John déposé à terre devant la flamme d’Arlington. Ce n’est pas celui dans lequel le Président a été ramené de Dallas, et dont les poignées, trop larges, ont été brisées par les hommes du Secret Service, hébétés, pour le faire entrer de force dans la soute d’Air Force One. Celui-ci est à l’image du protocole voulu par Jackie : sobre, cerclé d’une armature puissante où pend un large voile de crêpe noir qu’on démontera bientôt. Les ramures fraîchement coupées d’un conifère sempervirens entourent la flamme qui vacille sous le vent glacial de novembre. Jacques a sous-exposé le tirage: le parterre de gazon semble se draper lui aussi tout entier et se confondre avec le noir du deuil. Le cercueil luit sous le ciel blafard. La terre sacrée d’Arlington va s’ouvrir pour l’accueillir.
Malgré l’incorrigible penchant de John pour les femmes, quelque chose de profond unira ces deux-là jusqu’au bout. L’amour ? le destin ? Quoi d’autre a poussé Jackie à prendre John dans ses bras puis à ramasser, au péril de sa vie, le morceau du crâne de John projeté à l’arrière de cette affreuse Lincoln noire par le troisième coup feu? Geste insensé, dérisoire, dangereux, et qu’on ne calcule pas. Elle remettra le morceau au médecin de l’hôpital Parkland, médusé, incrédule devant cette héroïne d’un autre âge, prostrée mais sublime dans son tailleur rose maculé de sang. Quoi d’autre que l’admiration et l’amour lui auraient donné la force et le génie de concevoir dans les moindres détails ces funérailles improbables dès le lendemain du drame ? Le corps de John sur un affût de canon, suivi d’un cheval noir sans cavalier paré d’une selle frappée aux armes de la Nation. Jackie a fait fixer de longues bottes noires aux étriers : apparition anachronique, inquiétante, sublime. Le fantôme de la « grandeur » passe. Jacques est là, sa main ne tremble pas. Il photographie le cercueil de John déposé à terre devant la flamme d’Arlington. Ce n’est pas celui dans lequel le Président a été ramené de Dallas, et dont les poignées, trop larges, ont été brisées par les hommes du Secret Service, hébétés, pour le faire entrer de force dans la soute d’Air Force One. Celui-ci est à l’image du protocole voulu par Jackie : sobre, cerclé d’une armature puissante où pend un large voile de crêpe noir qu’on démontera bientôt. Les ramures fraîchement coupées d’un conifère sempervirens entourent la flamme qui vacille sous le vent glacial de novembre. Jacques a sous-exposé le tirage: le parterre de gazon semble se draper lui aussi tout entier et se confondre avec le noir du deuil. Le cercueil luit sous le ciel blafard. La terre sacrée d’Arlington va s’ouvrir pour l’accueillir.
Martin Luther King est assassiné lui aussi, en avril 1968 ; et puis Bob, l’ami intime, deux mois plus tard, alors qu’il allait remporter les élections et mettre un terme à la guerre du Vietnam. Jacques Lowe est écoeuré : il ne veut pas de cette Amérique-là. Il retourne en Europe et change de métier : quel autre sujet pourrait capter son regard ? Quelques années plus tard, conscient que son travail représente un trésor inestimable, il place tous ses négatifs dans le coffre d’une banque, au sous-sol de l’une des tours du World Trade Center. Il décide de réaliser et de diffuser à cent exemplaires un portfolio monumental des trente meilleures images des Kennedy, dont il supervise les tirages grand format. Il lance le processus et meurt peu après en 2000. Une trentaine de portfolios sont réalisés avant le 11 septembre 2001. On retrouve le coffre éventré, vide, des mois plus tard, dans les décombres de Ground zero. Tous les négatifs ont disparu, à jamais, et l’Amérique entre une fois de plus dans une guerre hasardeuse. Deux malédictions se sont croisées ce jour-là. Mais il reste les portfolios déjà produits, miraculés, témoins directs de l’un des moments les plus forts de l’histoire moderne.
Frédérique Möri
[/vc_column_text][vc_column_text]NOTA BENE:
Exposition Jacques Lowe Artpassions La Galerie 5, Cour Saint-Pierre, Genève
Du 8 novembre au 22 décembre 2017[/vc_column_text][vc_column_text]
Pour lire la suite de l’article…
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]