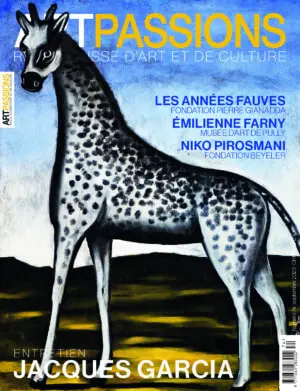Salon d’art tribal au succès grandissant, le Parcours des Mondes offre l’opportunité, rare pour le néophyte comme pour l’amateur, de découvrir des civilisations et des langages esthétiques encore méconnus. Les jeunes marchands bruxellois Patrick et Ondine Mestdagh présentent ainsi une exceptionnelle collection de pièces Aïnou (population du Nord du Japon) d’une suprême élégance.
Par Bérénice Geoffroy-Schneiter
Les nostalgiques du Musée de l’Homme, à Paris, se souviennent peut-être, avec émotion, de la petite exposition qui relatait l’extraordinaire périple que l’ethnologue et préhistorien André Leroi-Gourhan accomplit en 1938 avec son épouse Arlette au Japon, dans l’île de Hokkaïdo. Son intention précise était d’étudier les Aïnous, une ethnie d’environ 20 000 individus dont les origines, la langue et la culture constituaient une passionnante énigme pour les chercheurs. N’étaient-ils pas alors présentés comme les aborigènes du Japon ? Si l’on nuance désormais cette hypothèse, bien des clichés subsistent encore sur cette population que les soubresauts de l’Histoire ont condamnée, au fil des siècles, à l’asservissement puis à l’acculturation. Frappant les esprits par leur carrure, leur pilosité et le tatouage d’un bleu profond arboré par leurs femmes autour de la bouche, les Aïnous ont nourri bien des fantasmes, entachés parfois de racisme et d’incompréhension. En 1586, le chroniqueur lucernois Renward Cysat les décrivait en ces termes : « Là, vivent des hommes sauvages, vêtus de peaux de bêtes, le corps couvert de poils hirsutes, portant de longues barbes touffues et des moustaches démesurées qu’ils relèvent avec des bâtonnets au moment de boire. Ils aiment beaucoup le vin. Guerriers farouches et impitoyables, ils sont la terreur des Japonais. Quand ils sont blessés au combat, ils lavent leurs plaies à l’eau salée, le seul remède qu’ils connaissent. Ils portent un miroir sur la poitrine et attachent leur épée à la tête, la poignée reposant sur les épaules. Ils n’ont pas de religion et se contentent de vénérer le ciel. »
Or ce peuple de chasseurs et cueilleurs — dont le nom « aïnou » signifie tout simplement « humain » — était loin d’être une peuplade primitive dénuée d’art, de croyances et de rituels ! Il suffit d’admirer ces robes faites d’écorces mâchées et brodées de motifs géométriques, ces récipients et objets usuels sculptés dans le bois, ces spatules de libation et bâtons de prière, ou bien encore ces parures et amulettes constellées de pierres d’un bleu vif aux vertus chamaniques pour mesurer combien ces hommes et ces femmes étaient des artistes accomplis. C’est cette économie de moyens, cette pureté et ce dépouillement formel qui ont précisément séduit Patrick et Ondine Mestdagh lorsqu’ils ont décidé d’acquérir, en 2012, la collection de leur ami et confrère, le marchand américain Joseph G. Gerena, tout récemment disparu. Soit une soixantaine de pièces illustrant cette esthétique abstraite et stylisée tout à la fois, qui n’est pas sans rappeler les ornements curvilignes des céramiques Jōmon de l’archipel nippon (dont les plus anciennes remontent à 10 000 ans), les motifs totémiques des Indiens de Colombie-Britannique, ou même le répertoire des ivoires eskimos. Sans doute parce que toutes ces cultures partagent ce même amour pour l’environnement qui les a vues naître, ce lien viscéral et charnel avec les créatures vivantes (faune et flore) qui font partie de leur quotidien.
« Dans ce système de croyance profondément animiste – explique Patrick Mestdagh – les forces des esprits baptisés kamui, imprègnent tous les phénomènes naturels : l’eau, le feu, la terre, les plantes, les montagnes, les animaux terrestres et les poissons. Les esprits malveillants, quant à eux, sont tenus à distance par des rituels, comme l’utilisation de bâtons de prière finement sculptés avec des motifs en spirale de protection nommés morew. » La collection Gerena possède ainsi quatorze de ces instruments du sacré, longilignes à souhait, qu’il serait vraiment regrettable de disperser. Le plus bel exemplaire est une petite merveille d’élégance avec sa silhouette de baleine courant sur le côté…
Parmi les autres pièces tout aussi admirables, figurent ces textiles, qui, à eux seuls, ont assuré la renommée de l’art aïnou auprès des plus grands collectionneurs et marchands, comme l’Américain Thomas Murray. Patrick et Ondine Mestdagh présentent ainsi deux robes exceptionnelles, dont la sobriété de la palette s’accorde à merveille avec la force des motifs brodés. Il y a d’ailleurs quelque chose d’héraldique dans ces enchevêtrements géométriques qui semblent relever de la marque clanique ou du blason. Censés, à l’origine, repousser les influences néfastes et les mauvais esprits (maladies, blessures…), ces motifs prophylactiques variaient d’un village à l’autre et en constituaient en quelque sorte la « signature ». On retrouve la même maîtrise de l’ornementation dans ces petits sacs ou musettes en écorce d’orme destinés à transporter les aliments, mais aussi dans ces nattes tressées, d’une sobriété irréprochable. Des photographies d’archives montrent ainsi combien la maison aïnou, en dépit de son caractère « rustique », offrait un sens de l’espace et un soin accordé au moindre détail, qui ne sont pas sans évoquer le concept de « Mingeï » (soit le Beau dans l’Utile), cher aux designers nippons. L’esprit aïnou aurait-il soufflé sur l’avant-garde des créateurs japonais ?
Un même équilibre entre esthétique et fonctionnalité se devine dans cet art de la gravure sur bois, qui était l’apanage des hommes. Les jeunes garçons Aïnous ne pouvaient véritablement accéder au rang d’adulte que s’ils maîtrisaient parfaitement cette technique, outre la pratique de la pêche et de la chasse. Avec pour seul outil un couteau baptisé makiri, ils n’en réalisaient pas moins des prodiges d’élégance. Aux côtés des armes et des accessoires indispensables à la survie et à l’obtention de nourriture (haches coudées, arcs et carquois, lances pour la « fête de l’ours »), l’on découvre une profusion de plats et récipients sculptés dont, là encore, les formes trapézoïdales ou ovales évoquent irrésistiblement la table d’un grand designer !
Il serait néanmoins réducteur d’enfermer le peuple aïnou dans une image rousseauiste teintée de candeur primitive. S’ils ont été contraints par les Japonais de renier leur mode de vie, leur religion (abandon des cérémonies de mariage et d’enterrement, des rites animistes et chamaniques), leur art et leurs coutumes (dont le tatouage), les Aïnous ont commencé depuis les années soixante à se rassembler pour acquérir le « droit à la différence ». En 1994, ils parvenaient même à faire entrer un membre de leur communauté à la Kokkai, le Parlement Japonais. Depuis, plusieurs dizaines de musées et de centres culturels dédiés à la culture aïnou ont vu le jour. Il n’en demeure pas moins que la discrimination existe toujours. À l’instar de ce qu’ont vécu les Amérindiens, ceux qui n’ont pas été assimilés par la communauté japonaise sont toujours confinés dans des réserves. Nombre d’entre eux rejettent désormais le terme « Aïnou » (jugé trop péjoratif), et lui préfèrent celui d’« Utari », qui signifie « camarade ». C’est précisément celui qu’a retenu Patrick Mestdagh pour le titre de son exposition…
Utari : les Aïnous, peuple aborigène du Japon — la collection Joseph G. Gerena. Dans le cadre du Parcours des Mondes, Patrick & Ondine Mestdagh exposent au 4 rue Visconti, Paris VIe.
ENCADRÉ : « LA FÊTE DES ARTS PREMIERS »
Pour sa treizième édition, le Parcours des Mondes accueillera, au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, la fine fleur des galeries d’art tribal, mais aussi d’art asiatique et d’archéologie. Soit 68 exposants, dont la moitié viendra de l’étranger ! On notera ainsi la participation exceptionnelle de neuf marchands américains, dont les galeristes Thomas Murray et Donald Ellis. Rendez-vous est donc pris, du 9 au 14 septembre 2014, pour ce musée idéal à ciel ouvert !
Renseignements : www.parcours-paris.eu