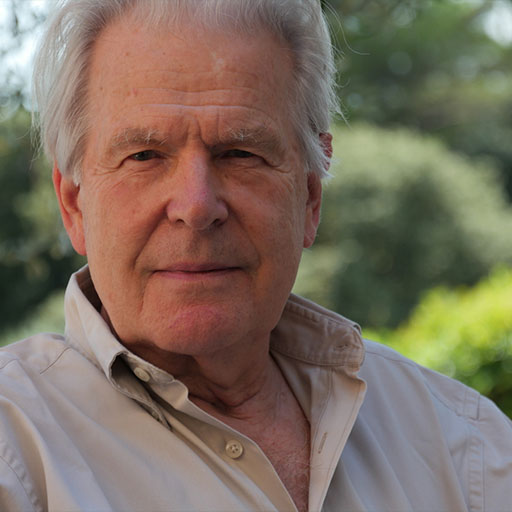Qui ne se rappelle la fameuse scène de la grande roue, dans Le Troisième Homme, et le propos désabusé d’Orson Welles : « L’Italie, sous les Borgia, a connu trente ans de terreur, de meurtres, de carnage, mais en sont sortis Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. La Suisse a connu la fraternité et cinq cents ans de démocratie. Et ça a donné quoi ? Le coucou ! » Soyons précis : la pendule à coucou est originaire de la Forêt-Noire. Pour le reste, chacun vérifiera la justesse de la réplique d’Orson Welles en visitant l’exposition « Les Borgia et leur temps» au Musée Maillol, à Paris.
Aucun des grands clans régnants dans les États italiens au XVe et au XVIe siècle n’a autant enflammé l’imaginaire collectif que celui des Borgia. Ni les Médicis de Florence, ni les Visconti de Milan, ni les Gonzague de Mantoue n’ont suscité autant d’admiration et de haine, n’ont inspiré autant de livres d’histoire, de romans, de pièces de théâtre, de série télévisées, de bandes dessinées, de mangas, de jeux vidéo. Et parmi les auteurs et les compositeurs figurent des écrivains et des musiciens de premier plan, tels Victor Hugo, Alexandre Dumas, Gaetano Donizetti, Michel Zévaco, Marcel Brion, Jordi Savall.
D’origine aragonaise, appartenant à la petite noblesse féodale, les Borgia ont connu une ascension aussi fulgurante que sanglante. Et brutale fut leur chute. L’ancêtre, Alfonso Borja, ne fut pourtant élu pape qu’à soixante-dix-sept ans, et par défaut, profitant de la rivalité de Colonna et des Orsini, qui paralysait le conclave. Habile diplomate, il avait fait carrière au service d’Alphonse V le Grand, appelé parfois aussi le Magnanime, roi d’Aragon, de Sardaigne, des Deux-Siciles, comte de Barcelone et de Roussillon. Il représente les intérêts de son prince au concile de Bâle et l’accompagne lors de la conquête de Naples. Sous le nom de Calixte III, il régna trois petites années seulement. Si elles ne suffirent pas pour lever une croisade contre les Ottomans qui venaient de prendre Constantinople, elles lui permirent toutefois de mettre sur orbite différents membres de sa famille espagnole, à commencer par son neveu et fils adoptif Rodrigo, qu’il avait fait venir en Italie pour assurer son éducation et lui faire faire des études de droit civil et canonique à Bologne.
En 1456, à l’âge de vingt-six ans, son oncle fait nommer Rodrigo archevêque titulaire de Valence et cardinal, puis vice-chancelier de l’Église romaine, alors que ce n’est que douze ans plus tard qu’il sera ordonné prêtre. Premier personnage du Saint-Siège après le pape, il acquiert une profonde expérience de la Curie et un pouvoir politique et surtout financier considérable, qui lui permettent d’entretenir une importante clientèle, tant à Rome qu’à Valence. Élu pape en 1492, à la mort d’Innocent VIII, qu’il avait contribué à faire élire, d’entente avec le cardinal della Rovere, futur Jules II, il prit le nom d’Alexandre VI. Ce fut le premier conclave qui se tint dans la Chapelle Sixtine (non encore décorée par Michel-Ange), le premier aussi où circulèrent avec insistance des bruits d’un vote acheté.
Le règne de l’argent s’était massivement installé dans l’Église et les reproches dénonçant le commerce des charges, les indulgences, le relâchement des mœurs, les enfants illégitimes reconnus et affublés dès leur plus jeune âge de dignités ecclésiastiques et de prébendes ou mariés à de grandes familles, se firent toujours plus insistants. Alexandre VI s’inscrivit dans une tradition bien établie depuis une trentaine d’années. Il faut relire le chapitre consacré à la papauté par le grand historien bâlois Jacob Burckhardt, dans La Civilisation de la Renaissance : il fourmille d’exemples attestant cette décadence : « Si Sixte IV s’était procuré de l’argent en vendant toutes les grâces et toutes les dignités spirituelles, Innocent et son fils fondèrent une banque des grâces temporelles, où le crime de meurtre pouvait se racheter au moyen de taxes fort élevées ; sur le produit de chaque amende, il y a 150 ducats pour le trésor pontifical, et le reste est versé à Francescetto. Rome pullule, notamment dans les dernières années de ce pontificat, d’assassins protégés et non protégés ; les factions, que Sixte IV avait commencé à dompter, ont partout relevé la tête ; le Pape, en sûreté derrière les murailles de son Vatican, se borne à tendre de temps à autre un piège aux criminels capables de payer. »
Rome, capitale spirituelle de la chrétienté et plus encore capitale temporelle des États pontificaux voit donc s’ériger de nouveaux édifices religieux, des musées, des places et des ponts. Et, surtout, les palais du Vatican sont sans cesse agrandis et embellis. Alexandre VI crée les appartements Borgia qu’il fait décorer par le Pinturicchio. Comme ses prédécesseurs, il fait travailler Antonio Pollaiolo, Mantegna, le Pérugin. Mais son portrait officiel est réalisé par Juan de Juanes, un peintre de Valence, son pays d’origine. Car les Borgia resteront toujours une greffe espagnole dans l’Italie de la Renaissance. « À la rigueur – dit Jacob Burckhardt – on pourrait passer ce pontificat sous silence dans un livre qui traite des formes de la culture italienne, car les Borgia sont aussi peu Italiens que la maison régnante de Naples. Alexandre s’adresse en espagnol à son fils César, même quand il lui parle en public ; lors de la réception qu’on lui fit à Ferrare, Lucrèce portait le costume espagnol, et ce furent des bouffons espagnols qui la saluèrent de leurs chants ; les serviteurs de confiance de la maison sont tous Espagnols ; de même les soldats les plus décriés de l’armée que conduisait César dans la guerre de 1500 ; son bourreau, don Michelotto, ainsi que son empoisonneur en titre, Sébastien Pinzon, semblent avoir été des Espagnols. Entre autres exploits, César abat un jour, dans une cour fermée comme une arène, six taureaux indomptés, suivant toutes les règles de l’art cher aux Espagnols. Quant à la corruption, que cette famille a portée à son apogée, elle l’avait trouvée déjà très développée à Rome. »
Si les Médicis ont su créer un style, ce n’est peut-être pas le cas pour les Borgia. Ils ont certes fait travailler les plus grands artistes de leur temps, tels le Titien ou Bellini, mais ceux-ci avaient de nombreux autres commanditaires. D’ailleurs César Borgia s’est surtout illustré comme gonfalonier à la tête des armées de son père et non pas comme protecteur des lettres et des arts. Il fut un homme de pouvoir et son plus grand titre de gloire est sans doute d’avoir servi de modèle à Machiavel.
Quant à sa sœur Lucrèce, elle mérite probablement mieux que la réputation de femme débauchée et d’empoisonneuse que lui a faite une époque peu indulgente pour les femmes et que Victor Hugo a popularisée. Mariée à treize ans pour des raisons politiques à Giovanni Sforza, puis à un fils naturel d’Alphonse II de Naples (dont la débarrassera son frère), elle connut sa période la plus glorieuse aux côtés d’Alphonse d’Este, à la cour de Ferrare. Elle est morte en 1519, à trente-neuf ans, en accouchant de son septième enfant. Le temps des Borgia était depuis longtemps révolu.