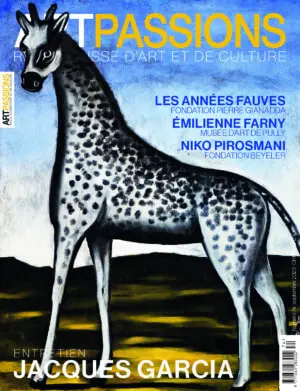La XVIe édition de la Biennale d’architecture de Venise a ouvert ses portes fin mai aux Giardini et à l’Arsenale. Elle les fermera le 25 novembre : six mois, un record pour une exposition consacrée à l’art de bâtir, soixante et onze propositions d’architectes dans l’exposition principale auxquelles il faut ajouter soixante-trois participations nationales dans les célèbres pavillons, dont, pour la première fois, la présence du Guatemala, du Liban, du Pakistan et même du Vatican. Elle a bien changé cette exposition d’architecture vénitienne depuis sa première édition, en 1980, quand elle n’était qu’une section de la Biennale d’art et qu’elle ne durait que quatre semaines. Depuis, elle est devenue aussi importante que la contrepartie artistique (organisée dès 1895) avec laquelle elle s’alterne une année sur deux. Chaque édition est confiée aux bons soins d’un ou plusieurs architectes en charge de définir un thème directeur. Aux pavillons nationaux, la plupart bâtis dans les Giardini, s’ajoutent la grande exposition à l’Arsenale, deux « sections spéciales » regroupant encore d’autres travaux d’architectes, d’autres pavillons disséminés dans la ville, des conférences, des colloques et des rencontres dans les palais de la Sérénissime : un programme dithyrambique, une matière impossible à cerner de manière exhaustive. Voici, néanmoins, un florilège partial et partiel de ce qu’il faut savoir et de ce qu’il faut voir dans la plus grande exposition mondiale consacrée à l’art de construire.
Deux commissaires et un manifeste : « L’espace libre » :
Le commissariat de l’édition 2018 a été confié à deux architectes irlandaises, Shelley McNamara et Yvonne Farrell, qui ont fondé ensemble, en 1978, Grafton Architects, leur cabinet est basé à Dublin. Elles sont connues pour leur longue carrière dans l’enseignement universitaire de l’architecture. Leur chantier le plus important se trouve à quelques deux cents kilomètres de Venise : il s’agit de la faculté d’économie de la prestigieuse université Bocconi de Milan, projet de grande ampleur (45 000 m2 de surface) pour lequel elles ont remporté le Prix du World Building of the Year, en 2008. En 2012, elles se voyaient attribuer le Lion d’argent de la Biennale d’architecture vénitienne. C’est la première fois que le commissariat général de l’exposition est confié à deux femmes. Dans le court manifeste publié un an avant le début de la Biennale, le thème qu’elles ont proposé apparaissait étonnamment large : Freespace, autrement dit « l’espace libre », terme interprété par les deux curatrices comme désignant une architecture « généreuse », qui met l’humain, la beauté du matériau et le respect de la nature au centre de la réflexion. La presse italienne s’est montrée dubitative. Un thème consensuel, trop vaste, pas assez circonscrit, qui permet, par quelques tours de passe-passe dialectiques, de s’affranchir de lui aisément. C’est bien connu, on peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres. En termes de « concept » dans le domaine artistique, c’est-à-dire de contenu discursif qui précède l’œuvre et la justifie, c’est la même chose : aujourd’hui, on peut faire dire ce que l’on veut à une œuvre. Est-ce finalement, ici, si grave ? Le fait que chacun ait pu s’arranger avec le thème général et proposer sa vision est, en vérité, un moindre mal. Ce n’est peut-être pas un hasard si les meilleurs pavillons sont ceux qui se libèrent de cette direction conceptuelle et qui, plutôt que de se couler dans le moule d’un discours verbeux sur ce qu’est un « espace libre » et « généreux », ont préféré puiser leur inspiration à la lueur de la propre expérience de leurs concepteurs. En témoignent les pavillons suisses et, de manière étonnante, celui du Vatican (à lire plus loin).
Exposer l’architecture ?
Un constat – simple – s’impose : l’architecture n’a pas vocation à être exposée. Elle a beau compter au rang des beaux-arts et ses produits être considérés comme de véritables œuvres, elle ne s’admire qu’in situ. Il y a bien des musées d’architecture : mais on y trouve surtout des plâtres moulés sur certaines parties de bâtiments ou bien des maquettes et des images. On expose des reflets ou bien des témoins isolés. À la Biennale vénitienne, on trouve cette formule classique des maquettes et des documents écrits illustrés de plans et de photographies qui expliquent un projet ou une réalisation mais aussi, et c’est son originalité, de véritables mises en scène qui essaient d’approcher le statut de l’œuvre d’art, en lorgnant du côté de l’art conceptuel, en se détournant parfois carrément de l’architecture : ainsi en est-il du pavillon nordique (qui regroupe la Norvège, la Suède et la Finlande), où sont posées sur le sol plusieurs espèces de membranes organiques alimentées par des tuyaux et contenant deux bulles cellulaires remplies d’air et d’eau, le tout représentant l’interaction de l’homme et de la nature.
Deux approches sont donc possibles : celle conceptuelle, avec des commissaires qui régissent une véritable exposition et font appel à des contributeurs divers et variés (architectes, artistes, théoriciens, écrivains etc.), et celles des architectes eux-mêmes, qui présentent leurs projets déjà construits ou en développement par des biais plus classiques. Les pavillons nationaux accueillent les propositions des premiers tandis qu’à l’Arsenale se tient l’exposition proprement dite, la mostra, où l’on voit surtout maquettes, vidéos et textes. Il est clair que depuis que sa dimension et son ambition se sont accrues, la Biennale ne traite plus uniquement de l’architecture : les expositions et projets proposés y ont souvent une visée urbanistique, sociologique et artistique.
Le Lion d’or remis au pavillon suisse :
Le pavillon suisse présente sans conteste l’exposition nationale la plus aboutie et il n’est pas surprenant qu’il se soit vu remettre la plus haute distinction de cette Biennale – c’est d’ailleurs la première fois que le pays remporte le Lion d’or à Venise. Le projet, dû à Alessandro Bosshard, Liv Tavor, Matthew van der Ploeg et Ani Katarina Vihervaara, apparaît comme une œuvre totale. C’est aussi un pied de nez à l’architecture savante. Le sujet est le design intérieur anonyme et normé des appartements modernes qui fleurissent partout dans le monde dès qu’il y a un peu de richesse. Rien de plus banal et inintéressant que ces habitations toutes similaires, au style minimal et froid. Mais, finalement, c’est bien elle l’architecture que l’on voit le plus et que l’on utilise le plus dans la vie de tous les jours.
Cependant, comment rendre digne d’intérêt cette antithèse du geste architectural –comment en faire un sujet de Biennale ? En jouant sur un principe assez simple : celui des ruptures d’échelle. Une fois passée la porte du pavillon, on se trouve confronté à des portes géantes, avec poignées en inox à l’échelle, des fenêtres minuscules, des tiroirs de cuisine grands comme une voiture puis des fenêtres qui ne donnent sur rien, d’autres portes mais tout juste assez grandes pour qu’un enfant puisse les franchir, des plafonds trop bas ou trop hauts. Le tout sans jamais dépasser une hauteur maximale de deux mètres quarante, comme le veut la norme en vigueur dans les appartements neufs en Suisse.
Avec ce parcours labyrinthique sans logique, le style Ikea blanc devient inquiétant. Aucun meuble, aucun tableau, aucune photo de famille pour accrocher le regard : c’est l’appartement encore vide, fraichement livré au promoteur et qui attend son occupant. On se croirait dans une brochure commerciale.
Par le biais de ce jeu sur les proportions, le pavillon helvétique permet d’observer sous un œil nouveau un type d’architecture qu’on voit mais qu’on ne regarde jamais, de redonner son identité à ce qui est banal, devenu invisible car tellement intégré, vécu et pratiqué tous les jours. Alors que ce n’est qu’un espace imitatif (qui transpose, en plus grand et en plus petit, un modèle déjà existant), les imbrications de formes carrées de toutes dimensions qui se succèdent sans solution de continuité rappellent l’architecture cubiste ou futuriste. Il y a aussi, bien sûr, un côté surréaliste. On pense à Alice au pays des merveilles (les enfants sont d’ailleurs les plus réceptifs de tous les visiteurs). Cette œuvre originale fonctionne car elle s’insère – étonnamment – dans un réseau de références artistiques et architecturales. Elle possède une visée esthétique en sus du pur concept et de l’aspect discursif, tout en parvenant à rendre visible l’invisible, à donner sa place à une architecture rarement commentée dans un lieu savant tel que la Biennale vénitienne.
Le mur, un sujet politique au cœur de la Biennale :
La politique s’invite à Venise. Donald Trump a promis de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique : une « œuvre » qui, si elle était édifiée, serait certainement la plus grande réalisation architecturale du XXIe siècle et une grande régression culturelle. Le mur qui divise, le mur qui sépare et met dos à dos des territoires : c’est l’exact opposé de toutes les théories contemporaines de l’architecture et de l’urbanisme, qui tentent par tous les moyens de créer du lien social, du lien économique, du lien géographique. C’est aussi l’antithèse de « l’espace libre » choisi comme thème de cette Biennale. Certains pays participants ne pouvaient pas ne pas saisir l’occasion de faire une leçon d’histoire au président américain. L’Allemagne produit ainsi une exposition très didactique – mais somme toute peu architecturale et plus urbanistique – sur ce que représente un rideau de fer divisant un pays en deux, elle qui en sait quelque chose. Le pavillon américain se devait de s’emparer du thème : toute l’exposition semble pensée comme une réponse à la politique conservatrice de Trump. L’un des sept espaces qui compose ce parcours centré sur la « citoyenneté » est intitulé « MEXUS » et consiste en un relevé, sous forme de carte géographique, de toutes les interdépendances existant entre les régions frontalières américaines et mexicaines : se dessine sous nos yeux un véritable espace transfrontalier où chaque région dépend de celle qui se trouve de l’autre côté de la frontière, un espace de continuité où les échanges nord-sud sont nettement plus importants que ceux est-ouest. L’ambassadeur américain en Italie se serait, paraît-il, étranglé en visitant cette section d’un pavillon qui ne ménage pas la majorité républicaine au pouvoir. Autre pays possédant d’ores et déjà son propre mur, Israël. Titre de son exposition : « In Statu Quo: Structures of Negotiation. »Le sujet n’est pas le mur à proprement parler mais la délicate question de l’utilisation partagée de lieux sacrés à Jérusalem par les communautés juives, musulmanes et chrétiennes et les usages spécifiques nés de cette situation où une barrière abstraite s’élève entre les peuples. Les accords politiques perpétuellement renégociés pour maintenir un statu quo ont modifié le paysage urbain de la ville. Avec un regard critique, cinq cas concrets d’altération du paysage par une architecture soumise aux besoins politiques sont abordés dans le pavillon.
L’Italie et l’archipel de l’architecture au chevet des territoires excentrés :
Le pavillon italien est, comme à chaque édition, le plus vaste. Il occupe d’anciens hangars de la marine dans le port de l’Arsenal de Venise, dans un magnifique cadre industriel où se mêle architecture de la Renaissance et du XIXe siècle. Prenant parti du grand espace à disposition, les commissaires ont choisi de dissocier aspect discursif et aspect architectural/artistique pour cette exposition nommée « Arcipelago Italia ». Dans un premier espace scandé par de grands panneaux explicatifs occupant presque toute la hauteur sous plafond, on parcourt des régions italiennes comme en feuilletant un guide Michelin : scandé en huit itinéraires, chacun à travers une région culturelle comme les Pouilles ou les Alpes occidentales, on suit une route qui relie entre eux des projets architecturaux qui ont pour point commun de se situer à l’écart des grands centres, d’être parfois bien modestes, mais d’avoir une visée sociale. Une exposition consacrée aux territoires éloignés qui envisage l’architecture comme liant social, comme placebo pour des terres abandonnées, comme médicament pour des campagnes vidées par l’exode rural, avec peu d’infrastructures et de services pour leurs habitants. Une vision parfois un peu utopiste mais qui a le mérite de faire découvrir des projets originaux hors des sentiers battus et des réflecteurs, bien loin de l’architecture savante des grandes agences. Ainsi en est-il de l’idée folle de ce paysan sicilien qui, un beau jour, décida de construire un amphithéâtre mystique et mégalithique au flanc d’une montagne de sa région. Aujourd’hui, ce lieu purement poétique est devenu une attraction populaire pour les touristes, un monument que l’on vient visiter de loin, un peu comme le palais du facteur Cheval dans la Drôme.
Dans l’autre espace du pavillon-hangar, laissé libre de toute cloisons, sur de grandes tables voici des dizaines de maquettes d’où s’élèvent l’odeur caractéristique du bois scié et collé utilisé pour les réaliser : ce sont cinq projets expérimentaux spécifiquement pensés à l’occasion de cette Biennale pour mettre en acte l’idée déjà développée dans les huit parcours à travers l’Italie.
À l’Arsenale : l’exposition principale et le V&A
Rendons nous à l’Arsenale, où se trouve l’exposition principale. Dans l’immense salle de la Corderie, longue de 315 mètres, remarquons la proposition de la britannique Alison Brooks. Elle frappe par sa recherche esthétique : c’est une grande installation en bois clair qui ressemble à une maquette géante, constituée de quatre espaces que le visiteur arpente librement. L’aspect fantaisiste des formes épurées projetées rappellent l’architecture métaphysique des tableaux de De Chirico et l’art futuriste. Elles constituent, selon l’architecte, une recherche poétique des justes proportions pour les intérieurs d’appartement, sources de beauté et donc de confort. Là où le pavillon suisse mettait en lumière l’apparence normée du design d’intérieur, Brooks tente de réinventer celle-ci, dans une direction résolument esthétisante et artistique – et utopique.
Sortons de la Corderie. Face au grand bassin de l’Arsenale se dresse une carcasse de béton qui semble être la ruine d’un bâtiment ravagé par le feu. C’est en fait une section démontée de Robin Hood Gardens, immense HLM construit par Alison et Peter Smithson en 1972 dans l’est londonien. L’architecture brutaliste des années cinquante à soixante-dix, en béton brut, sans ornement aucun, avec ses formes répétitives et massives, sans couleur et sans humanité, est peut être la plus décriée de toutes les formes de l’architecture moderne. À tel point qu’à peine quarante ou cinquante ans après leur édification, les pouvoirs publics tentent par tous les moyens de détruire les grands ensembles bâtis dans ce style. Alors vecteurs de modernité, ils sont aujourd’hui symboles d’exclusion sociale, d’enlaidissement urbain et de pauvreté. C’est le Victoria and Albert Museum qui a décidé de préserver une partie de cette célèbre verrue architecturale britannique et d’organiser une exposition à son sujet à Venise. Les défenseurs du brutalisme considèrent cet immeuble comme un chef-d’œuvre du genre, ses pourfendeurs comme l’un des pires exemples d’une architecture quasi-totalitaire. Sa démolition a débuté en 2017. Cette préservation peut sembler paradoxale, mais ce morceau du bâtiment, qu’on le veuille ou non, est un témoin d’un moment d’histoire de l’architecture et d’histoire sociale du XXe siècle : il était important de détruire Robin Hood Gardens mais tout aussi important d’en conserver la mémoire.
Les chapelles contemporaines du Vatican :
Bien qu’excentré – mais en rien exilé – dans le bois de la divine île de San Giorgio Maggiore, le pavillon du Vatican ne peut que faire parler de lui. Plus petit Etat du monde et première participation à la Biennale, le pays du pape François a vu les choses en grand. Dix architectes de dix pays – dont le britannique Norman Foster – ont chacun bâti une petite chapelle au milieu des arbres, en dehors de toute référence à l’architecture classique des églises chrétiennes telles qu’on les connaît. Voici donc dix chapelles contemporaines à l’âge où la grande architecture occidentale s’est laïcisée voire athéisée. Il y a encore quelques décennies, les bâtisseurs les plus célèbres s’intéressaient à la forme du sanctuaire religieux : pensons à Perret au Havre, au Corbusier à Ronchamp. C’est bien moins le cas aujourd’hui. L’exposition possède ainsi, presque malgré elle, un aspect polémique.
Le résultat est, de fait, assez déconcertant tant on est peu habitué à voir les architectes d’aujourd’hui mettre leurs idées radicales au service d’un art religieux. Mais après avoir visité les autres expositions nationales, il ressort que celui du Vatican est, de tous les pavillons de la Biennale, le plus purement architectural. Ici pas d’enveloppe anonyme pour abriter une exposition conceptuelle, des installations artistiques, des maquettes ou des textes, au contraire, l’œuvre ce sont les bâtiments eux-mêmes. L’idée de ces chapelles immergées dans la verdure de l’îlot lagunaire est une référence à la Chapelle dans le bois du suédois Gunnar Asplund, bâtie en 1920 dans le cimetière boisé de Stockholm, un petit sanctuaire fonctionnaliste qui constitue une sorte de prototype de l’église moderniste au XXe siècle. La forme, dépouillée, y suivait la fonction. Érigée dans les bois, il en ressortait aussi un aspect mystique et œcuménique qui se ressent fortement ici, dans le bosquet de San Giorgio – signe de la politique d’ouverture impulsée par le pape François ? Il y a quelques propositions impossibles, voire un peu kitsch (face aux deux croix d’acier scintillant de Carla Juaçaba, une posée par terre en guise de bancs, une projetée verticalement en guise d’autel, on ne peut que penser au Crucifix style Odyssée 2001 peint par Dali) tandis que d’autres sont plus fonctionnelles et minimalistes, proches de l’esprit d’Asplund. C’est le cas de la chapelle d’Andrew Berman, avec un simple banc orienté vers les arbres en guise de mobilier.
On ne peut que reconnaître qu’au sein d’une Biennale gargantuesque, où beaucoup de projets se ressemblent, ce pays sans équivalent a su se distinguer.
Tancrède Hertzog