En vingt ans, le designer français est devenu une icône. Objet ou espace, ses créations séduisent le grand public comme le luxe. De Renault à Nike, de Roche Bobois à Guerlain, en passant par Thierry Marx ou LVMH, les clients les plus prestigieux font confiance à ses courbes organiques. L’artiste nous donne rendez-vous dans son appartement-studio de la place des Victoires au cœur de Paris. Et nous accueille avec une énergie d’éternel jeune homme.
Tu as grandi à Marseille, tu vis aujourd’hui à Paris: la météo ne te déprime pas?
Bien sûr que si ! Quand j’ai débarqué, je faisais des séances UV ! Mais c’est dangereux donc j’ai arrê- té… Et je suis très privilégié : j’ai énormément de lumière. Même en hiver, mes fenêtres donnent sur cette place ouverte sur le ciel, l’une des plus pures de la capitale.
Tu as souvent évoqué ton admiration pour ton père joailler, poète et sculpteur. On dit toute- fois que pour devenir artiste, il faudrait s’oppo- ser à son père…
C’est vrai que mon père est un artiste exception- nel. Mais bien sûr, il y a eu des frictions. Du moins une envie légitime de s’émanciper, d’exister par soi-même…
Comment fait-on pour exister par soi-même, quand on est le fils d’un grand artiste?
[Silence.] On s’avance sur un terrain personnel, là. C’est jamais facile. Entre deux artistes, c’est encore plus sensible : les égos créent des étincelles. Comme beaucoup de relations père-fils, on a connu des années compliquées. Mais depuis peu on se rend compte qu’on a perdu du temps, qu’on n’a plus rien à se prouver. Donc on se retrouve, et c’est précieux.
Wilde écrit: « Toutes les femmes finissent par ressembler à leur mère: voilà leur drame. Cela n’arrive jamais aux hommes: voilà le leur.» Ressembles-tu à ton père?
Physiquement, presque des clones! Quant aux idées, j’ai hérité de son amour de l’innovation, de la mo- dernité. Dans son domaine, les bijoux, il a été le pre- mier à sculpter certaines formes, à mêler le diamant à la résine, ce qui lui a valu des succès mondiaux.
Et ta mère, elle était artiste?
Pas artiste professionnelle, mais elle a beaucoup travaillé avec mon père sur ses collections, et avec sa mère, qui était une femme importante dans la mode enfantine, une vraie styliste. Elle avait sa propre usine, à une époque où les femmes n’étaient jamais patronnes…
Pourquoi ton prénom est-il Ito?
Car mes frères s’appellent Teo et To – des prénoms qui jouent avec les lettres de notre nom de famille : Morabito. Un peu philippe-starckien, comme principe…
Ou elon-muskien.
On est d’accord.
C’est un prénom que tu aimes?
Au début, pas du tout. Parce que j’étais gardien de foot à l’école, et qu’un jour, notre capitaine lance au capitaine de l’équipe adverse : je te pré- sente mon défenseur Patrick, mon attaquant Paul, et mon goal Ito. Il n’a pas fait exprès. Sauf que c’est devenu un surnom.
En même temps, Ito Morabito, c’est un nom plastique, un vrai nom de designer!
Enfant, on veut être comme tout le monde. Je rê- vais de m’appeler Jason. [Pause.] Puis un jour, on se dit que notre prénom ne nous a pas juste été
« donné ». Qu’on doit se l’approprier.
Je reviens à ton appartement: autour de tes créations (ta bouteille Heineken, ton vase Citco), trône une collection d’œuvres variées: une sculpture de Buren, des mosaïques d’In- vader, des carreaux Jean-Pierre Raynaud, un dessin de Keith Haring… Si je devais en dé- duire ton portrait, je dirais que tu es composé de multiples cases…
J’aime bien l’idée. Parce que ta décoration, à mon sens, doit exprimer ta vie. Et que toutes ces œuvres correspondent à des rencontres. Les mo- saïques d’Invader par exemple, je ne pourrais plus les acheter. La dernière est partie à 1,3 millions de dollars aux enchères !

21 x 60 mm
© Studio Ora ïto (3D)

© Studio Ora ïto (3D)

© Studio Ora ïto (3D)

© Studio Ora ïto (3D)

© Studio Ora ïto (3D)
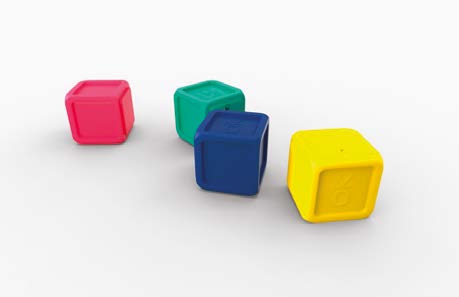
5,7 x 5,7 cm
© Studio Ora ïto (3D)
Tous les habitants des grandes capitales connaissent en effet ces mosaïques de petits aliens, façon « pixel», qu’Invader colle dans les rues. Mais qui est-il?
Je ne peux pas répondre à cette question. L’anonymat fait partie de son art. Je peux juste dire qu’il est fran- çais. Et que je le connais depuis le début. Je fais même partie de ceux qui lui ont conseillé d’établir des certificats pour ses œuvres, afin qu’elles soient reproductibles à l’infini, mais qu’il n’y ait qu’un original. Parce que les gens les décollaient pour les revendre.
Je vois aussi une belle esquisse de Vasarely – un artiste important, qui a été quelquefois dé- considéré par le marché contemporain…
Je ne dirais pas déconsidéré, mais son œuvre a été un peu abîmée par des conflits d’héritages. C’est déjà en train de changer. Et quand ça commence à changer, ça s’arrête pas. La Fondation est sublime, elle a repris son envol. Le jour où un grand galeriste dépensera trois millions d’euros pour ache- ter une pièce parce, qu’il en a dix autres en réserve, et qu’en payant cher celle-là, il donne de la valeur aux dix autres, ça sera reparti.
Le marché de l’art est aussi simpliste que ça!?
Il est en tout cas un business.
Je repère aussi sur tes étagères Charlotte Perriand, des maquettes du tramway de Nice et du métro de Marseille, que tu as conçues… Presque une collection de jouets!
[Un large sourire.] J’ai quarante-huit ans, mais si je me rase, j’ai l’air d’un gamin. Peut-être que mon métier, c’est d’être un enfant qui donne vie à ses jouets ? Parce que ces trains, ils existent réelle- ment… Il y a un côté magique, à transformer ces miniatures en wagons réels.
Petit, tu adorais les Lego. As-tu déjà dessiné de véritables jouets?
Je ne crois pas, sauf un cube-alphabet en laiton doré, composé de vingt-six formes s’emboîtant fa- çon Tetris, pour la marque Larusmiani. Un objet fou, ciselé avec un orfèvre. [Un temps.] Mais j’es- père vivre au moins cent ans : il y a encore tant de domaines que j’aimerais explorer…
Penses-tu qu’un designer s’améliore avec l’âge?
J’en suis convaincu. Mais tout est double : si au début, on est plus chaud, est-ce qu’avec l’âge, on devient plus froid ? En tout cas, le jeune designer a parfois une vision trop arrêtée des choses, qui ne fonctionne que pour lui-même. Et l’expérience fait intégrer qu’à la fin, le plus important, c’est qu’on se sente bien avec l’objet. Qu’il apporte du confort.
Je reviens au cube: tu as aussi dessiné des flacons de parfums cubiques pour la marque Okaïdi… Dirais-tu que le cube est ton « vo- lume» favori?
Ce serait plutôt la sphère. Parce que les formes les plus fortes, les plus charismatiques, sont souvent d’une extrême simplicité. Et dans la sphère il y a bien sûr cette ligne ronde, mais aussi une sorte de parfaite continuité, quasi aérienne, sans gravité.
La sphère est un volume très organique. Le corps humain est-il un bel objet de design?
Tout ce que crée la nature est du beau design. Parce qu’on est dans la fonction pure.
Quelle est la partie du corps que tu trouves la plus belle?
Le squelette, lorsqu’on y pense, est un objet ex- traordinaire. Mais je dirais les yeux. Ça raconte tout. Quelqu’un de très beau au regard vide ne m’intéresse pas, tandis qu’une femme « un peu moins belle », avec des yeux qui pétillent, qui contiennent une vie, devient très belle.
Et l’œil reste une sphère…
C’est vrai !
Le corps humain est le fruit de millions d’an- nées d’évolution. Le temps est-il long, entre l’idée d’un design, et sa réalisation?
C’est un process souvent très étendu, oui. C’est pourquoi j’ai adoré bosser avec Bompard. Je m’étais longtemps empêché d’approcher la mode, or je me suis aperçu que c’était pareil : une question d’angle, et d’expressivité de la matière. Comme lorsqu’un fabricant de meubles me donne du bois. Sauf que là, c’était du cachemire. Et donc, le temps écoulé entre le dessin et l’objet a été hyper court. Six mois je crois, ce qui était inédit et jouissif pour moi.
Ton inspiration, elle met du temps à se former?
Il y a souvent une idée spontanée, issue d’un mé- lange de références, d’analyses, qui s’impose telle une évidence. Si elle ne vient pas sur-le-champ, je sais que je vais galérer.
L’intelligence artificielle te fait peur, en tant que designer?
J’ai envie de rester positif. De penser qu’on va se servir de la technologie, plutôt que d’en être vic- times. Sans la 3D, qui m’a permis de créer mes premiers objets, je ne serais pas là. [Pause.] Après, ce qui m’ennuie, c’est que j’adore souffrir. Ce mo- ment où on ne trouve pas, où on cherche, je ne voudrais pas qu’une machine l’efface, et rende tout trop facile.
Enfin tout de même, l’IA ne va-t-elle pas « vo- ler» du travail aux nouveaux designers?
Bien sûr que si. C’est ce que je répète à mes jeunes collaborateurs : si vous restez dans votre métier tel que vous le pratiquez aujourd’hui, vous allez vous trouver face à des concurrents plus rapides que vous, plus forts, et qui n’ont pas besoin de dormir ! Il va falloir se réinventer.
J’ai l’intuition malgré tout qu’une machine ne supplantera jamais le nom d’un designer célébré…
Le nom, en effet, est primordial. Parce que les ar- tistes deviennent des marques. Anish Kapoor est une marque. Daniel Buren aussi. Ils n’aiment pas que je leur dise ça. Mais ils ont des codes, un maté- riau fétiche, un motif déclinable à l’infini ; comme le monogramme Vuitton. Le mot « marque » fait grincer des dents, or c’est pourtant notre chance, car le créateur, comme tu dis, passera avant la technologie – s’il réussit à s’inscrire quelque part.
Les chaises que tu as conçues pour Cassina ont intégré le bureau d’Emmanuel Macron. Ça, c’est de l’inscription!
Un jour, j’étais assis dans la pièce et je lui dis : « Ces chaises, tu sais que c’est moi ? » Il ne le savait pas, car c’est le Mobilier national qui gère la décora- tion de l’Élysée…
On connaît tes références du siècle passé: Niemeyer, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Jacobsen, Paulin, Bertoia… Quel art plus ancien aimes-tu?
Je suis fou d’art égyptien, d’art précolombien, d’art japonais… Les sarcophages des Pharaons, c’est plus moderne que quantité de choses ac- tuelles. Ces stèles incrustées de hiéroglyphes, les pyramides, je suis sûr que ça vient de l’espace ! Il manque juste le code-barres !
Aimes-tu aussi… des designers d’aujourd’hui?
[Rires.] J’aime plein de gens différents ! De Ronan et Erwan Bouroullec à Philippe Starck.
Comment résumer l’apport de Starck à ton domaine?
Il a élevé le design à un degré plus « glamour ». Il l’a ramené à quelque chose de très artistique, quand il était devenu très industriel. Grâce à lui, les gens savent ce qu’est un designer. En fait, il a démocratisé le design. Il l’a fait pour lui, certes – mais on en profite tous.
Aimes-tu son fameux presse-agrumes?
Je l’aime parce qu’il est génial. Et je ne l’aime pas… parce qu’il est peut-être trop génial ! C’est un objet ludique, mais pas fonctionnel. Ce qui est grandiose, c’est qu’il a été détourné de sa fonction puisqu’il se retrouve sur les étagères tel un objet de décoration ; un totem. [Pause.] De toute façon c’est un objet culte… donc la question n’est plus d’aimer ou pas.
Il y a quelqu’un qui est devenu capital dans ta vie, c’est Le Corbusier – puisqu’en 2013, tu achètes le toit-terrasse de l’embléma- tique Cité Radieuse à Marseille, pour y fonder MAMO, un espace dédié à l’art contemporain.
Le Corbusier n’est pas « devenu » important. La Cité Radieuse m’a toujours fasciné. Enfant, je col- lectionnais déjà des bouquins sur Le Corbusier.
Comment choisis-tu les artistes qui s’y exposent?
Ils doivent pouvoir faire dialoguer leurs œuvres avec l’architecture. Ça peut être un dialogue d’op- position comme de fusion, mais il faut qu’il se « passe » quelque chose à cet endroit.
J’imagine que les habitants de la Cité sont heureux du projet?
Comme dans toute copropriété, il y a les pour et les contre. Mais copropriété n’est pas le bon mot. La Cité Radieuse est plutôt un immense village, compacté dans un paquebot de béton. Et donc le Centre d’art a relancé un truc super fort: d’un coup, le monde en- tier s’est mis à parler de l’édifice qui s’est retrouvé classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, et Marseille a été classée ville de l’année par Wallpaper! Certains se sont réjouis de ces coups de projecteur, du public que ça attirait, d’autres ont un peu râlé. C’est naturel.
Ton nouveau projet marseillais se situe sur l’une des îles du Frioul: le magnifique fort de Brégantin va devenir un centre dédié à l’écologie. Est-ce pour soigner ta culpabilité de conce- voir tant d’objets qui, en fin de compte, polluent?
C’est vrai, je participe à l’encombrement global. Mais la motivation du projet n’est pas là. C’est parce que ça me passionne de mêler des artistes, des architectes, des urbanistes et des scientifiques pour essayer d’améliorer ce monde. Il y a sur cette île une dimension mystique, sauvage, isolée de la civilisa- tion mais proche de la ville, qui la rend unique.
Parlons d’un pays moins méditerranéen: quel est ton rapport à la Suisse?
J’adore la Suisse ! L’esthétique suisse, le design suisse, le graphisme suisse. [Ito s’amuse de son propre en thousiasme.] Pour être plus précis, j’aime cette es- pèce de propreté, de rigueur, de simplicité, d’efficacité qu’on rattache à la Suisse. Même si j’avoue que Genève me déprime un peu. Quand j’arrive je suis ravi d’être là, c’est un petit conte de fées. La vue est sublime, tout est beau, tout est bon. Mais au bout de trois jours… je crois que je préfère les villages enneigés comme Gstaad ou Saint-Moritz. Et Lausanne. J’allais souvent à l’ECAL donner des conférences avec Pierre Keller. Il me manque, de- puis sa mort en 2019. J’adorais ce mec.
Tu as beaucoup collaboré avec une maison suisse: Vacheron Constantin.
Ça a démarré d’une façon inimaginable. Un beau matin, l’horloger me propose de poser pour une campagne de pub, en tant que jeune designer. C’est une expérience sympa que j’imaginais éphémère. Sauf que je deviens leur égérie mondiale, pendant huit ans. À New York, en Corée, à Hong Kong, en une des magazines, partout ma photo. Ils pouvaient se payer Brad Pitt, c’est ma gueule qu’ils affichaient. Je me demandais : pourquoi moi ?
C’est pourtant un choix malin : au lieu de mettre en avant un acteur, une pure image, la maison honore un créateur en phase avec son exigence, un esthète.
Peut-être, mais le choix était risqué. Même si leur ADN est d’être exclusif, élitiste. Vacheron Constantin produit bien moins de montres que Patek Philippe, ou Audemars Piguet. Je dois leur dire merci, car cette campagne mondiale a beaucoup contribué à me faire connaître.
Et t’a fait gagner un peu d’argent…
[Ito sourit.] Oui, un peu.
Sais-tu pourquoi ils ont diffusé ta campagne aussi longtemps?
Un jour j’ai osé interroger le PDG, qui est pas- sé chez Cartier depuis. J’avais peur de sa réponse, mais il a été hyper élégant. Il m’a dit : « Ne pen- sez pas que c’est grâce à vous, mais vous avez fait partie d’une équation vertueuse. » Parce qu’entre cette photo et aujourd’hui, la maison a doublé son chiffre, dépassant le milliard. Donc c’est comme un groupe de rock avec le batteur, le guitariste, le chanteur : quand ça vibre bien, pourquoi changer quelque chose ?
Au bout de huit ans, tu as enfin fini par dessi- ner pour cette maison…
Oui parce que dans mon contrat d’image, je n’avais pas le droit de créer une montre pour une autre maison, et j’en avais envie. La marge de manœuvre étant limitée, je trouve ça stimulant. Donc on en a parlé, et j’ai réfléchi à une réinterprétation de la mythique Patrimony. Ça a plutôt bien marché : les cent exemplaires sont tous partis en deux jours.
Tu as aimé collaborer avec leurs artisans?
C’était inoubliable. Parce qu’on parle vraiment de très, très haute horlogerie. Mais de toute fa- çon, entrer dans une manufacture, pour moi, c’est mieux que de visiter un pays.
Qu’as-tu découvert que tu ignorais?
Que la haute horlogerie, c’est vivant. Comme un corps. Avec un cœur qui bat tout seul.
Tu ne dessines pas que de petits objets: j’en viens à ta splendide réinvention de la R17. Ce projet automobile verra-t-il le jour?
A priori non, même si j’ai envie d’y croire encore. Mais c’est pas grave, parce que le prototype roule, qu’il est bien réel, et que je l’ai conduit !
D’une certaine façon, on rejoint les « objets imaginaires» qui ont lancé ta carrière: une fausse bouteille de Coca-Cola, un faux sac Louis Vuitton…
Il y a de ça. C’est une invention qui n’existera sans doute pas, mais qui a fait le tour du monde. Et qui a changé énormément de choses pour moi : en banlieue, des peintres en bâtiment qui n’ont rien à foutre du design me reconnaissent, parce que ce sont des passionnés de bagnole !
Pourquoi n’existera-t-elle pas?
Parce que l’industrie automobile, c’est ultra com- plexe. Presque autant que l’horlogerie. Pour chaque décision, il faut l’aval de cent personnes. Aucun de- signer n’a réussi à créer un modèle industriel. Sauf peut-être Pininfarina, mais la carrosserie était déjà leur corps de métier.
Depuis peu, tu développes un travail per- sonnel de plasticien – intitulé Grammatology. Cette facette purement artistique va-t-elle prendre le pas sur le reste de ta vie?
Le temps de créer ces pièces, oui. Mais ces œuvres sont surtout pour moi un moyen d’explorer mon abécédaire volumique, de délimiter mon inspira- tion, si je retire la fonction. Rien que des formes. Des couleurs. À la racine de ma créativité.
Une sorte d’étape-laboratoire…
Exactement. Qui me servira à élaborer d’autres projets, à partir des principes plastiques que j’ai posés. Comme un carnet de recherche.
Accepterais-tu de designer des armes?
Non, même si l’esthétique militaire me subjugue ! Un tank, une kalachnikov, un beretta, tout est
beau. Même une caisse de munitions, c’est beau. Mais dessiner des choses qui serviront à tuer des gens, ça m’ennuierait. [Pause.] Après, c’est facile d’avoir de hauts principes. Si demain ma boîte coule, est-ce que je finirai par faire des compro- mis ? Pour l’instant, j’en ai peu fait.
Et ton propre tombeau? Tu voudrais l’imaginer?
Je repense à Pierre Keller : les Bouroullec lui ont conçu une stèle admirable. Mais la pierre tombale de demain, ce sera plutôt un iPhone géant, une plaque de verre teinté. Et quand tu te pencheras, apparaîtra la vie du défunt. On pourra lui poser des questions et discuter avec lui, parce qu’une IA aura pigé qui il était, et son arrière-petit-fils pour- ra venir lui demander des conseils : « Est-ce que je dois me marier avec cette fille ? » – « Rappelle-moi ton prénom, mon enfant, parce que nous ne nous sommes jamais rencontrés… »
Après la mort, la vie! Pourquoi n’as-tu pas en- core designé… un enfant?
Parce qu’un enfant, ça se fabrique à deux ! J’ai souffert, petit, du divorce de mes parents. Donc je veux être sûr de trouver la bonne personne. Il n’y a pas de plus grande responsabilité que d’être père. L’objet n’a pas besoin de ton aide pour être heu- reux ! Il vit sa vie, avec ou sans toi. L’enfant, il faut être là pour lui, pour toujours.

























