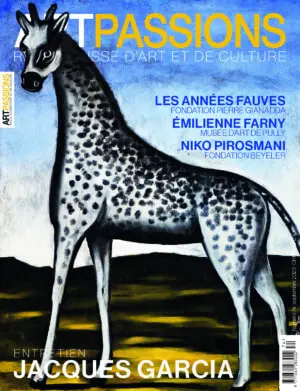Deux cents œuvres de Toulouse-Lautrec sont réunies au Grand Palais, dans une exposition visant à la fois à réinscrire l’artiste et à dégager sa singularité.
Les biographies regorgent souvent de rapports de cause à effet hasardeux qui n’ont d’autre justification que l’imagination débridée du biographe. Pas impossible en revanche qu’il y en ait un entre le quasi nanisme de Toulouse-Lautrec, né à Albi en 1864, et l’alliance incestueuse de ses parents. C’est qu’il fut un temps, dans la noblesse, où l’on se mariait entre soi – meilleur moyen que l’on avait trouvé pour éviter la partition des terres et des biens –, et ces mariages successivement contractés accouchaient d’une progéniture à la santé fragile et délicate, doux euphémismes pour qualifier des enfants débiles, ou infirmes, ou disgracieux – ou les trois : il n’est qu’à voir la cour d’Espagne au « siècle d’or », et les portraits sans concessions qu’en fit Velázquez : fronts fuyants, mâchoires prognathes, et dans les regards cette impression troublante qu’il n’y a jamais eu la lumière à tous les étages.
Les Toulouse-Lautrec étaient une des plus vieilles familles nobles de France, ils n’échappaient pas à la règle des mariages consanguins : les grandsmères d’Henri étaient sœurs, ses parents cousins germains, et lui fut dès l’enfance affligé d’une maladie osseuse héréditaire : ses fémurs étaient si fragiles que les jambes s’arrêtèrent de pousser. Il ne dépassa jamais le mètre cinquante-deux.
Ces considérations sur la taille de l’Albigeois relèveraient de l’anecdote un peu triviale et seraient dépourvues du moindre intérêt si toutefois elles n’avaient joué sur sa vocation de peintre : « Je n’aurais jamais été peintre, disait-il, si mes jambes avaient été un peu plus longues. »
L’art pictural, chez les Lautrec, est affaire de famille : « Quand mes fils abattent un canard sauvage, plaisantait la grand-mère, ils en tirent un triple plaisir : celui du fusil, celui du crayon, celui de la fourchette. »
C’est à elle, la grand-mère, qu’un peu plus tard son petit-fils écrira : « Ah, chère grand-Maman, que vous faites bien de ne jamais vous adonner à ce point à la peinture. C’est pire que la latin quand on veut le faire sérieusement comme je le veux. »
C’est donc investi d’une véritable ambition esthétique qu’il commence à dessiner puis à peindre. D’abord des chevaux, sans doute pour se consoler de ne plus pouvoir les monter. Viennent ensuite, sous l’influence de l’impressionnisme de Millet, paysages et paysans.
Puis il part pour Paris, rejoint l’atelier de Bonnat puis celui de Cormon, parodie Le Bois sacré de Puvis de Chavannes, où il se représente de dos – tournant le dos à l’art figuratif.
Paris, c’est surtout Montmartre : Lautrec y habite la maison où Degas avait son atelier. Montmartre, ce sont surtout les cabarets, les estaminets, les cafés où l’on accroche ses toiles en espérant décrocher le gros lot. Ce sont aussi les moulins : celui de la Galette, qu’a peint Renoir en 1876, et l’autre, le Moulin-Rouge, où Lautrec immortalise La Goulue, Jane Avril et Valentin le désossé. Ce sont enfin les maisons-closes.
On a souvent reproché à Lautrec de mépriser les valeurs de sa classe, de négliger le marché de l’art, d’exploiter le monde de la nuit parisienne et du sexe tarifé, en le regardant de haut. La libération des formes et la verve satirique du meilleur de l’œuvre, a-t-on dit, en seraient la preuve. À cette vision conflictuelle de sa modernité, l’exposition qui se tient au Grand Palais se propose d’en substituer une autre, plus positive.
Car Lautrec, c’est avant tout la peinture comme religion : « J’étais toujours ému, a pu dire Vuillard à son propos, de la façon dont il changeait de ton quand on commençait à parler d’art. Lui qui dans toute autre occasion était tellement cynique et tenait des propos grivois, devenait alors d’un sérieux absolu. »
Sérieux qu’il a peut-être ce jour de 1887. Lautrec a vingt-trois ans. Il est attablé dans un café avec un Hollandais qu’il a rencontré quelques mois plus tôt dans l’atelier de Cormon. Le Hollandais est un peu plus âgé que lui – trente-quatre ans. Il est aussi un peu plus grand – un mètre soixante-dix. Leurs feutres luisent sur la table, juste à côté des verres d’absinthe. Lautrec ôte son binocle, avec un chiffon l’essuie. Il caresse sa barbe noire. Il a un carton, des bâtons de pastel, il se dit pourquoi ne pas tirer le portrait du rouquin – car il est roux, le Hollandais, et Lautrec le fait roux, avec la barbe rousse qu’on lui connaît. Le rouquin est de profil, il songe peut-être à Arles où bientôt il ira, Arles où Michon nous dira, deux siècles plus tard, dans l’incipit de Vie de Joseph Roulin, qu’il « y vint parce qu’il avait lu des livres ; parce que c’était le Sud où il croyait que l’argent était moins rare, les femmes plus clémentes et les ciels excessifs, japonais ». Pour l’instant le rouquin n’a pas encore fui, il est là, il pose pour Lautrec et Lautrec, magistral, nous donne en quelques coups de pastel le meilleur portrait de Van Gogh.
La toile est exposée parmi deux cents autres au Grand-Palais jusque début 2020. Il faut aller la voir pour mesurer combien Lautrec est grand.
François-Henri Désérable