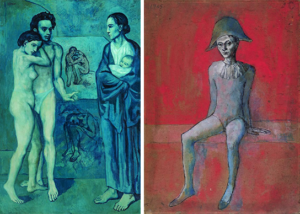Le naufrage de la magnifique utopie soviétique des années postrévolutionnaires engloutie sous la dictature stalinienne a été une des plus grandes tragédies de l’histoire des arts. C’est ce que montre l’exposition « Rouge » du Grand Palais.
1915 : c’est le fameux Carré noir de Malévitch. Mais c’est encore un tableau : le carré noir est entouré d’une bande blanche. 1921 : c’est Pur rouge de Rodtchenko, un carré peint entièrement en rouge. Octobre 1917 est passé par là. Rouge n’est pas seulement la couleur de la nouvelle ère, pur rouge signifie que c’est le dernier tableau, qu’après celui-ci il n’y aura plus de peinture de chevalet, forme d’art bourgeoise, faisant partie des « macchabées artistiques ». Adieu à l’art séparé de la vie, à l’art réservé aux connaisseurs, aux élites : il s’agit maintenant de rendre artistique la vie quotidienne, par un bouleversement radical de toutes les formes d’art. L’art doit descendre dans la rue et suivre le rythme effréné de la Révolution. Le reportage instantané, la présentation brute des faits deviennent plus importants que la composition. Au cinéma, Dziga Vertov impose le documentaire improvisé, tandis qu’Eisenstein applique dans Le Cuirassé Potemkine (1925) le « montage des attractions » qu’il rend du premier coup célèbre. Chaque usine se dote d’un club de lecture. Dans les cantines, on diffuse de la musique classique. Les machines deviennent un thème esthétique.

La photo, le photomontage, l’affiche, voilà ce qui doit remplacer le tableau. L’affiche est sans doute avec le cinéma l’apport le plus original de la culture soviétique à ses débuts. Maïakovski, principal producteur des « fenêtres Rostra », explique ce qu’est cette nouvelle forme d’art : « des nouvelles télégraphiques converties sur-le-champ en images », lesquelles sont imprimées en deux ou trois couleurs, avec quelques personnages-types, l’ouvrier, le garde rouge, le pope, le koulak. Certaines de ces affiches consistent en des signes graphiques presque abstraits, comme celle où Vladimir Lebedev fait valser les hauts-de-forme des capitalistes bousculés par les travailleurs en casquette (Le Fantôme rouge du communisme se déplace à travers l’Europe).
Les peintres ne tardèrent pas à protester. Dès 1924, la Société des artistes de chevalet fut fondée à Moscou, suivie, en 1926, par le Cercle des artistes à Leningrad. Alexandre Deïneka, né en 1899, est sans doute le peintre le plus remarquable de cette époque. Il peint des chantiers de construction, des Mineurs avant la descente dans la mine, des soldats, des sportifs, en personnages stylisés qui dépassent de loin la figuration réaliste. Piotr Williams, né en 1902, campe dans Installation d’un atelier des ouvriers qu’il floute pour rendre l’enthousiasme de leur engagement.

Soit, dira-t-on. Mais tout cela, n’est-ce pas du matériel de propagande ? Le moi des artistes, ce qu’ils ont de personnel à dire, est-il définitivement banni ? Il suffit de gratter un peu le vernis officiel des œuvres pour découvrir un message clandestin, jamais avoué évidemment. Il y a longtemps qu’on a décrypté les sous-entendus phalliques des films d’Eisenstein. Même chose pour les statues de soldats, de marins, de sportifs, à l’érotisme patent, dressées dans les stations du métro de Moscou. Même chose aussi chez les peintres. Le vétéran Kouzma Petrov-Vodkine (né en 1878) y va, en 1925, d’une Fantaisie qui montre un garçon sur un cheval rouge. En 1925, le garçon est complètement habillé, régime puritain oblige. En 1912, le même garçon était tout nu sur son cheval. Le fantasme homosexuel est encore plus patent chez Deïneka, qui, en 1935, au moment où le carcan de la répression se referme, ose peindre, dans Donbass, la pause-déjeuner, cinq jeunes garçons tout nus, sexe au vent, s’ébrouant sur la plage.
Autre domaine où la culture soviétique a innové avec éclat : l’architecture, la décoration des intérieurs, la philosophie du logement. On proclame que l’ère de la séparation entre art et industrie, entre le beau et l’utile, est révolue. Les plus grands noms s’en mêlent. Malévitch fabrique des services à thé, Tatline et Rodtchenko des meubles transformables et multifonctionnels, le lit convertible en armoire. Lissitsky révolutionne l’art typographique. On invente un nouveau style de tissus. Cet immense chantier destiné à réaménager la vie quotidienne s’appelle « productivisme ». En architecture, c’est le fameux « constructivisme ». Les grands maîtres ne construisent plus des hôtels particuliers ou des églises, mais des « condensateurs sociaux », maisons « communes » aux volumes spectaculaires, qui englobent un club, une bibliothèque, une salle de sport, une piscine. Dans ce domaine aussi, l’utopie se donne libre cours. L’immense palais des Soviets, projeté sous forme d’une tour gigantesque, n’est jamais réalisé. Mais les sept gratteciel de Moscou ont été bâtis. Ils pointent dans le ciel leur massive majesté, même s’ils sont moins beaux que dans l’aquarelle de Tchetchouline et Rostkovsky, rêve de pierre que n’auraient pas désavoué un Monsu Desiderio ou un Piranèse. Et le métro de Moscou, construit à partir de 1931, reste le seul métro au monde dont les stations, ornées de voûtes célestes, de mosaïques à fond doré, de statues de marbre ou de bronze colossales, ont la splendeur de cathédrales. Quel contraste avec l’enfournoir à bestiaux parisien !
Toutes ces formes d’art, on le voit, sont très éloignées du « réalisme socialiste », formule à laquelle on a l’habitude de réduire l’ensemble de la période communiste. Ce triste éteignoir n’a été imposé, peu à peu, qu’après 1930. L’exposition du Grand Palais n’occulte pas ce bannissement de l’utopie au profit d’un cinéma et d’une peinture de pure propagande, qui multiplient les célébrations conventionnelles de Lénine et de Staline. N’oublions pas pour autant les dix années de glorieuse avant-garde.