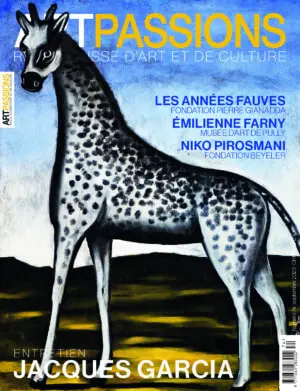Le commissaire-priseur Simon de Pury est depuis cinquante ans un acteur central du marché de l’art. Surnommé le « Mick Jagger du marteau », le Suisse est connu pour ses ventes spectacles. Témoin privilégié des évolutions du marché et de l’explosion de l’art contemporain, l’ancien directeur des collections du baron Thyssen à Lugano, puis de Sotheby’s Europe et enfin propriétaire de Phillips pendant dix années, s’intéresse aujourd’hui à de nouveaux domaines : des ventes caritatives à l’art digital en passant par les ventes aux enchères au bénéfice des galeries d’art. Retour sur sa carrière, sa vision de l’évolution du marché et ses perspectives futures.
Vous avez été l’un des principaux témoins des évolutions du marché de l’art mondial depuis les années soixante-dix, c’est-à-dire depuis près de cinquante ans. Qu’est-ce qui a le plus changé sur cette période ?
La principale différence est que le marché de l’art est maintenant accepté par les institutions finan-cières comme ce qu’on appelle en anglais un « alter-native asset class », une catégorie d’investissements alternatifs. Il y a cinquante ans, les institutions fi-nancières regardaient le marché avec une forte sus-picion alors qu’aujourd’hui elles ont souvent leur propre département d’investissement dans l’art, sponsorisent les foires et prêtent même contre des œuvres d’art. Malgré cela, même dans sa globali-sation actuelle, le marché demeure limité par rap-port à ce qu’il pourrait être. L’intérêt pour l’art est universel, comme l’est celui pour la musique : chaque personne dans le monde réagit par rapport à la musique. Ce devrait être la même chose pour l’art. Or, beaucoup de personnes se sentent intimi-dées et illégitimes pour parler d’art et, a fortiori, pour travailler dans le monde de l’art. Par rapport aux années soixante-dix, si le marché s’est beau-coup élargi, il est encore loin d’avoir atteint son véritable potentiel. Si on regarde les listes des in-dividus les plus fortunés publiées chaque année, il est toujours intéressant de voir le pourcentage de ceux qui collectionnent vraiment : cela peut pa-raître surprenant, mais beaucoup des plus fortunés de la planète ne s’intéressent pas à l’art. Il y a en-core une très grande marge de progression. Cette évolution va se faire dans les vingt ans à venir. Et je pense que certaines nouveautés, dans le domaine de l’art digital notamment, vont permettre à un public plus large d’avoir accès au monde de l’art.
Justement, par rapport à l’art digital, vous qui avez toujours côtoyé les belles choses, les œuvres des plus grands artistes du XXe siècle, croyez-vous vraiment aux NFT (Non Fongible Token) comme à une forme valable d’art et à un domaine qui a un vrai avenir devant lui ?
Je le pense, oui. Nos enfants et petits-enfants passent beaucoup de temps sur des univers digi-taux, notamment des jeux vidéos, où ils dépensent d’ailleurs de l’argent – celui de leurs parents – pour acheter des objets eux aussi digitaux. Quand ils seront adultes, ces enfants ne seront donc pas dérangés par le fait d’acheter des œuvres d’art di gitales. On parle toujours du marché de l’art, mais il y a de très nombreux marchés de l’art : les mai-sons de ventes ont jusqu’à quatre-vingt-huit caté-gories de collections différentes et le nombre de ces catégories ne cesse d’augmenter. Dès que vous avez confiance en l’unicité d’une œuvre d’art, elle devient éminemment « collectionnable ». Prenons un exemple : la photographie existe depuis le XIXe siècle mais ce n’est que dans les années soixante-dix que Christie’s et Sotheby’s ont ouvert des dé-partements dédiés à ce domaine. Quand ils l’ont fait, tout le monde s’est moqué d’eux : com-ment une photo, qui peut être multipliée à l’in-fini, pourrait-elle se vendre ? Mais graduellement, au cours des années quatre-vingts, certains grands photographes ont commencé à réduire le nombre de leurs tirages. Au lieu de tirer cent exemplaires, ils ont édité des tirages de trois ou six photogra-phies, voire des tirages uniques. Cela a instauré la confiance : un collectionneur savait que la photo qu’il achetait n’existait que trois ou six fois. Et c’est à ce moment-là que le marché a explosé. Ce qui a fait exploser les NFT, ce n’est donc pas l’invention du NFT mais le fait qu’un NFT (de Beeple, ndlr) se soit vendu chez Christie’s pour soixante-neuf millions de dollars en 2021. C’est ce qui a provoqué la ruée vers l’or. Et comme à chaque fois qu’il y a une fièvre excessive, celle-ci finit par baisser au bout d’un moment, comme c’est le cas actuelle-ment pour les NFT. Mais l’art digital est là pour durer. Si vous arrivez à créer de la confiance chez les collectionneurs, en leur assurant que quand ils achètent une œuvre digitale celle-ci sera unique ou à tirage limité, le marché va se consolider et de nombreuses personnes vont se mettre à collection-ner. L’art digital est simplement un domaine de plus de l’art où les artistes peuvent s’exprimer et un domaine de plus pour les collectionneurs pour collectionner. Il y a toujours eu de nouveaux do-maines de collection – ainsi que des domaines qui disparaissent, comme celui des timbres-poste par exemple. Le marché reflète l’époque.
Mais, pour moi, la question principale qui se pose ici est celle de la durabilité physique de cet art di-gital : est-ce que l’évolution technologique per-mettra de présenter ces œuvres d’art aussi bien dans le futur qu’aujourd’hui ? Ce sont des ques-tions qui se posent aux restaurateurs, car la tech-nologie évolue rapidement. Qui nous dit que dans vingt ans les supports (écrans, logiciels etc.) seront encore les mêmes?
Remontons à vos débuts. Vous avez grandi à Bâle dans les années cinquante et soixante, ville que vous décrivez dans votre autobiogra-phie Commissaire-priseur (2016) comme la ca-pitale mondiale des collectionneurs à l’époque. Est-ce encore une ville de première impor-tance pour la collection, alors que les princi-paux acheteurs sont maintenant arabes, asia-tiques ou américains. Est-ce que ce foyer n’a pas quelque peu perdu de sa superbe ?
La Suisse en général continue d’être un pays avec une forte densité de collectionneurs d’art contemporain. Et c’est un foyer qui se renouvelle, il n’est pas compo-sé que de gens qui ont démarré il y a cinquante ans, comme moi. Ce sont souvent les enfants ou petits-enfants de ces mêmes gens qui reprennent le flam-beau et l’intérêt pour la collection. En premier lieu, je dirais que proportionnellement à la taille du pays, la Suisse a un nombre d’artistes qui ont du succès à l’international bien plus élevé que la plupart des pays. C’est aussi dû au fait que, proportionnellement à d’autres endroits, la Suisse a de très nombreux collec-tionneurs d’art contemporain privés, qui soutiennent ce foisonnement. Et il ne faut pas limiter cela uni-quement à Bâle, c’est la Suisse dans son ensemble qui reste un pôle majeur – principalement la Suisse alémanique avec Zurich, Soleure, Zug, Winterthour mais aussi Genève, Lausanne, la Suisse Italienne. Un certain nombres d’acteurs jouant un rôle clé dans le marché de l’art sont suisses : il y a Sam Keller, direc-teur de la Fondation Beyeler, qui attire des visiteurs du monde entier et qui va encore s’agrandir. De nom-breux marchands clés ont vécu et ont exercé en Suisse : Beyeler bien sûr, mais aussi Peter Nathan, la famille Feilchenfeldt, Jan Krugier, Eberhard Kornfeld et Bruno Bischofberger. Ce dernier est une figure capi-tale pour l’art du XXe siècle car il a été la force der-rière Warhol et Basquiat et c’est lui qui est à l’origine du marché du design puisqu’il a créé la plus belle col-lection de design au monde. Et, aujourd’hui, il y a Maja Hoffmann, avec sa fondation LUMA à Arles – mais elle a aussi beaucoup fait pour Zurich. La liste est longue mais je dirais que la Suisse continue à jouer un rôle de premier plan et je pense même que par rapport à il y a cinquante ans ce rôle s’est amplifié.
Vous commencez vous-même à travailler dans le monde de l’art au début des années soixante-dix. Qui ont été vos modèles à l’époque ? Le commissaire-priseur Maurice Rheims, qui était académicien et a publié de nombreux livres sur le sujet, était-il l’un d’eux ?
Paradoxalement, même si c’est ma passion, je suis devenu commissaire-priseur par accident et non pas en suivant un modèle. Quand j’ai commen-cé à travailler chez Kornfeld et Sotheby’s dans les années soixante-dix, je ne tenais pas le marteau. C’est une fois à Sotheby’s Londres dans les an-nées quatre-vingts où, comme j’étais très timide à l’époque, j’ai choisi par défi de commencer à di-riger des ventes, ce qui demande de prendre la parole devant un public. J’ai beaucoup manœu-vré pour qu’on me laisse tenir le marteau. Et j’y ai pris goût. C’est comme ça que je suis devenu commissaire-priseur, sans l’avoir prémédité, alors que je travaillais déjà dans le monde de l’art de-puis un certain temps. Mon plus grand modèle à cette époque, celui qui m’a certainement décidé à pousser le pas, était Peter Wilson, le directeur de Sotheby’s. C’était un visionnaire : tout ce que nous avons vécu sur le marché de l’art depuis quarante ans est le résultat de sa vision. C’est lui qui en 1958 a organisé la vente de la collection Goldschmidt : c’était la première vente du soir, conçue comme un gala, sur invitation, avec seulement quelques œuvres de premier choix – Manet, Van Gogh, Cézanne, Renoir. Avant lui, le monde des en-chères n’était absolument pas dominé par le duo Christie’s-Sotheby’s. Au contraire, les ventes prin-cipales dans les années cinquante-soixante étaient encore dominées par Paris. Et le grand commis-saire-priseur parisien était à l’époque Maurice Rheims, en effet. Jeune, j’avais lu son livre Haute curiosité, un ouvrage qui m’avait fasciné. Je me suis dit : voilà, c’est le type de vie que je voudrais vivre. J’étais tellement impressionné par toutes ces anec-dotes sur des objets magnifiques, des rencontres avec des collectionneurs fantasques qu’il racontait avec sa belle plume d’académicien.
Une autre personne à qui je dois beaucoup pour l’orientation de ma carrière est le marchand bâlois Ernst Beyeler. L’attitude de Beyeler était celle d’un grand monsieur de l’art : le monde devait venir vers lui, ce n’était pas à lui d’aller vers le monde. Et, de fait, tous les collectionneurs du monde venaient le voir. C’est un homme qui a laissé avec sa fondation un legs exceptionnel. Il a joué un rôle clé au départ de ma vie professionnelle, qui n’était pas très bien engagée à la fin des années soixante : j’étais même considéré par ma famille comme un cas désespéré. À tel point que ma mère l’avait appelé un jour en lui disant : « Mon fils est un cas difficile, pouvez-vous le recevoir ? ». Il avait accepté. Quand je suis allé le rencontrer, il m’a tout de suite demandé si mon ap-proche de l’art était physique ou intellectuelle. Je lui ai répondu qu’elle était purement physique et il m’a alors dit qu’il fallait que je m’oriente vers le marché de l’art et non pas que j’étudie l’histoire de l’art, car je ne verrais l’art que dans les livres alors que dans le marché je serais physiquement en contact avec les œuvres. J’étais séduit mais je n’y connaissais rien et je lui ai demandé « Mais comment faire ? ». Et il m’a donné une marche à suivre très claire : il m’a dit qu’il fallait que je passe trois mois chez Kornfeld, puis une année chez Sotheby’s à Londres, une autre an-née chez Sotheby’s à New York et une année à la ga-lerie Marlborough, qui était alors la première galerie à avoir ouvert des succursales dans le monde entier. Après tout ça, il fallait que je revienne le voir. J’ai donc demandé à être reçu chez Kornfeld et les trois mois sont devenus dix-huit mois et quand je suis allé chez Sotheby’s le plan Beyeler a encore évolué puisque je suis resté chez Sotheby’s. Mais c’est bien Ernst Beyeler qui m’a mis sur la bonne voie.
Après les expériences que vous venez de dé-crire, en 1978, alors que vous avez vingt-sept ans, votre vie change : vous devenez le conser-vateur de la collection du Baron Thyssen à Lugano, où vous restez jusqu’en 1986. Vous changez donc de rôle puisque vous passez du côté des acheteurs et des collectionneurs, alors que jusque-là vous travailliez du côté des vendeurs. Qu’est-ce que cette période a re-présenté pour vous ?
?
Le grand privilège que j’ai eu dans ma carrière de plus de cinquante ans dans le monde de l’art, c’est que je l’ai connu sous toutes ses perspectives, celle d’artiste, de galeriste, de marchand, de commis-saire, de conservateur, de collectionneur et, bien sûr, de commissaire-priseur. Cela doit être dû à ma peur de la routine : j’ai périodiquement be-soin de changement, je me lasse de faire toujours la même chose… J’ai fait la connaissance du baron Thyssen dans les années soixante-dix, à Monaco, où j’avais travaillé pendant un an pour Sotheby’s. À l’époque, les grands collectionneurs étaient en core physiquement présents dans la salle lors des ventes. Et c’est donc là que je l’ai rencontré et il a fini par me demander de venir travailler pour lui. C’était un homme passionné et généreux et qui a véritablement fait de la politique culturelle avec sa collection : chez lui, j’ai pu organiser les premiers échanges culturels entre l’Europe et l’Union sovié-tique. J’ai pu exposer en Suisse, à la Villa Favorita, les collections Chtchoukine et Morozov, en pleine Guerre froide. Mais j’étais aussi impliqué dans toutes les acquisitions pour sa collection bien sûr : je triais les œuvres qu’on lui proposait d’acheter, et il y en avait beaucoup ! À l’époque, quand il regar-dait un livre et qu’il aimait une œuvre reproduite, il cornait la page. Durant mes deux-trois premières semaines à Lugano dans sa bibliothèque, j’ai regar-dé tous les livres dont il avait corné les pages pour comprendre son goût et son œil. Il cornait d’ail-leurs les pages indépendamment du fait que les œuvres soient à vendre ou déjà dans un musée ! Il pouvait acheter un ivoire médiéval un jour et un Pollock le lendemain. C’est ça qui était fascinant : de nombreux collectionneurs se concentrent sur un domaine particulier, lui s’intéressait avec goût à tous les domaines.
Vous avez donc fréquenté deux des plus grands collectionneurs du XXe siècle, Beyeler et Thyssen. Vous ont-ils transmis le virus de la collection ? Si oui, que collectionnez-vous ?
Bien sûr, je collectionne – ou plutôt j’accumule ! Si je collectionnais des voitures miniatures quand j’étais petit, quand j’ai débuté dans le marché de l’art, mon premier appartement à Londres était une pièce immense mais totalement vide. J’avais mon lit au milieu, une table et une chaise dans un coin et c’est tout. Et je dois dire que ce côté zen me plaisait beaucoup. Je suis autant attiré par la simplicité totale que par l’accumulation d’ob-jets qui ont un intérêt. La première fois qu’on se fait violence, qu’on achète quelque chose qui va au-delà de ses propres moyens financiers et que ça fait donc mal au portefeuille, c’est là qu’on at-trape le virus. C’est une maladie incurable. Ce n’est que relativement tard que je suis devenu col-lectionneur car pendant longtemps je n’avais pas les possibilités financières d’acheter ce qui me ten-tait vraiment.
Je m’intéresse surtout à l’art contemporain, au design et à la photographie. Mais évidemment l’art contemporain cesse à un moment de deve-nir contemporain et j’essaie donc de suivre les der-nières évolutions. C’est ce qui me plaît : avec le contemporain, il n’y a pas encore le consensus du temps, le recul du temps. C’est cela qui constitue la vraie aventure, sans oublier le fait qu’on peut connaître et rencontrer les artistes eux-mêmes.
Un exemple d’artiste d’aujourd’hui que vous ap-préciez particulièrement et dont vous avez des œuvres ?
Le sculpteur anglais Antony Gormley est l’un d’eux. J’ai récemment racheté une œuvre de lui que j’avais possédée auparavant : d’habitude je ne le fais jamais, mais j’appréciais tellement cette sculpture et l’artiste que j’ai fait une exception à la règle. Je me suis rendu compte que j’avais besoin d’avoir à nouveau cette œuvre.
Au moment où l’art contemporain commence à dominer le marché, en 2000, vous vous as-sociez à LVMH, qui vient de racheter Phillips – alors la troisième maison de ventes mon-diale. Mais LVMH quitte l’aventure dès l’année suivante. Vous vous retrouvez seul à la tête de Phillips et pendant dix ans vous allez vous évertuer à en faire une maison de ventes spé-cialisée dans le Post-war et le contemporain. Quelles sont les raisons de ce choix ? Parce que vous flairiez que ce marché allait exploser ?
Un dicton allemand dit que la nécessité apporte la créativité. Lorsque je me suis trouvé seul pro-priétaire de Phillips, je n’avais pas la possibilité fi-nancière d’entrer en compétition avec Sotheby’s et Christie’s. Il me fallait donc me concentrer sur des domaines qui étaient un peu négligés par ces deux grandes maisons leaders du marché. Mais c’est en effet à ce moment que j’ai pu, pour la première fois, unir mon activité professionnelle avec ma pas-sion personnelle, c’est-à-dire l’art contemporain. Nous vendions des œuvres créées il y a une ving-taine d’années au maximum jusqu’aux œuvres sor-ties des ateliers moins de deux ans auparavant. L’art contemporain était le département phare mais il y a avait également le domaine du design, qui n’avait pas encore l’importance qu’il a maintenant. Le troisième domaine que j’ai voulu développer était celui de la photographie car quand je regardais les cata-logues des ventes de photos je trouvais ça d’un en-nui mortel : à chaque vente c’était toujours le même petit groupe de photographes. Cette période a été une des plus fascinantes de ma vie professionnelle car avec Phillips nous sommes devenus des faiseurs de goût : chaque saison de vente nous introdui-sions des artistes, des photographes, des designers qui n’avaient jamais été vendus aux enchères au-paravant. Ma plus grande fierté est de voir qu’au-jourd’hui, soit vingt ans plus tard, dans les ventes du soir de Sotheby’s et Christie’s, certains de ces ar-tistes que nous avions vendus pour la première fois sont les stars. Nous avons, par exemple, joué un rôle clé dans la carrière de marché d’artistes comme Christopher Wool, Mike Kelley ou encore Richard Prince. Quand nous avions commencé à soutenir leurs œuvres, elles ne valaient pas grand chose.
Mais le monde des enchères s’intéresse plu-tôt à des artistes dont la cote est déjà établie. Ce sont plutôt les galeries qui prospectent les jeunes pousses et leur donnent une carrière. Les maisons de vente ne sont quand même pas des découvreuses de talent …
Nous avons vendu les premières Nurses de Richard Prince quand elles coûtaient entre trente-cinq mille et soixante-quinze mille dollars sur le pre-mier marché, celui des galeries. Mais de nom-breuses personnes n’ont réagi que quand nous avons vendu une Nurse à un million de dollars. Depuis, les Nurses ont été vendues jusqu’à douze millions de dollars. Il est très important pour un artiste d’avoir un bon marché premier avec les ga-leries ainsi qu’un bon marché secondaire, avec les ventes aux enchères. Lorsque vous achetez une œuvre en galerie et que vous n’avez pas la possibi-lité de la revendre sur le marché secondaire, cela ne vous encourage pas. Alors que si vous savez qu’il existe déjà une demande sur le marché secondaire, cela vous donne confiance. Les galeries ont besoin du marché des enchères et vice-versa : les maisons de vente ne peuvent pas fonctionner s’il n’y a pas les galeries qui s’engagent dans un premier temps pour les artistes. Ce qui était important quand nous avons décidé de nous concentrer sur ces do-maines chez Phillips, c’était de bien choisir les œuvres, de ne pas prendre tout le monde : il fal-lait refuser huit tableaux sur dix et ne sélectionner que ceux auxquels nous croyions. C’était une vi-sion très curatoriale.
Est-ce que selon ce raisonnement cela veut dire que le marché a toujours raison : si à un mo-ment un artiste vaut très cher – comme Koons ou Hirst qui ont des prix faramineux alors qu’ils surproduisent –, c’est que c’est un bon artiste ?
Je ne pense pas qu’on puisse dire que le marché a toujours raison car le goût pour l’art évolue constamment. Même pour l’art du passé. On le comprend quand on considère les prix des tran-sactions d’autrefois : quand j’étais conservateur de la collection Thyssen, j’ai pu voir tous les prix payés pour les chefs-d’œuvre de la collection. Quand le père du baron Thyssen avait acheté le chef-d’œuvre absolu qu’est le Portrait de Giovanna Tornabuoni par Ghirlandaio à J. P. Morgan Jr. au tout début des années trente, il l’avait payé trois cent mille dollars – un prix considérable pour l’époque. Plus ou moins au même moment, il avait acheté un chef-d’œuvre du Caravage, la Sainte Catherine, en ne la payant que vingt-sept mille dollars. Ce qui montre que Le Caravage n’était pas encore considéré comme un grand maître de l’histoire de l’art. On voit qu’il y a une évolution du goût même pour l’art du passé. C’est encore plus vrai pour les arts décoratifs, où le goût change très ra-pidement. Quand j’ai commencé dans les ventes à Monaco dans les années soixante-dix, les gens for-tunés achetaient du mobilier français du XVIIIe siècle. Tandis qu’aujourd’hui chez ces mêmes per-sonnes, on verra surtout du mobilier des années cinquante. Le marché de l’art n’a pas cessé d’aug-menter dans son ensemble depuis cent ans mais à l’intérieur de ce marché il y a des fluctuations énormes. Nos petits-enfants aimeront encore autre chose que ce que nous apprécions aujourd’hui.
Mais pensez-vous qu’à un moment ce marché de l’art contemporain en bonne partie spécula-tif va plafonner, ou voyez-vous une suite sans fin d’incrémentation ?
Certains artistes très rares comme Basquiat ont tous les ingrédients pour rester recherchés et convoités. À mon avis, on verra encore la cote de Basquiat augmenter. Il est pour moi l’équivalent contemporain de Van Gogh car, comme lui, il est mort jeune et un mythe s’est créé autour de son travail très torturé et expressionniste. Il y a ensuite la catégorie de ce que j’appelle les trophées : des œuvres tellement rares et exceptionnelles qu’elles sont pratiquement immunisées à l’évolution du goût. Et comme il y a de plus en plus d’argent dans les mains de moins en moins de personnes, si ces personnes sont prêtes à acheter ces trophées, quand l’un d’eux devient disponible sur le mar-ché, elles doivent absolument essayer de l’avoir car ce sont des opportunités qui ne se représentent pas. C’est pour cela qu’on va continuer à voir des niveaux de prix qu’on ne pensait pas imaginables au sommet du marché.
Depuis 2012 et le rachat de Phillips, vous vous êtes mis en retrait des maisons de vente. Vous continuez à animer des ventes de cha-rité et vous vous occupez de ventes en ligne. Pourquoi ce choix alors que les enchères continuent de s’envoler de plus belle ? Vous étiez-vous lassé ?
Je n’ai jamais été lassé de quoi que ce soit : c’est ce qui est merveilleux dans ce métier. J’ai la même passion qu’au premier jour. Ce qui m’intéresse ce sont les nouvelles méthodes de vendre de l’art : toutes les possibilités que le marché a d’évoluer par rapport à la révolution technologique. Le marché a tout fait pour résister à cette révolution et main-tenir le statu quo mais je pense que la pandémie a enfin fait advenir et accélérer ces changements. Parmi ces nouvelles pratiques, il y a, par exemple, la vente que j’ai organisée, baptisée Women artists in times of Chaos – des œuvres créées pendant la pandémie et les guerres par des artistes femmes. Eh bien, avec cette vente, la totalité du prix mar-teau va à l’artiste et à la galerie qui la représente. Les œuvres ne sont pas mises en vente par des pro-priétaires privés mais par les galeries et les artistes eux-mêmes. Ce ne sont donc pas les riches collec-tionneurs venant d’acheter un tableau et le reven-dant tout de suite qui profitent du produit de la vente. Après l’enchère, on révèle d’ailleurs aux ar-tistes et à la galerie qui a acheté l’œuvre. De même, lors de la vente, j’indique à l’acheteur de quelle ga-lerie provient l’œuvre. Et l’acheteur s’engage à ne pas la remettre en vente avant trois ans. C’est un système qui donne de nouvelles opportunités aux galeries et cela permet à n’importe quel collection-neur qui a les moyens d’accéder aux œuvres ré-centes d’un artiste.