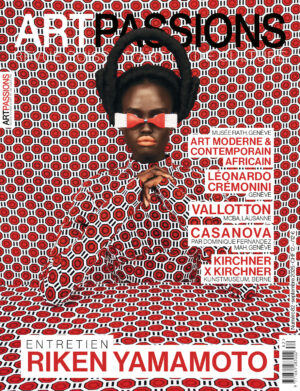Que se passe-t-il en Italie ? L’abjection du gouvernement actuel, son mépris pour les œuvres de l’esprit, suffisent-ils à expliquer ce désert culturel qu’est devenu le pays de Dante, de Michel-Ange, de Moravia, de Visconti ? Je viens de passer dix jours à Florence : pas un seul spectacle, ni théâtre, ni opéra. Seul film à voir : Les Trois mousquetaires, dans la récente et horrible version américaine. La plus grande librairie fermée. Certains musées, officiellement ouverts toute la journée, fermés l’après-midi, sans préavis, faute de personnel. À Pompéi, de prestigieuses maisons, vieilles de deux mille ans, qui avaient survécu à l’éruption du Vésuve, et qui s’écroulent, faute d’entretien. À Naples, à Venise, plus que quelques opéras par an, trois ou quatre. L’opéra ! qui était le centre de la vie culturelle en Italie, Rossini, Verdi, Puccini étant pour les Italiens ce que sont Stendhal, Balzac, Zola pour les Français. À Turin, capitale de la résistance intellectuelle sous le fascisme, les énormes librairies sont envahies de best-sellers américains sous couverture en relief dorée, les « classiques », de Dante à Calvino, étant relégués dans un angle minuscule. Les belles et savantes collections, type « Pléiade », disparues. Disparus les grands metteurs en scène de cinéma, disparus les grands écrivains. Disparu tout ce qui faisait qu’on raffolait de ce pays non seulement pour son climat, la beauté de ses villes, la richesse de ses musées, l’excellence de sa cuisine, mais surtout pour sa puissance créatrice, sa faculté de rebondir de siècle en siècle, sans jamais se contenter de vivre sur son passé, sur ses ruines magnifiques, mais ruines. Oui, vraiment, que se passe-t-il ?
Certes, pour le cinéma et l’opéra, pour l’entretien des vestiges archéologiques et le fonctionnement des musées, il faut des subventions, et l’arrogante démission de l’État explique le délabrement des institutions officielles. Mais pourquoi les quelques metteurs en scène en activité sont-ils si peu inspirés ? Les écrivains, pourtant nombreux et certains de qualité, si en retrait sur leurs aînés ? Je crois qu’il faut incriminer, chez les écrivains, la volonté, plus ou moins consciente, d’être tout de suite « mondialisés », c’est-à-dire traduits et lus aux États-Unis. Or, la force de la littérature italienne, c’était d’être enracinée dans des lieux précis, petits, étroits : Svevo à Trieste, Pavese dans le Piémont, Moravia à Rome, Bassani à Ferrare, Lampedusa, Vittorini, Sciascia en Sicile. Du haut de leur observatoire, ils atteignaient à l’universel. Quand on veut plaire tout de suite à tout le monde, on ne peut que dire ce que tout le monde attend : ainsi devient-on insignifiant, nul. Ce n’est qu’en creusant dans l’ornière où l’on est né qu’on arrive à être quelqu’un. L’œuvre de Proust a jailli du minuscule jardin de Combray, celle de Chateaubriand du donjon de Combourg. Kafka n’est jamais sorti de chez lui pour écrire le meilleur livre sur l’Amérique.
La mondialisation, voulue, décidée, rapide, voilà l’écueil pour toute culture sérieuse. En France non plus nous ne sommes pas à l’abri de ce danger. Il faut oser être soi, jusqu’au bout, descendre au fond de soi, au lieu de chercher à s’étendre au loin. L’extension se fera toute seule, si le livre est bon, mais le livre ne peut être bon que s’il est planté en bonne terre, comme un pied de vigne. À la « littérature monde », nouvelle école littéraire, nouvelle mode imbécile, il faut opposer la « littérature clocher ». Du fond de Racalmuto, Sciascia démontait les impostures politiques, et, dans les banlieues romaines, Pasolini débusquait la sauvagerie chaleureuse des garçons. Aujourd’hui, en Italie, personne n’ose plus être Italien. Personne parmi les créateurs. Mais rassurez-vous : le peuple italien reste le plus accueillant, le plus aimable, le plus sympathique du monde. Il a gardé ses valeurs, son humanité, son hospitalité, sa drôlerie affectueuse. Triste Italie, mais merveilleux Italiens !