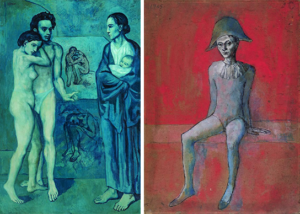En complément (hasard ou calcul) de l’exposition « Rouge », l’Opéra Bastille a proposé dans une mise en scène de Krzystof Warlikowski une superbe version de Lady Macbeth de Mzensk, l’opéra de Chostakovitch, porté, sublimé par Aušriné Stundyté, une cantatrice lithuanienne inconnue jusqu’alors, qui a fait sensation. L’œuvre, créée en URSS en 1934, tirée d’une nouvelle de Leskov, raconte la lutte de Katerina Ismaïlova contre le monde grossier et lâche des hommes. C’est une femme de marchand, qui étouffe entre un mari impuissant et un beau-père tyrannique, et ne trouve d’autre moyen d’échapper à l’emmurement que de se donner, corps et âme, à un ouvrier au service de son mari, le beau Serguei. Entraînée par sa passion, elle empoisonne son beau-père avec un plat de champignons où elle a mis de la mort-auxrats, puis étrangle son mari, tout en étant dépeinte comme si supérieure à son entourage masculin, qu’elle peut tuer sans être pour autant criminelle. Elle finira au bagne en compagnie de Serguei, mais innocente en quelque sorte. La puissance satirique de la musique est extraordinaire : l’ordre régnant, contrôlé par les popes et les policiers, est ridiculisé et stigmatisé par chaque note de l’orchestre, chaque inflexion du chant.
Tel est le résumé officiel de l’histoire. En réalité, le protagoniste de l’opéra, c’est le sexe, le sexe refoulé de Katerina, le sexe triomphant de Serguei. Pour la première fois dans l’histoire de l’opéra, et aucun opéra n’a pris la relève depuis, le thème central est la sensualité, la sexualité. La sexualité brute, animale, sans chichis littéraires, sans fioritures petites-bourgeoises. Aucun amour « romantique » entre les deux amants, mais la ruée sur le matelas. La première fois que les deux jeunes gens font l’amour, debout, à la hussarde, contre un mur, les coups de boutoir de l’amant sont traduits par une succession de fortissimi qui aboutissent à un jet de trombone imitant l’épanouissement de l’orgasme.
Or, en 1934 et 1935, l’opéra fut joué cent fois à Moscou, autant de fois à Leningrad, avec les éloges
de la critique et un succès retentissant. C’est dire que le public soviétique, loin d’être bégueule, applaudissait à la fois à la critique de la société dominée par les mâles, et à la religion du sexe seul capable de libérer l’individu. La reconnaissance du chef-d’œuvre sera beaucoup plus lente et contrastée dans les pays occidentaux, qui se jugeront agressés par cette franchise déclarée trop brutale…
Hélas, Staline, muni de pleins pouvoirs depuis 1929, veillait aussi à la culture. Il se rendit au Bolchoï en 1936, accompagné de plusieurs membres du Bureau politique. Horrifié de ce qu’il avait vu et entendu, il fit condamner et retirer l’opéra des scènes par un article paru dans la Pravda. Chostakovitch fut du jour au lendemain mis à l’écart, suspecté, empêché d’écrire ce qu’il voulait. On mesure par cet épisode l’ambiguïté de ce qu’on appelle la culture soviétique. Chostakovitch s’était rallié au régime, il avait écrit en 1929 la musique de la pièce révolutionnaire de Maïakovski La Punaise, il composait de la musique soviétique, et le public qui l’acclamait était un public soviétique. L’art soviétique – et dans les domaines les plus variés, poésie, architecture, cinéma, photomontage – était à l’avant-garde de l’Europe. Staline confisqua ce magnifique élan et réussit à faire passer pour modèles de la culture soviétique des œuvres de pure propagande, soumises à la censure du Parti, échantillons de ce qu’on appelle le « réalisme socialiste », tristement flagorneur et conventionnel. Et depuis, dans l’esprit du public occidental, tout ce qui a émané de l’URSS a longtemps été frappé de discrédit.
En 2019, quatre-vingt-cinq ans après sa création, Lady Macbeth de Mzensk n’a rien perdu de son énergie et de sa puissance révolutionnaire. De quoi faire pâlir les romances du type Traviata ou Bohème… Jamais la musique ne s’est approprié avec autant de force les pouvoirs de la littérature : derrière les sarcasmes de Chostakovitch contre toutes les formes de prépotence, on croit entendre le rire de Voltaire.