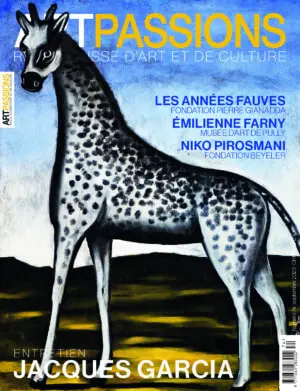La Fondation Prada consacre une grande exposition à l’un des maîtres de l’arte povera, Jannis Kounellis. À voir – passionnément –, à Venise, avant le 24 novembre.
Peut-être faut-il avoir en soi réparti sa propre intelligence inéquitablement, en avoir placé davantage du côté du cœur que du côté du cerveau, l’avoir confiée plus souvent à cette partie qui relance coûte que coûte qu’à celle, grise, qui s’imprègne, et l’avoir beaucoup plus convertie en disponibilité qu’en habileté, pour comprendre ce pan de la création artistique que d’aucuns, sans se soucier de la qualité – mais n’est-ce pas là l’essentiel, et y a-t-il moins de croûtes en peinture que d’œuvres médiocres dans cette catégorie encore décriée ? –, continuent de désigner comme « la feuille de salade posée dans le coin d’une galerie » ou « le grand morceau de taule tout juste plié ». Peut-être. Je reste en tout cas charmé, autant que par les installations – puisqu’il faut bien lâcher le mot certainement réducteur – qui la suscitèrent, par la réaction d’un être cher entre tous avec qui je visitais à Venise, en juin dernier, la rétrospective que la Fondation Prada consacre, en marge de la Biennale, à Jannis Kounellis. Nous venions de monter l’escalier qui, de manière inhabituelle pour un tel palais (Ca’ Corner della Regina), se déploie perpendiculairement au Grand Canal, au milieu du rez-de-chaussée. À la billetterie, presque un parloir de couvent, nul produit n’avait importuné notre œil, ni mug ni tote bag. Nous arrivâmes dans la galerie, de part et d’autre de laquelle sont alignées les anciennes pièces d’habitation, qu’on appelle portego. Nous y butâmes, pratiquement, sur des dizaines de manteaux noirs, anthracite ou bleu marine alignés à même le sol, sur chacun desquels étaient posés une paire de chaussures de ville – à gauche – et un chapeau de feutre – à droite. Et cet être cher qui est tout attention, qui n’a jamais rien lu sur Jannis Kounellis, l’arte povera ou le postmodernisme, mais qui pourrait le faire demain, qui vit loin de tout connaisseur, fut attiré, repoussé et à nouveau attiré par cette espèce de prairie cendrée, sans insectes. Y a-t-il meilleure critique ?
Sans doute ma mère, car c’est d’elle qu’il s’agissait, associa plus ou moins consciemment ce terrible parterre à certaines des lectures que nous avions en commun, à Modiano par exemple, ou à Bassani. C’est en tout cas ce que je fis. Kounnellis ne montrait-il pas, avec une économie dans le choix du matériau et du geste que n’aurait pas renié un auteur de haïkus, aussi bien les fauches les plus immondes du XXe siècle que les tragédies plus quotidiennes, où il faut choisir une tenue, où l’on habille ou dés
habille son corps, ou celui d’un autre, pour la toute dernière fois ? Les mêmes souvenirs individuels ou collectifs, à la fois réels et rêvés – déchirure du quotidien, objets plus ou moins grands laissés ou vidés, manquements à l’appel pour telle ou telle raison, avouée ou non – vous frappaient encore au deuxième étage du palazzo. Étaient accrochées là, sur toute la longueur du bâtiment, au plafond, parallèles au plancher, par des câbles gris qu’on ne pouvait s’empêcher à part soi d’interroger sur leur capacité à tenir, des armoires. Elles étaient de celles, solides et cirées, qu’habite le croquemitaine, dans de jolis draps amidonnés. Cercueils hissés dans une nef, barques banalement rangées dans un hangar ? Cette incongruité me rappelait la Métamorphose de Kafka : « la nourriture ne lui fit bientôt plus le moindre plaisir, et il prit donc l’habitude, pour se distraire, de courir en long et en large sur les murs et sur le plafond. » Il y avait là aussi à mes yeux quelque chose qui tenait du rêve – est-ce que je ne marchais pas là simplement sur un mur, en face d’un autre mur contre lequel étaient empilées des armoires ? –, lequel n’est pas toujours totalement bon ou totalement mauvais. En tout cas, cette visite ne nous affligeait pas, tant s’en faut ! Les salles m’apparaissaient comme saturées d’humanité, si l’on entend par ce nom une sorte de poudre, de pollen, qui serait contenue et lâchée par tel roman, telle toile ou telle sonate, et qui serait capable de nous faire mieux saisir ce qui, superbement ou pauvrement, nous entoure sur ce globe. De drôles de bourses donc, d’étranges plantes, de puissants filtres, que les œuvres de ce Grec qui se forma et travailla en Italie, où il mourut le 17 février 2017, à l’âge de soixantedix ans.
On annonce soudain l’allumage d’une installation ! Une petite douzaine de visiteurs, dont nous sommes, se dirige vers le seuil d’une pièce dont l’accès est barré par un cordon. Une jeune femme et un homme vêtus de noir y entrent : il ouvre de petites bonbonnes de gaz cependant qu’elle enflamme des tuyaux qui, plus ou moins tendus, y sont branchés à une de leurs extrémités ; tous les deux enjambent avec précaution ce qui ressemble à une colonie de serpents qu’on aurait lestés, et qu’ils réveilleraient devant nous, sans pour autant leur donner leur pitance ; le bruit de ces flammes bleues, échappées des bonbonnières bleues, croît logiquement à mesure que ces bouches s’ouvrent, comme une rumeur envahissante qui viendrait lécher vos lobes et vos chevilles : l’un des hymnes possibles de l’ère industrielle (dont la Sérénissime a profité et dont elle souffre tant)… Le charbon, un peu plus loin, ne parle et même ne psalmodie pas moins pour la société et tous ses manœuvres en particulier, dans cette exposition où la grâce – on y trouve écrit le nom de Mozart – se mêle au noircissement, le cheveu au rail, et l’enivrante et incolore grappa au plomb argenté.
Benoît Dauvergne