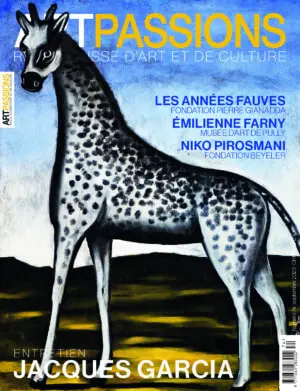« Mon exposition / My Exhibition », tel est le sous-titre qu’ont choisi les commissaires du Kunstmuseum de Berne, de la Menil Collection à Houston et du Museum of Modern Art de New York pour la première grande rétrospective transatlantique consacrée à Meret Oppenheim (1913-1985), trente-sept ans après la dernière exposition d’importance, en 1984, qui avait été montrée à Berne, Paris, Francfort, Berlin et Munich, alors que celle de 2014 n’avait été proposée qu’à Vienne, Berlin et Lille[1]. Elle est complétée par une excellente exposition d’œuvres sur papier qui se tient parallèlement au musée de Soleure.
Le choix de ce sous-titre est important, car il s’inspire d’un projet élaboré par l’artiste elle-même dans les dernières années de sa vie : celui de réunir dans une exposition imaginaire l’ensemble de son œuvre, afin d’en montrer à la fois la diversité et la cohérence. Ce qui avait déjà été tenté en 1984, comme dans de précédentes expositions, contrôlées pour la plupart par Meret Oppenheim elle-même. Ce projet se présente sous la forme de douze feuillets, divisés en deux dans le sens de la largeur, intitulés « M. O. : Mon exposition ». L’artiste y propose un parcours à travers un choix de quelques deux cents dessins, tableaux et sculptures, représentés par de petits dessins extrêmement précis, partant d’une première section, « Dessins d’enfant », et conduisant jusqu’à la grande toile Nouvelles étoiles, de 1977-1982, en passant par Ma gouvernante- my nurse – mein Kindermädchen (1936/1967) (images de presse n° 1) et Sechs Wolken auf einer Brücke / Six nuages sur un pont (1975) (images de presse n° 6, de préférence à 5).
Sur la première feuille Meret Oppenheim avait collé un petit papier quadrillé portant cette inscription : « Cette « Exposition Imaginaire » n’est qu’un exemple. J’ai dû laisser de côté beaucoup d’œuvres qui pour moi ne sont pas moins importantes. » Ces feuillets, qui font partie de la collection Bürgi (Berne)[2], sont présentés dans leur totalité et reproduits avec un soin particulier dans le catalogue. Il atteste de la volonté de Meret Oppenheim de rattacher les différentes parties de son travail à une conception d’ensemble et de souligner les liens qu’entretiennent les parties avec le tout, parfois par-delà les années. Après avoir guidé les commissaires de 2014, ces feuillets ont à nouveau servi de point de départ, cette fois-ci à Nina Zimmer, Nathalie Dupêcher et Anne Umland, pour la construction d’un nouvel exemple de parcours, fort différent du précédent.
Ce nouvel exemple met en avant – plus que cela n’avait été fait jusqu’à présent – la cohérence de l’œuvre de Meret Oppenheim, dont on a souvent mis en avant la diversité, voire l’hétérogénéité, puisque son auteure passait brusquement du Surréalisme à l’Abstraction, du Pop Art au Nouveau Réalisme, des éclats de couleurs à la peinture monochrome. Tout en mélangeant travaux sur papier, toiles peintes, sculptures combinant les matériaux les plus divers. Toutefois, à y regarder de près, plusieurs thématiques semblent traverser l’ensemble de cette production multiforme et en assurer l’unité. Ainsi, on ne peut être que frappé par la place accordée par Meret Oppenheim au rêve et à l’inconscient tout au long de son parcours. Elle s’aventurait volontiers dans ses méandres à la suite de C. G. Jung dont elle était une grande lectrice. Puis, par la liberté prise avec les catégorisations traditionnelles de l’art et l’utilisation de matériaux composites. Enfin, par le refus de toutes les positions acquises et par le rejet des rôles imposés par la société. A commencer par le rôle de la femme comme épouse et mère, qui était celui réservé aux jeunes filles de son milieu.
Issue d’une famille bourgeoise, Meret Oppenheim avait pourtant la chance d’être soutenue dans sa volonté d’embrasser une carrière d’artiste par son père, médecin, et surtout par sa grand-mère, Lisa Wenger-Ruutz (1858-1941). Celle-ci avait elle-même reçu une formation de peintre et, surtout, elle a publié de nombreux livres pour enfants, des contes et des comptines dont certaines sont connus jusqu’aujourd’hui[3]. C’est chez elle que Meret Oppenheim a passé une partie de son enfance et de sa jeunesse, séjournant tantôt à Delémont, à Bâle ou à Carona, petit village perché au dessus du lac de Lugano, particulièrement prisé par Hermann Hesse ou Pierre Jean Jouve dans l’entre-deux-guerres. Un temps, elle a aussi fréquenté l’école Rudolf Steiner à Bâle, dont le projet pédagogique fait une place importante à l’expression artistique. De sa dernière année scolaire, passée à Lörrach, subsiste un cahier d’écolier contenant des équations, dont « X = Hase » (x=lapin), menant à l’absurde la logique mathématique. Un souvenir qu’elle offrira à André Breton, rencontré dès son premier séjour parisien, en 1932.
Quittant la Suisse pour accompagner Irène Zurkinden à Paris, Meret Oppenheim décide de mener la vie d’une femme libre. Elle a ainsi fait le choix, au sortir de l’adolescence, ne pas avoir d’enfant. Un choix douloureux, thématisé dans plusieurs œuvres, dont ce dessin atroce de 1931 intitulé Votivbild (Würgengel) / Image votive (ange étrangleur), qu’elle a elle-même interprété comme une « rébellion contre l’image traditionnelle de la femme ». Il représente une figure féminine grimaçante, aux ailes constellées de sapins comme si c’étaient des montagnes, et qui tient dans ses bras un enfant, la gorge tranchée, et dont le sang coule jusqu’à terre. Une violence que l’on retrouve dans d’autres œuvres, telles Anatomie d’une femme morte (1934) ou Einige der ungezählten Gesichter der Schönheit / Quelques-uns des innombrables visages de la beauté (1942) (images de presse n° 12).
Cette volonté de soumettre – pour ne pas dire sacrifier – sa vie personnelle aux exigences de son art, Meret Oppenheim en fera preuve plus d’une fois au cours de son existence. Par exemple, quand elle se sépare brutalement de Max Ernst, rencontré dans le cercle des Surréalistes peu après son arrivée à Paris, en 1932, et avec qui elle partageait une passion violente. Décision souvent mal comprise, ainsi par Patrick Waldberg, dans son livre sur le Surréalisme, en 1962. Dans une note de protestation adressée à l’historien, et qui figure dans une des vitrines de l’exposition, elle précise que c’était pour préserver sa liberté créatrice qu’elle s’était séparée d’un artiste de vingt ans son aîné, qui avait déjà acquis une place importante sur la scène artistique et qui risquait de l’étouffer. Une décision, précise-t-elle, prise non pas rationnellement, mais dictée par son inconscient, qui la poussait à préserver son indépendance. Les mots d’indépendance et de liberté sont d’ailleurs ceux qui reviennent le plus souvent sous sa plume, à la fois dans sa correspondance[4] et dans ses prises de positions publiques. Recevant en 1975 le prix d’art de la Ville de Bâle, elle remercie par un discours sur la difficile position de la femme-artiste, pour conclure : « La liberté n’est pas donnée, on doit la prendre. »
C’est cet appétit de liberté, aussi, qui a fait quitter à Meret Oppenheim toutes les positions acquises. Le Surréalisme, pour elle, n’était qu’un des aspects de sa création, même si elle a continué à cultiver cette veine jusque dans ses dernières années. Invitée au début des années trente à participer à plusieurs expositions surréalistes, dont celle de New York, Fantastic Art, Dada, Surrealism, en 1936, elle avait la chance (et la malchance) d’entrer à vingt-trois ans au Museum of Modern Art, puisque Alfred H. Barr Jr. faisait immédiatement l’acquisition de son Déjeuner en fourrure. D’avoir créé un des objets iconiques du mouvement sera un héritage lourd à porter.
A la veille de la guerre, Meret Oppenheim, ainsi que les membres de sa famille qui étaient restés en Allemagne, se réfugient en Suisse. Elle traverse des années difficiles, matériellement et sur le plan de la création. N’ayant jamais vraiment appris à dessiner ou à peindre, sauf lors de quelques cours à la Grande Chaumière, elle s’inscrit à l’Ecole des Arts et Métiers à Bâle. Elle y apprend entre autre la restauration de tableau. Elle travaille aussi pour plusieurs scènes de théâtre, confectionnant des costumes et des décors. Enfin, elle épouse Wolfgang La Roche et s’installe avec lui à Berne. Un magasin d’antiquité qu’elle ouvre à la Junkerngasse l’aide à vivre.
Car rares sont les œuvres qu’elle crée durant cette période. Elles témoignent de son isolement, de sa solitude. Une crise qui prend fin au milieu des années cinquante, avec le retour des objets surréalistes, comme Eichhörnchen (Ecureuil), (images de presse n° 2), des sculptures ludiques, comme Der grüne Zuschauer (Le spectateur vert) (images de presse n° 4), ou des tableaux colorés, comme Verzauberung (Ensorcellement) (images de presse n° 14) Ce n’est pas le moindre mérite de cette exposition que de mettre en valeur l’œuvre tardive de Meret Oppenheim, dont les formats plus importants témoignent de l’assurance et de la maturité de l’artiste. La monumentale Fontaine, à quelques pas du musée, sur le Waisenhausplatz, qui avait fait scandale lors de son installation en 1983, en est la meilleure preuve.
[1] Voir Artpassions, n° 37/2014. Vérifier svp
[2] Dominique Bürgi est la responsable des archives de Meret Oppenheim au musée de Berne et l’auteure du catalogue de ses œuvres.
[3] Dont la célèbre chansonnette en dialecte alémanique, Joggeli soll ga Birli schüttle (Jacquot doit aller secouer les poirillons).
[4] Voir l’important volume édité par Lisa Wenger et Martina Corgnati, Meret Oppenheim, Worte nicht in giftige Buchstaben einwickeln. Das autobiographische Album « Von der Kindheit bis 1943 » und unveröffentlichte Briefe, Zurich, Scheidegger&Spiess, 2013.


















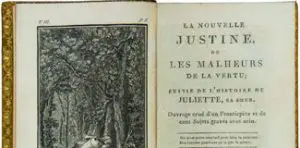


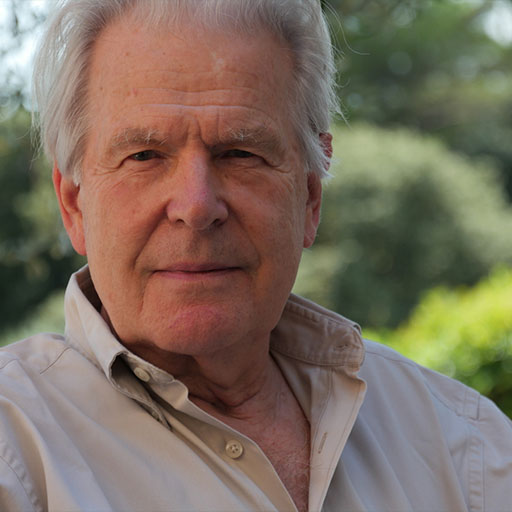



![[EN] Jacques Chessex: A Voice in the Night – Exclusive Interview with Artpassions](https://artpassions.ch/wp-content/smush-webp/2025/03/dd01-scaled.jpeg.webp)