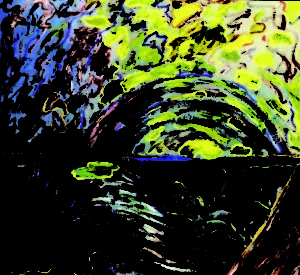« Inventeur perpétuel et champion ès métamorphoses et apparitions fantasmagoriques, le surréaliste iconoclaste et éclectique a pris ses quartiers d’été à la Fondation Beyeler à Riehen. »
Françoise Jaunin
 Dadamax : c’est ainsi qu’en hommage à sa liberté iconoclaste et à ses scandales de dadaïste révolté, Jean Tinguely appelait admirativement Max Ernst. L’artiste, lui, s’était inventé le pseudonyme de Loplop en guise d’alter ego à tête d’oiseau ironique et magicien qui renvoyait à son profil aigu et ses yeux transparents et faisait la navette entre les profondeurs de son inconscient et la surface de ses rêves. Quant au poète André Breton, il saluait en lui « le cerveau le plus magnifiquement hanté qui soit aujourd’hui ». Avec plus de 180 peintures, collages, dessins, sculptures et livres illustrés, la Fondation Beyeler accueille, en coproduction avec l’Albertina de Vienne, une vaste rétrospective qui explore les dédales hallucinés de ce cerveau fertile et déroule dans tous ses états le panorama d’une œuvre énigmatique et polymorphe qui a profondément marqué son époque.
Dadamax : c’est ainsi qu’en hommage à sa liberté iconoclaste et à ses scandales de dadaïste révolté, Jean Tinguely appelait admirativement Max Ernst. L’artiste, lui, s’était inventé le pseudonyme de Loplop en guise d’alter ego à tête d’oiseau ironique et magicien qui renvoyait à son profil aigu et ses yeux transparents et faisait la navette entre les profondeurs de son inconscient et la surface de ses rêves. Quant au poète André Breton, il saluait en lui « le cerveau le plus magnifiquement hanté qui soit aujourd’hui ». Avec plus de 180 peintures, collages, dessins, sculptures et livres illustrés, la Fondation Beyeler accueille, en coproduction avec l’Albertina de Vienne, une vaste rétrospective qui explore les dédales hallucinés de ce cerveau fertile et déroule dans tous ses états le panorama d’une œuvre énigmatique et polymorphe qui a profondément marqué son époque.
 Né en 1891 près de Cologne, dix ans après Picasso et dix ans avant Giacometti, Dadamax alias Loplop n’a jamais mis les pieds dans une école d’art. Il commence à Bonn des études de philosophie, psychiatrie et histoire de l’art, tout en s’essayant à la peinture dans une veine plus ou moins expressionniste. Mais la Première Guerre qui l’embarque dans sa « grande saloperie » va changer son regard sur le monde. Après avoir rencontré les dadaïstes berlinois lors d’une permission, en 1916, il fonde avec l’activiste social Baargeld le sulfureux groupe Dada de Cologne. Puis rejoint, en 1922, les surréalistes à Paris grâce au passeport… de Paul Éluard venu lui rendre visite en Allemagne. Toute sa vie sera mouvementée et partagée entre quatre épouses (dont la collectionneuse Peggy Guggenheim et les peintres Leonora Carrington et Dorothea Tanning), deux guerres mondiales et des périodes de paix… Ajoutons-y trois pays : l’Allemagne de ses origines, qui l’inscrira, en 1933, sur sa liste d’« artistes dégénérés » ; la France, où il sera par deux fois interné comme ressortissant d’une nation ennemie et où il retournera après la guerre, en 1948, connaîtra une gloire tardive consacrée par le Grand Prix de la Biennale de Venise en 1954, obtiendra son passeport tricolore en 1958 et mourra en 1976 ; et les États-Unis où il parvient à s’exiler, en 1941, grâce à l’admiration des douaniers de Champblanc, à la frontière espagnole, qui le laissent passer malgré son passeport suspect quand ils découvrent les toiles roulées dans ses valises.
Né en 1891 près de Cologne, dix ans après Picasso et dix ans avant Giacometti, Dadamax alias Loplop n’a jamais mis les pieds dans une école d’art. Il commence à Bonn des études de philosophie, psychiatrie et histoire de l’art, tout en s’essayant à la peinture dans une veine plus ou moins expressionniste. Mais la Première Guerre qui l’embarque dans sa « grande saloperie » va changer son regard sur le monde. Après avoir rencontré les dadaïstes berlinois lors d’une permission, en 1916, il fonde avec l’activiste social Baargeld le sulfureux groupe Dada de Cologne. Puis rejoint, en 1922, les surréalistes à Paris grâce au passeport… de Paul Éluard venu lui rendre visite en Allemagne. Toute sa vie sera mouvementée et partagée entre quatre épouses (dont la collectionneuse Peggy Guggenheim et les peintres Leonora Carrington et Dorothea Tanning), deux guerres mondiales et des périodes de paix… Ajoutons-y trois pays : l’Allemagne de ses origines, qui l’inscrira, en 1933, sur sa liste d’« artistes dégénérés » ; la France, où il sera par deux fois interné comme ressortissant d’une nation ennemie et où il retournera après la guerre, en 1948, connaîtra une gloire tardive consacrée par le Grand Prix de la Biennale de Venise en 1954, obtiendra son passeport tricolore en 1958 et mourra en 1976 ; et les États-Unis où il parvient à s’exiler, en 1941, grâce à l’admiration des douaniers de Champblanc, à la frontière espagnole, qui le laissent passer malgré son passeport suspect quand ils découvrent les toiles roulées dans ses valises.
Surréaliste ? Assurément, et l’un des plus grands avec Dali et Magritte, même si sa fécondité créatrice et son inventivité formelle demeurent inclassables. Mais s’il fut bien pionnier de l’esprit surréaliste et signataire en 1924 du Manifeste du Mouvement surréaliste dont il a régulièrement participé aux expositions, il a toujours eu soin de se tenir à distance de Breton, le grand manitou du groupe dont le despotisme heurtait son besoin viscéral de liberté. Une distance narquoise qui allait bien avec ses délicatesses de prestidigitateur et son élégance de gentleman flingueur.
Décalcomanie du désir
 Éclectique, Ernst butine dans toutes sortes de disciplines pour y trouver son inspiration. Astronomie, ethnologie, ornithologie, mathématiques, psychanalyse… : sa curiosité et ses interrogations sont sans limites. Pas de doute : l’homme est un intellectuel. Mais un tactile aussi et un expérimentateur perpétuel qui ne cesse d’inventer ou d’adapter des techniques d’expression inédites : collage, grattage, frottage, décalcomanie, roman-collage ou dripping avant la lettre et avant Pollock, tous procédés qui induisent une « véritable alchimie de l’image » et convoquent les hallucinations conduisant aux profondeurs de l’inconscient et de la vie élémentaire.
Éclectique, Ernst butine dans toutes sortes de disciplines pour y trouver son inspiration. Astronomie, ethnologie, ornithologie, mathématiques, psychanalyse… : sa curiosité et ses interrogations sont sans limites. Pas de doute : l’homme est un intellectuel. Mais un tactile aussi et un expérimentateur perpétuel qui ne cesse d’inventer ou d’adapter des techniques d’expression inédites : collage, grattage, frottage, décalcomanie, roman-collage ou dripping avant la lettre et avant Pollock, tous procédés qui induisent une « véritable alchimie de l’image » et convoquent les hallucinations conduisant aux profondeurs de l’inconscient et de la vie élémentaire.
Le frottage, il en imagine le principe en observant les lames irrégulières d’un parquet. Il y pose une feuille de papier et, laissant courir sa mine de plomb, recueille l’empreinte de leur épiderme ligneux. Puis réédite sur toutes sortes de surfaces dont les textures crayonnées font apparaître des formes et figures plus ou moins imaginaires. Il y voit une transposition de l’ « écriture automatique » chère aux surréalistes. De la technique des décalcomanies que lui a montrée le peintre espagnol Oscar Dominguez (un procédé qui consiste à étaler de l’encre noire sur une feuille de papier, de la recouvrir d’une autre feuille, d’y exercer une pression inégale avec la main, puis de séparer les deux pages, provoquant ainsi d’étranges configurations qui avaient déjà fasciné Victor Hugo), il fait une adaptation personnelle en la transposant à l’huile. À partir de ces « arrachages » de couleurs, il fait naître une floraison de mousses et de lichens, d’arbres pétrifiés et de roches marines déchiquetées. Ces images au départ sans objet, Breton les voit comme une « décalcomanie du désir ».
Haute tension érotique et éclectique
 Quant au collage, il est l’instrument favori des métissages et hybridations qu’il ne cesse d’opérer. Le hasard est son partenaire de jeu, l’ironie son arme favorite, les images et objets trouvés son matériau de travail et le tremplin de ses visions. Pour ses « romans-collages », il prélève des fragments de gravures anciennes tirées de romans populaires illustrés, de journaux de sciences naturelles ou de catalogues de vente du XIXe siècle ; il passe de Sade à Fantomas ou de Doré et Grandville à des couvertures de romans policiers. Il pille, découpe, dissèque, détourne, bouture et provoque des germinations mystérieuses afin de « créer une tension éclectique ou érotique. Il s’ensuit des décharges et des courants à haute tension. Et plus les éléments se rencontrent de façon inattendue (canon de fusil, coléoptère, jupe en dentelles), plus l’étincelle de poésie qui en jaillit est surprenante ».
Quant au collage, il est l’instrument favori des métissages et hybridations qu’il ne cesse d’opérer. Le hasard est son partenaire de jeu, l’ironie son arme favorite, les images et objets trouvés son matériau de travail et le tremplin de ses visions. Pour ses « romans-collages », il prélève des fragments de gravures anciennes tirées de romans populaires illustrés, de journaux de sciences naturelles ou de catalogues de vente du XIXe siècle ; il passe de Sade à Fantomas ou de Doré et Grandville à des couvertures de romans policiers. Il pille, découpe, dissèque, détourne, bouture et provoque des germinations mystérieuses afin de « créer une tension éclectique ou érotique. Il s’ensuit des décharges et des courants à haute tension. Et plus les éléments se rencontrent de façon inattendue (canon de fusil, coléoptère, jupe en dentelles), plus l’étincelle de poésie qui en jaillit est surprenante ».
 Pour autant, et même s’il vise « un au-delà de la peinture », Max Ernst n’a jamais cessé de peindre. Onirique, chimérique, fiévreuse et composite, sa peinture intègre et exploite toutes ces explorations parallèles. Elle navigue entre le conscient et l’inconscient, mêle l’organique à l’inorganique, marie l’inconciliable et hybride les règnes entre eux. En temps de guerre, elle livre des visions de paysages après catastrophe, mondes engloutis, forêts hantées, palais écroulés, personnages fossilisés, plantes carnivores et crépuscules fantomatiques. Et en temps de paix, elle se fait jardin enchanté peuplé d’oiseaux, d’insectes et autres créatures improbables et facétieuses, d’efflorescences merveilleuses, de concrétions et cristallisations magiques ouvrant sur des cosmogonies fantasmagoriques. « Mon œuvre, résume-t-il, est à la fois une sorte d’appel à l’enfantillage et le désir de créer un univers pictural à la mesure de la situation tragique de l’homme aujourd’hui. »
Pour autant, et même s’il vise « un au-delà de la peinture », Max Ernst n’a jamais cessé de peindre. Onirique, chimérique, fiévreuse et composite, sa peinture intègre et exploite toutes ces explorations parallèles. Elle navigue entre le conscient et l’inconscient, mêle l’organique à l’inorganique, marie l’inconciliable et hybride les règnes entre eux. En temps de guerre, elle livre des visions de paysages après catastrophe, mondes engloutis, forêts hantées, palais écroulés, personnages fossilisés, plantes carnivores et crépuscules fantomatiques. Et en temps de paix, elle se fait jardin enchanté peuplé d’oiseaux, d’insectes et autres créatures improbables et facétieuses, d’efflorescences merveilleuses, de concrétions et cristallisations magiques ouvrant sur des cosmogonies fantasmagoriques. « Mon œuvre, résume-t-il, est à la fois une sorte d’appel à l’enfantillage et le désir de créer un univers pictural à la mesure de la situation tragique de l’homme aujourd’hui. »
Françoise Jaunin