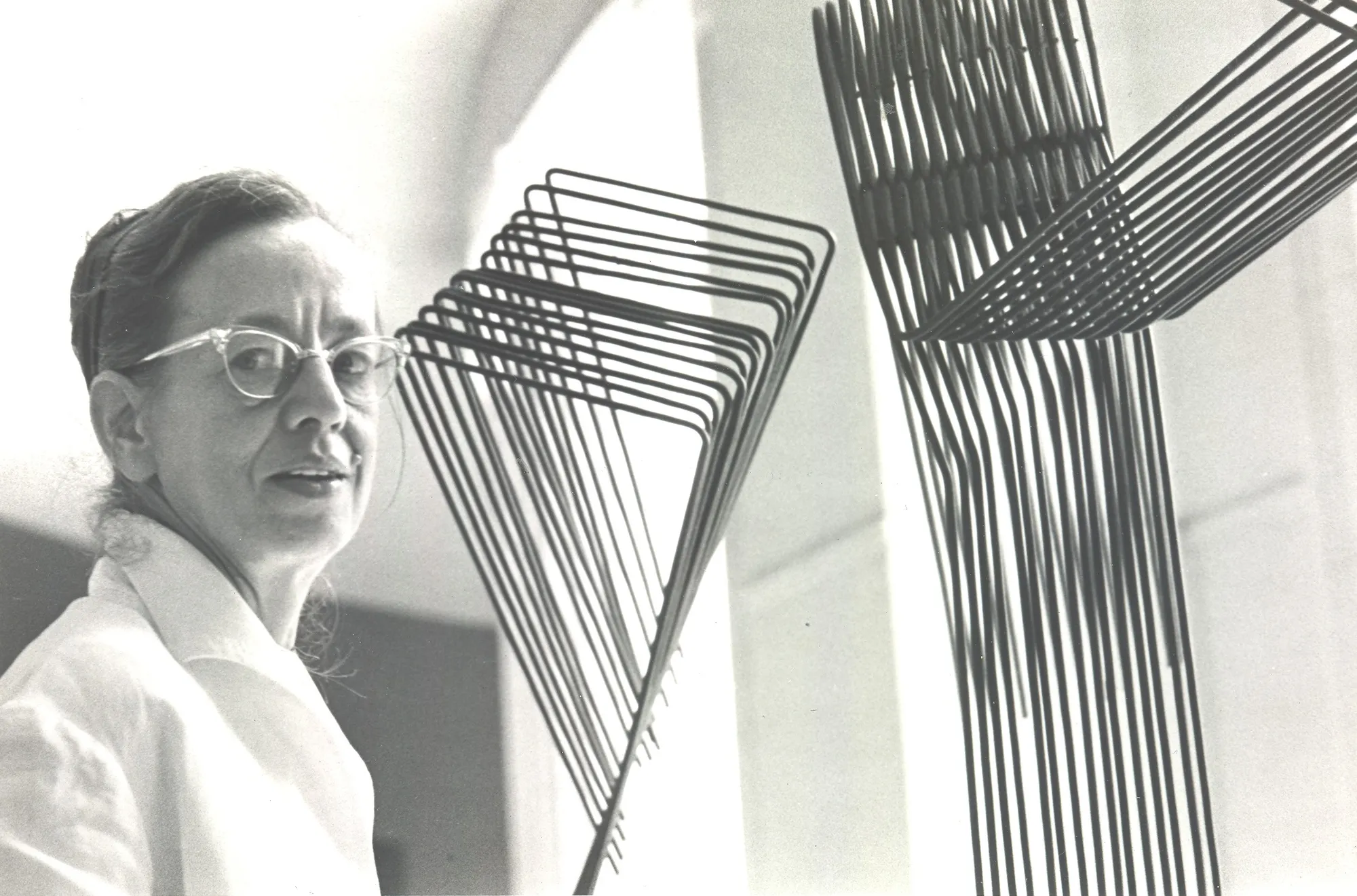Tout le monde n’a pas son billet pour Bayreuth, et il y a beau temps que Bayreuth, temple toujours (désormais plus pour touristes que pour pèlerins) n’est plus le modèle ni pour Wagner tel qu’il se met en scène, ni Wagner tel qu’il se chante. On a assez protesté que Wagner tel qu’il s’est enregistré en studio (les séries Karajan ou Solti, etc.) n’était pas exemplaire non plus : facticité de l’impression sonore, plateau de stars plutôt qu’ensembles, etc. Où se trouver une vérité, et une égoïste, pour soi (et les amis) et chez soi ? Un splendide coffret Sony nous apporte une des bonnes réponses. Le très haut lieu du chant wagnérien aux années 30 et 40 a été le Metropolitan de New York. Bodanzky, chef pointilleux et inspiré à la fois, y disposait par roulement, mais en permanence, des meilleurs, bien plus qu’à Bayreuth où il fallait plaire à la cassante Cosima et, elle partie, au régime brun qui s’y installait. Quand y débarqua une Flagstad d’à peine quarante ans qui se croyait finie, assez comblée dans ses ambitions par une Sieglinde sur la Colline Sacrée, un âge d’or en résulta cinq ou six ans : de quoi sauver de la banqueroute un Met en crise. Les soirées Flagstad/Melchior, en son d’époque certes, mais bien restauré, sont là pour nous montrer comment Wagner a pu être chanté, et comment ceux d’aujourd’hui devraient essayer de faire. Le coffret ne réunit les géants que deux fois, dans Siegfried (1937) et Tristan (38), avec Bodanzky. Mais l’électrisante Marjorie Lawrence (celle que terrassera bientôt la poliomyélite) en Brünnhilde de la Walkyrie et du Crépuscule, c’est un rechange qui aujourd’hui ferait courir les foules ! L’Elsa de Lohengrin, la Vénus de Tannhäuser est Astrid Varnay dont les débuts en décembre 41, à 23 ans, avaient été fracassants : Sieglinde au pied levé pour remplacer Lotte Lehmann, et Brünnhilde quatre jours plus tard pour remplacer Helen Traubel. L’exploit, unique dans les annales, fut éclipsé à la une des journaux par un autre événement : Pearl Harbour ! Les chefs sont à la hauteur des chanteurs : avec Bodanzky un jeune et brillant Leinsdorf, puis Szell et Fritz Reiner, pas moins. La jeune génération américaine arrive derrière Varnay : Margaret Harshaw (Elisabeth), George London (Wolfram). Puis les Européens stoppés par la guerre, Hotter (le Hollandais, Wotan de Rheingold), Schöffler (Sachs), Victoria de los Angeles (Eva) rejoignent deux mezzos importés comme on n’en fera plus, Kirsten Thorborg (Ortrud, Erda), Karin Branzell (Brangäne, Fricka). Seul absent : Parsifal. Coffret magiquement illustré. L’Eldorado des rêves wagnériens est là.
L’alternative nous vient de la décennie d’après, du Neues Bayreuth qui en 1951 allait révolutionner surtout la vision scénique, désencombrée des casques, lances et braies aux relents historiques devenus suspects. Le chant aussi était rénové. Flagstad, première pressentie par les frères Wagner, désigna Varnay pour lui succéder. Des années 50 nous restent, sonorement parfaits, six Rings complets, dirigés par Clemens Krauss (le plus agile, le plus dramatiquement inspiré), Knappertsbusch ou Keilberth, à choisir selon qu’on préfère Varnay ou Mödl en Brünnhilde. N’importe lequel peut être pris les yeux fermés, le Wagner dramaturge y est à 100 %, le Wagner musicien aussi ; mais le Wagner chantable à 85 % seulement. Déjà le chant tend au cri : sans rien pourtant qui annonce la débandade à venir. Du même Bayreuth, Tristan 52 dirigé par Karajan avec Vinay et Mödl : une telle brûlure d’âmes, ça ne se retrouvera plus, communiquée par de tels timbres. Deux sublimes fois Knappertsbusch dirige Parsifal : avec Ludwig Weber, Mödl et un jeune Windgassen (51) ; dix ans après avec Hotter ineffable en Gurnemanz, l’un comme l’autre d’emblée repris par le disque officiel, Decca là, Philips ici.
Deux fois dans l’histoire du chant wagnérien des équipes se sont constituées pour recréer Wagner en scène et par la voix, vivant et vrai. Ici les voix suffisent pour que nous retrouvions la scène. Économisons-nous le voyage !
Philippe Boyer