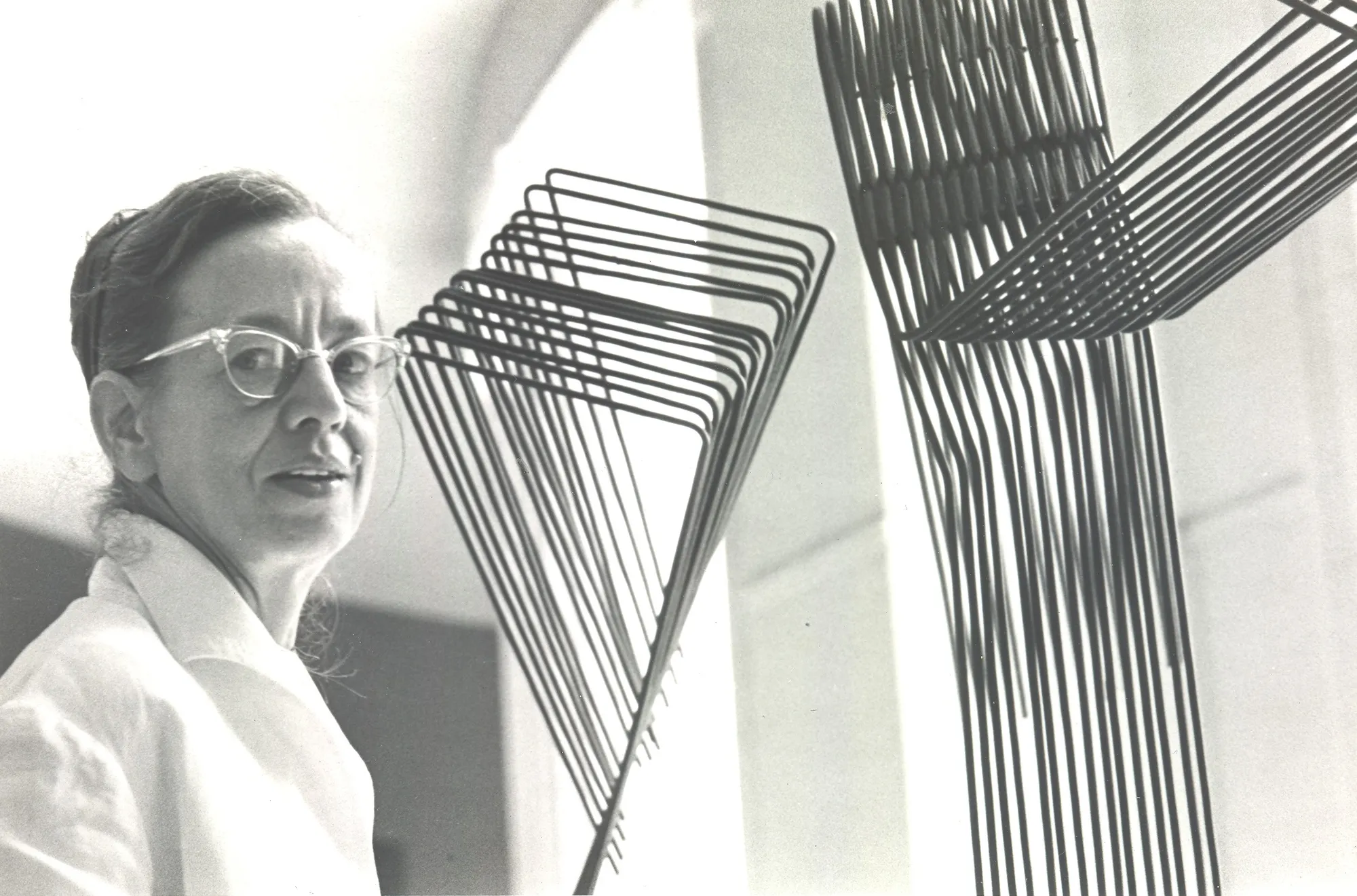Après le Stedelijk Museum et la Tate Modern, c’est la Fondation Beyeler qui accueillera cet été la grande rétrospective de la peintre sud-africaine Marlene Dumas. Élaborée conjointement par les trois institutions, l’exposition, intitulée Image as Burden, présente néanmoins quelques variations bienvenues entre les accrochages amstellodamois, londoniens et bâlois, mettant en lumière des aspects différents dans l’oeuvre de Dumas.
Arrivée aux Pays-Bas en 1976, à l’âge de vingt-trois ans, au bénéfice d’une bourse d’études, Marlene Dumas s’inscrit aux Ateliers 63, une école d’art indépendante située à Haarlem, près d’Amsterdam. Elle suivra également brièvement un cursus de psychologie à l’université, entre 1978 et 1980. Son travail, plutôt dans le ton de l’époque, c’est-à-dire assez conceptuel et souvent basé sur des fragments de textes et des collages, rencontre vite un certain succès ; elle participe à plusieurs expositions collectives et est invitée à la documenta 7 en 1982. L’année suivante, la galerie Helen van der Meij à Amsterdam inaugure Unsatisfied Desire, la première exposition personnelle de l’artiste dans sa ville d’adoption.
Reprise en 1984 par Paul Andriesse, qu’elle connaît déjà depuis quelques années, cette galerie – qui conservera durant de longues années l’exclusivité de ses travaux – entame avec Marlene Dumas une fructueuse collaboration. Cette même année, l’artiste décide en effet de donner une nouvelle orientation à son travail en se consacrant uniquement au dessin et à la peinture. Cette décision, prise au demeurant à contre-courant des tendances artistiques de l’époque, est sans aucun doute celle qui va lui donner sa véritable stature en installant la nature fondamentalement paradoxale de son travail.
Pour radical qu’il soit, ce changement ne signifie pas que l’écrit ait perdu son importance aux yeux de l’artiste, bien au contraire. Non seulement Dumas accole à ses oeuvres des titres soigneusement choisis, mais elle est aussi l’auteur d’une multitude d’aphorismes, de fragments poétiques et de considérations sur l’art en général et sur le sien en particulier qui font, à nos yeux, partie intégrante de son travail. Marlene Dumas a affirmé à maintes reprises son envie, voire son droit de participer à l’écriture de sa propre histoire. Le plus grand mérite de cette rétrospective est peut-être d’avoir suscité la réédition actualisée de Sweet Nothings, dont la première édition, datant de 1998, était épuisée et presque impossible à dénicher, car plus que bien des commentaires extérieurs, ses textes éclairent sa conception de l’art : complexe, polysémique autant que polymorphe, indéfini, amoral, primordial et futile.
L’artiste avouait en 2005, dans une interview au magazine Artpress, avoir lutté toute sa vie « pour concilier la notion de prédestination avec celle de liberté ». Cette lutte, pour épuisante qu’elle soit, n’en constitue pas moins une dialectique qui permet de comprendre l’importance que revêt aux yeux de Dumas le fait de se situer par rapport à son propre travail. Si la plupart des artistes ou des écrivains admettent bon gré mal gré la dépossession de leur oeuvre inévitablement induite par l’exercice de la critique, Marlene Dumas a quant à elle plus d’une fois exprimé, souvent avec humour, son refus de principe de l’interprétation extérieure, au moins dans sa dimension légitimante, parlant de « colonialisme » de l’oeuvre. Elle se surnomme elle-même Miss Interpreted, ce qui peut se comprendre à la fois comme « Mademoiselle interprétée » et comme « Mal interprétée ». Elle moque ceux qui se présentent devant un tableau comme devant une femme à séduire, tous deux censés se mettre à nu pour peu que le discours soit adéquat. C’est bien la pertinence même de l’idée d’interprétation critique qui se voit récusée ou, à tout le moins, franchement mise en question. Si l’idée de prédestination reste relativement abstraite pour la plupart des occidentaux, Marlene Dumas, quant à elle, a grandi dans un pays où cette notion renvoyait à une réalité tragiquement concrète. Peut-être faut-il y voir l’origine de sa sensibilité épidermique – si l’on ose dire – à toute tentative de catégorisation et sa répugnance face au concept d’identité. On peut sans doute y ajouter le fait d’être une femme, dans un milieu artistique pas aussi ouvert qu’on pourrait le penser ; le titre ambigu d’artiste-femme la plus chère du monde, dont elle a été couronnée à plusieurs reprises, souligne au-delà du gimmick journalistique la prégnance de certains stéréotypes, dont son travail et certaines de ses prises de positions – je peins parce que je suis blonde – se font l’écho.
Cette volonté constante d’être, au prix de beaucoup d’incertitude, au moins deux choses à la fois – et parfois beaucoup plus – se retrouve dans sa peinture proprement dite. Seule parmi les arts majeurs, la peinture se confronte au mystère de l’image, c’est-à-dire qu’elle explore de manière mimétique l’insondable hiatus existant entre le réel et sa représentation mentale. Cette question n’est évidemment pas neuve, et de Zeuxis à Dumas, les peintres ont dû en explorer les multiples facettes et la complexité croissante au fil du temps. De ce point de vue, la peinture de l’artiste sud-africaine – mais la remarque est valable pour d’autres peintres contemporains – est une mise en abyme de cette problématique picturale remontant au moins aux
Grecs : il s’agit d’ajouter le mystère de l’image à un réel perçu comme étant déjà lui-même une somme de représentations.
Comme beaucoup de peintres contemporains, Marlene Dumas travaille la plupart du temps à partir de photographies, qu’elle collecte depuis toujours et dont les sources et les registres sont extrêmement variés, allant de l’histoire politique à la culture mainstream en passant par la franche pornographie. Elle y ajoute des formes canoniques ou tirées de genres de l’histoire de l’art et, d’une manière générale, toute composition présente à un titre ou un autre dans notre mémoire collective de monstres gavés d’images, et dont l’apparition provoque une amorce d’identification, même si elle n’est pas toujours très nette ou très consciente. Ce sont ces sortes de mèmes visuels que le travail de l’artiste questionne sans relâche jusqu’à en faire exploser l’unité.
La peinture de Marlene Dumas, quoique stylistiquement assez reconnaissable, varie de la quasi-abstraction à une figuration plus franche et assumée ; selon les oeuvres, et le plus souvent au sein d’un même tableau, la prédominance est donnée tour à tour au trait puis à la couleur. Fondée théoriquement, la confusion de la composition et du sujet est souvent renforcée par l’absence délibérée de tout élément contextuel. Les titres, souvent ambigus et en décalage avec ce qui est montré, incitent à aller au-delà de ce qui est immédiatement visible et à entrer dans une relation où les aspects critiques ou référentiels fusionnent avec ce que Dumas, après Susan Sontag, nomme l’érotisme de l’art, c’est à dire une intelligence sensuelle de l’image.
De la même manière qu’elle revendique sa légitimité à prendre place parmi les critiques de son oeuvre, Marlene Dumas paraît entamer à chaque nouveau tableau un processus d’exploration qui ne la place pas si loin que cela du spectateur. Le plein potentiel de l’oeuvre se trouve dans la relation d’intersubjectivité et cela semble valable tant entre le peintre et son tableau qu’entre le tableau et son spectateur.
NOTA BENE
Exposition Marlene Dumas
Fondation Beyeler, Bâle
Jusqu’au 6 septembre 2015